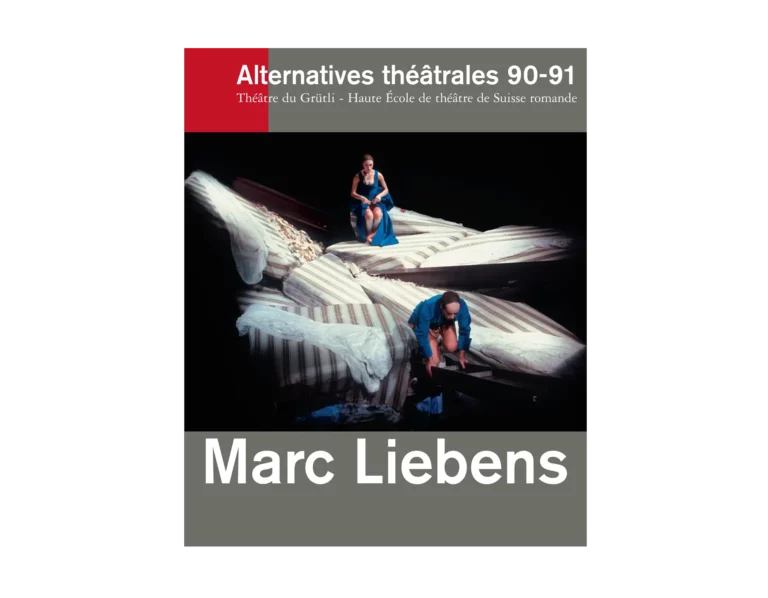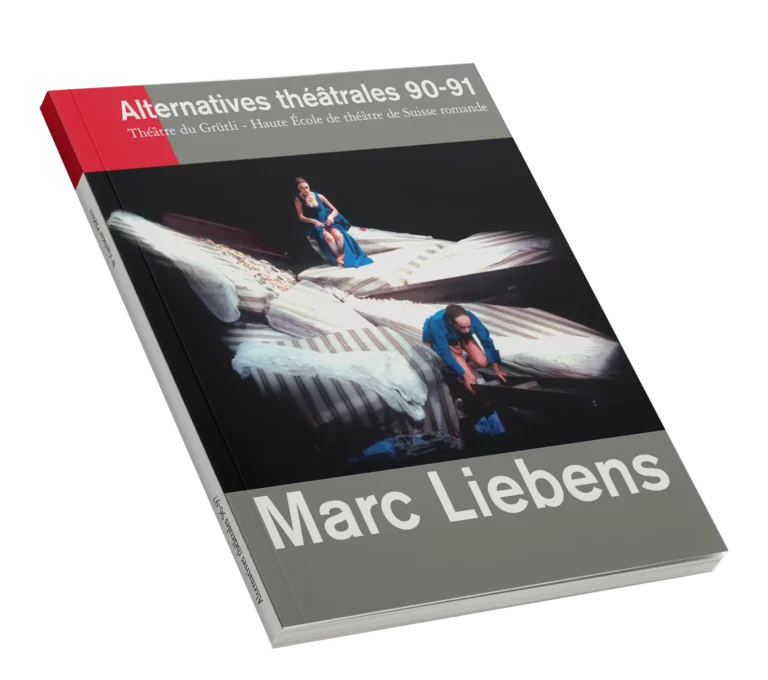Il y a des métaphores au souffle long et Heinz Wismann en a proposé une cet été : celle des spectateurs qui, chaque année, se dirigent vers Avignon comme des pèlerins à la foi toujours intacte. Cette attente, cycliquement réactivée, Vilar l’a compris, confirme le succès de l’aventure engagée il y a soixante ans : « Nous avons réussi le public », disait-il. Un public jeune qui se renouvelle et, en même temps, un public fidèle qui aime suivre le théâtre plusieurs générations durant. Le souvenir, comme en amour, de « la première fois » est récurrent, pour qu’ensuite l’expérience perdure et inscrive sur la mémoire de chacun les « cercles du temps », pareils à ceux qui scandent le fût des arbres, et finissent par la nostalgie épique du « il était une fois »… Personne n’a vieilli à Nancy, au festival depuis longtemps disparu, à Avignon oui !
Il régna cet été une atmosphère légère, et Vincent Baudriller avec Hortense Archambault l’ont cultivée en compagnie de Joseph Nadj qui l’instaura grâce à des photos de sa cité d’enfance ou à des dessins à l’encre, d’une intensité orientale, de son ami Alexandre Holan, à des céramiques de Barceló ou à des concerts de jazz… Sur les marges, les arts voisins, nullement intempestifs, ont accompagné le programme comme un sfumato discret.
Pessoa disait que « la littérature, de même que toute forme d’art, est l’aveu que la vie ne suffit pas ». Le théâtre confirme pareil diagnostic car ses réussites, toujours, se convertissent en événements proprement biographiques que l’on aime revivre en les racontant… Récits de « l’autre vie »… Récits de juillet. Les récits d’Avignon.
L’art nécessaire
Seul l’art qui fait résonner l’être l’emporte dans un au-delà du quotidien. Plus encore, seul le grand art, c’en est d’ailleurs la preuve, produit en soi du texte. Certes, le chef‑d’œuvre laisse d’abord muet, perplexité extrême qui demande du temps pour se convertir en commentaire, mais certaines œuvres ou spectacles, rares, rendent intérieurement loquace. L’œuvre parle en moi et… me fait parler ! Certes, j’entends déjà les réserves à l’égard de pareils propos considérés comme trop… littéraires ! J’assume. Pour moi, « un peu classique » selon le diagnostic d’une amie, le grand art se mesure à l’aune du texte qui surgit en moi. Texte intérieur ! Cette profession de foi m’a été inspirée par Paso Doble, qui a ressuscité l’expérience des représentations exemplaires qui, chacune, m’ont érigé en un véritable geyser littéraire : La Classe morte de Kantor ou Argentina de Kazuo Ohno, La Conférence des oiseaux de Brook ou Les Troyennes de Serban, Tambours sur la digue de Mnouchkine ou Médée de Vassiliev, Purifiés de Warlikowski, Rwanda 94 du Groupov, Les Aveugles de Denis Marleau… Elles placent le spectateur dans la posture souvent évoquée par Grotowski, « dehors-dedans », et, à partir de cette incertitude, il parle. Pour dire ce que l’expérience a suscité en lui. Et ainsi, la source initialement tarie qu’il était se mue en rivière ! Comme après ce Paso Doble unique ! De la glaise aux mots ! Voilà le miracle de l’art nécessaire.
Paso Doble, l’œuvre unique
Le Cloître des Célestins. À Avignon, combien l’on éprouve cette réverbération onomastique des lieux jadis sacrés ! À travers le vitrail central — subtil effet poétique —, les rayons du soleil joints à ceux d’un projecteur nimbent un plateau dressé presque à 90° à partir de la scène. Nadj et Barceló se lancent dans une sorte de work in progress grâce à la mobilité de la terre glaise dont ils modèlent des amphores ou des masques grotesques projetés avec énergie ensuite sur le mur devant eux. Tout ce qui surgit disparaît dans la seconde d’après, inlassable reprise d’un geste de création voué à la destruction : que rien ne dure ! Il y a de l’improvisation et du jeu dans ces gestes qui rappellent aussi la pulsion ludique des enfants face aux châteaux de sable emportés par les eaux ou effondrés sous l’impact de leurs propres bâtisseurs d’un jour. Plaisir régressif, mais aussi plaisir inventif de l’artiste qui ébauche des formes, les fait apparaître et disparaître, tel Picasso dans le film de Clouzot. Le public s’apparente alors à la caméra et, pareil à elle, plonge éperdument dans le chaos de ce grimoire de la gestation. Figuration de la création… Grâce à ce brouillon, le spectateur suit, en témoin attentif, le processus de la naissance aussi bien que de l’effacement, jusqu’au moment où Nadj, le danseur, s’immobilise pour s’ériger en support pour les vases que Barceló entasse sur ses épaules jusqu’à ce que son allié s’effondre. Corps englouti sous les œuvres… Il rappelle alors les légendes balkaniques du Maître Manole en Roumanie ou du Pont de Dma en Serbie, selon lesquelles les rituels de construction exigent une victime pour que le monument hors pair tienne : il se paye au prix de la vie ! Ainsi l’union binaire initiale se scinde et Nadj semble se sacrifier pour l’œuvre de Barceló qui l’écrase. L’enterrement du vivant, sous nos yeux, dans la terre des céramiques semble, un instant, accomplir le rêve premier de Nadj qui souhaitait « disparaître dans le tableau ». Faux final ! Géniale relance. Barceló, tout en agglutinant ses vases qui portent tellement la marque des Dogons d’Afrique, se livrait en même temps à des lacérations énigmatiques sur le plateau de glaise. Rappel de ces dessins étranges qui zèbrent les sols péruviens pour servir, semble-t-il, à d’improbables extraterrestres, hiéroglyphes primitifs indéchiffrables pour un œil non averti, secrets kabbalistiques… Simultanément, d’un côté le mystère de ces signes, de l’autre l’épreuve du corps, Barceló et Nadj, « Paso Doble », ironique détournement d’une réputée figure de danse. Mais une fois la surface argileuse couverte d’incrustations et la surcharge parvenue à son point extrême, les deux artistes se retrouvent ensemble et passent, pour de bon, au-delà de la surface en laissant derrière eux deux trous géants. Ils creusent, avec leurs corps, les deux yeux qui donnent sens aux griffures du plasticien : c’est un portrait qu’il dessinait, mais pour qu’il se constitue en visage, il réclamait la disparition double de ces artistes-aventuriers. Et, eux une fois évanouis, un être nous regarde du plus profond de sa terre. C’est l’homme issu de la glaise et du sacrifice partagé. Figure « première » dont je suis le partenaire de choix. Je le vois et il me voit. Ce n’est pas Dieu, mais moi-même rehaussé par l’Art qui en a esquissé les contours, et par les artistes qui ont payé de leur être. Chacun a besoin de l’autre… Art partagé ! Ce visage qui évoque la création primordiale rend concrète et physique la métaphore nietzschéenne du « ravin qui vous regarde ». Ici, la scène me voit, jusqu’au plus profond de moi-même. Mais parce que j’ai vu ce visage d’Homme engendré sous mes yeux par des hommes qui s’y sont engouffrés, je parle. Il me regarde de l’au-delà de la Mort et surplombe ma vie.
Imaginaire état des origines
De Bartabas, nous connaissons les performances et les excès, la pose ou l’extrême engagement : étrange alliage. Il captive ou exaspère ! Mais après avoir vu Battuta, comment rejoindre ceux qui déploraient sa présence en Avignon cet été ? Le succès n’est pas synonyme de qualité, mais son contraire non plus : il y a encore des succès qui honorent et rassurent. En voilà un…
Au-delà de ses exploits reconnus, Bartabas, inspiré par le nomadisme tzigane, esquisse ici une image du monde. Monde des commencements que les chevaux au galop, sans selle ni cavalier, ressuscitent par leur course effrénée. On retrouve alors mentalement la steppe mongole ou les plaines de la Camargue… Lieux des origines ! D’ailleurs, l’image finale ne rappelle-t-elle pas le leitmotiv de Tarkovski, chez qui si souvent un cheval erre sous la pluie dans des paysages sans âme qui vive ? Ici aussi tout se termine avec un bel étalon qui s’avance et se place sous la colonne d’eau, véritable poutre maîtresse du spectacle. Un cheval et de l’eau… Voilà le début, le Grand début !
Dans Battuta, les cavaliers bondissent en pleine course et, hissés sur le dos de leurs chevaux libres, ils racontent des histoires d’amour et d’enlèvement de femme, de mariage et de fête. Rapidité et passions rythmées par un orchestre moldave et une fanfare gitane qui se relayent pour entretenir le rythme débridé du spectacle. Bartabas, au terme de ces divers exploits équestres, surgit dérisoirement à dos d’âne pour décliner ensuite, à toute allure, les figures de la mythologie gitane, comme dans un film de Kusturica en accéléré. La vitesse, ici, tout se place sous son signe auquel s’ajoute cet humour que nous avions découvert dans J’ai même rencontré des Tziganes heureux ! C’est du nomadisme exacerbé sur fond de dépense exaltée.
En écho, Bartabas convie les spectateurs au lever du soleil dans la carrière Boulbon où, au cœur du cratère de pierre, il se dresse seul, pour engager, dans cet autre lieu des origines, le dialogue matinal avec son partenaire, le désormais célèbre cheval noir Caravage. Et alors, tel un Grotowski du « théâtre équestre », nous retrouvons la force primordiale du « théâtre des sources ». L’homme muni d’une technique dans un monde inaugural.
La voix du Grand Extérieur
Le Grand Extérieur, c’est ainsi qu’Antoine Vitez désignait le territoire de la mort. Et c’est de là qu’il m’a semblé entendre la voix off qui raconte l’histoire des Marchands de Joël Pommerat. Voix du dehors, lointaine, qui fait apparaître ou s’évanouir des personnages pris dans les rets d’un quotidien sans issue, que seul l’électrochoc d’un meurtre d’enfant pourra dénouer. Cette jeune mère meurtrière tient de Médée autant que de Jeanne d’Arc. Le geste hors norme ou l’illumination — voilà les seules réponses face à la cruauté d’un monde sans issue ! Monde dominé par l’économique… Par l’absence de réponse raisonnable et le miracle comme unique solution, Pommerat renvoie au Grand Extérieur, à ce pays inaccessible où le Deus ex machina est possible. Scepticisme indépassable !
C’est de là aussi que se lève la voix de Claire Goll dont les mémoires bigarrées — éditées par un ami, Adam Biro, je l’apprends en rentrant à Paris — forment la matière du récital de Viviane De Muynck mis en scène par Jan Lauwers. Qu’est-ce que la vieillesse avancée sinon l’antichambre du Grand Extérieur où, comme disait Gide, elle trouve solution ? Arrivé là, on tourne la tête et, une dernière fois, avec nostalgie ou joie, comme ici, on revisite chemins, pays, personnes, bref la vie. Lauwers, grâce à des projecteurs accrochés aux poulies qui descendent lors de chaque étape franchie, accompagne et conduit les conteuses Claire et Viviane réunies vers un extraordinaire rideau final de lumière. Claire Goll joue de la biographie et de ses protagonistes en se plaçant dans l’entre-deux du vrai/faux qu’ensuite, à son tour, Viviane De Muynck restitue avec brio : du passé, on se sépare en s’amusant… C’est pourquoi, avec les années qui passent, ni Claire ni Viviane ne s’enfoncent dans la nuit, mais s’approchent de nous en pleine lumière jusqu’à l’éblouissement ultime qui marque l’accès au Grand Extérieur.
Et de quoi d’autre parle Chaise de Bond dans la mise en scène d’Alain Françon ? Elle est l’épure de la douleur. Rarement les gestes sur une scène furent plus économes et les paroles plus égrenées pour dresser, comme dans un tableau naïf, non pas l’image du bonheur, mais, bien au contraire, la désolation contenue du monde. C’est du « théâtre du quotidien » traversé par le désarroi extrême. Valérie Dréville, avec une émotion contenue, en se livrant à des gestes d’une précision picturale, restitue l’ampleur du désastre. Comme d’ailleurs une autre comédienne, Madalina Constantin, découverte dans une pièce de Matei Visniec mise en scène par Alexandra Badea. Comme jadis pour Grüber, pour les deux aujourd’hui, il n’y a plus de cri tragique que murmuré ! Voix embuée… Écho d’une souffrance qui se dérobe à la démesure et entraîne vers le centre anéanti de l’être.
De ce même fossé intérieur s’élèvent les mots qui, à la limite de l’extinction, racontent ce que l’homme peut faire à l’homme dans Rouge décanté. Et de nouveau, c’est l’histoire d’une femme poussée jusqu’au bord de l’abîme que l’on revisite. Ce récit du traitement infligé aux prisonniers hollandais dans les camps japonais en Indochine plonge les spectateurs que nous sommes au cœur de l’Enfer, d’où nous parviennent des mots à peine audibles qui, enfin, en douceur, libèrent… Voix blanche pour dire l’absolu de l’horreur. Voix de l’intime, voix qui remonte du plus profond de soi dans un ultime sursaut. Victoires arrachées au prix d’un effort inouï contre le silence, contre le mutisme auquel pareilles expériences conduisent. Le murmure de ces voix-là, on l’a entendu cet été à Avignon.
Ambivalences ludiques