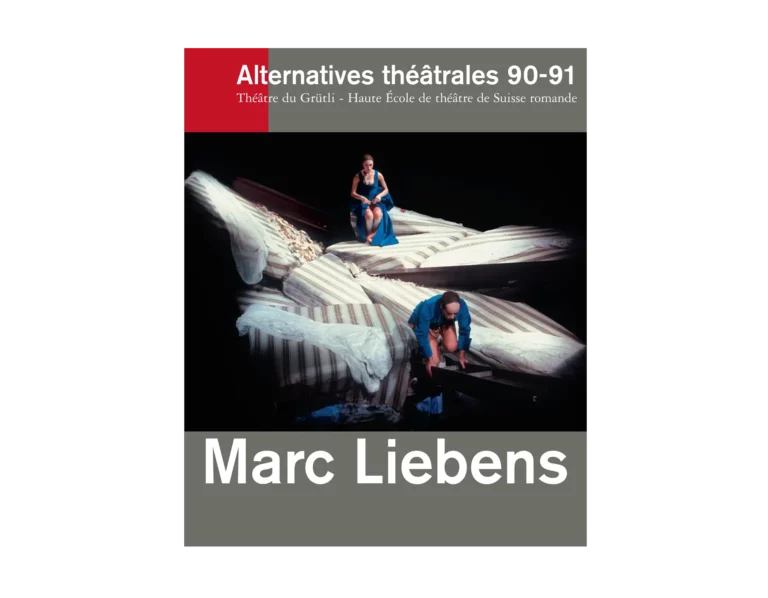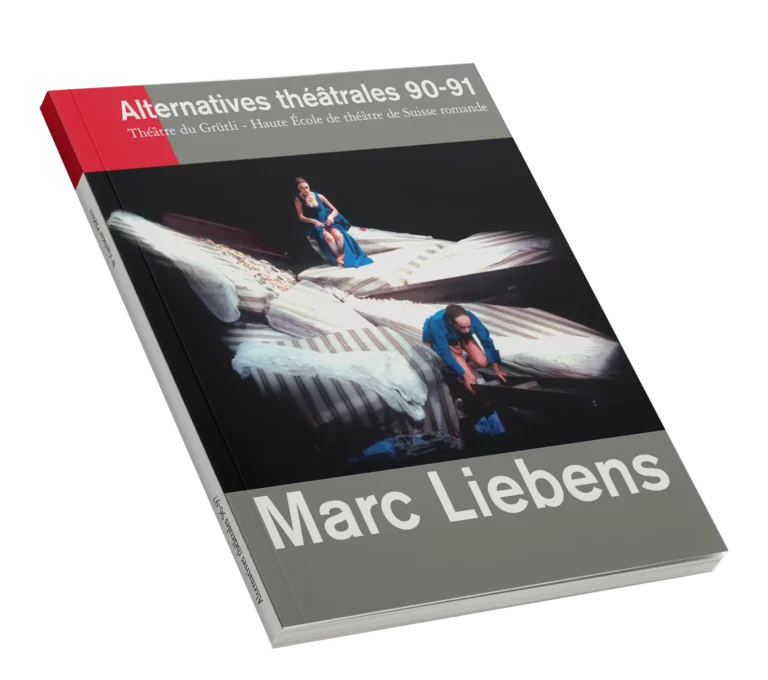Bernard Debroux : Vous démarrez votre première saison à la direction du Théâtre du Grütli par ces quatre journées appelées Débats logoS en faisant se rencontrer des universitaires, des théoriciens, des philosophes et des artistes. C’est affirmer que vous prenez parti pour un théâtre de la pensée ?
Maya Bösch : Notre intention est de créer à Genève une scène expérimentale qui mette en avant la recherche théâtrale, en permettant aux créateurs de prendre le temps de travailler et d’échanger des idées. Nous posons que, dans cette région où il y a beaucoup de Hautes Écoles, de facultés diverses, des centres de recherches très pointus comme le CERN, etc., il est possible de créer un champ de communication entre la science, la filière universitaire et les arts. Nous voulons produire non seulement des spectacles mais aussi de la rencontre. La saison logoS, c’est aussi la volonté toute simple de retourner à l’origine du théâtre, d’être curieux d’une autre langue, de l’organisation, de l’esthétique et de la politique d’une société vieille de 2500 ans, tout en se positionnant pour un théâtre du futur, un théâtre qui invente de nouvelles formes, de nouveaux rapports entre spectateurs et créateurs. Les Grecs reloaded, comme l’écrit Mathieu Bertholet dans son texte pour UTZGUR !
Michèle Pralong : Un théâtre de la pensée, oui, certainement, puisque c’est le ressort essentiel du théâtre : le langage, les idées qui passent d’une tête à l’autre. Il y a là un ballet de boîtes crâniennes : celle de l’auteur, du comédien, du spectateur. J’aime l’expression de Brecht qui disait que faire du théâtre, c’est penser dans la tête des autres. Mais il y a aussi transfert, passage, jeu entre les corps, et le théâtre qu’on cherche ne doit pas oublier le physiologique. Je pense très sincèrement que le théâtre suisse romand doit miser sur deux choses aujourd’hui : une attention renforcée à la dramaturgie et le frottement avec les autres arts, au premier chef avec les arts plastiques et avec la danse. Donc un théâtre du corps aussi. Ces débats en ouverture de saison ont été un peu comme une grande séance de travail à la table, un travail dramaturgique qui prendrait librement les pièces de la saison comme un corpus à questionner. Toute approche dramaturgique n’est intéressante que si elle commence par dynamiter les idées reçues. Ce que les interventions de Florence Dupont notamment, professeur à Paris VII, n’ont pas manqué de faire : elle s’est livrée à un véritable exercice d’essorage de l’Antiquité, d’essorage surtout de la fascination pour l’Antiquité, ouvrant ainsi aux créateurs un immense champ de liberté. Pour ma part, j’en garde au moins ceci, posé par la philosophe Sophie Klimis, que la force essentielle de la tragédie, c’est de se voir soi-même en autre, afin, en retour, de pouvoir comprendre l’autre comme soi. Ces quatre jours étaient forts, et nous souhaitons poursuivre avec une série de séminaires dramaturgiques sur plusieurs tragédies et divers thèmes de logoS (le concours, le chœur, la guerre, la démocratie, etc.), avec des visionnements de captations scéniques emblématiques, guidés dans ce périple par Bernard Schlurick, l’un des auteurs de la saison, spécialiste de littérature comparée1.
B. D. : Dans votre note d’intention pour la direction à donner à ce théâtre, vous utilisez le mot « déplacer ». Qu’entendez-vous par cette notion ?
M. B. : Déplacer, c’est inventer ses propres instruments, sortir de ce qui est très prégnant ici, une sorte de classicisme à la française, et travailler sur des formes concrètes, avec des outils précis. Regardez ce qui s’est passé lors de la lecture des Perses, projet mené par Claudia Bosse, lors des Débats logoS. C’était la première fois que l’équipe viennoise de ce travail monumental rencontrait l’équipe genevoise : chacun pouvait voir et entendre ce qui se passe lorsqu’un processus de travail est rendu public, lorsque deux approches, deux manières de dire se rencontrent. Il y a choc, saut, échange. Où l’on voit, simplement, que le théâtre nous concerne tous, qu’il ne propose pas seulement des spectacles mais qu’il est une pratique politique, un lieu d’analyses et d’expérimentation des réalités d’aujourd’hui. On est des créateurs. On doit chercher. C’est comme une pâte à modeler : il faut inventer plutôt que courir toujours à la même interprétation qui finit par fermer le sens. Pour revenir à ces Débats, il faut avoir à l’esprit qu’à la Volksbühne de Berlin, lorsque les philosophes sont invités à prendre la parole, le théâtre est rempli de spectateurs et de praticiens. C’est vraiment une plate-forme. Pour les artistes, un matériau est fourni là qui sera ensuite déplacé, malaxé, concrétisé par des recherches.
B. D. : Un élément important pour vous aussi, c’est ce lieu dans lequel on se trouve. Ce théâtre avec ces espaces très particuliers…
M. P. : Nous avons conçu notre projet en fonction du paysage théâtral régional, de la mission du Grütli, et surtout de son infrastructure. Nous disposons de deux salles, toutes les deux polyvalentes, qui sont inscrites dans une maison des arts (arts plastiques, cinéma, danse, bibliothèques, restaurant, etc.). Tout ça au centre d’une ville très active culturellement mais qui, traditionnellement, valorise essentiellement la musique classique. On a commencé par réfléchir aux conditions de travail qu’on allait donner à ces espaces et au moyen d’inviter les créateurs à occuper le Grütli dans ses grandes largeurs. Exemple : la proposition faite à Oskar Gomez Mata de prendre toute la maison pour un spectacle déambulatoire, installatif et éclaté, Épiphaneïa.
M. B. : Il y a eu au départ cette décision risquée de dire : on enlève les gradins dans les deux salles. Il s’agissait d’élargir le champ des possibles et de laisser ouverte la géométrie dans laquelle on peut transformer à chaque fois la rencontre entre comédiens et spectateurs. Mais pour nous, l’espace du Grütli, c’est aussi la rue ! Lors de la conférence de presse, il y avait huit voitures renversées, posées sur leur toit, proprement garées, « à la suisse » mais à l’envers. Il y a aussi la ville, vers laquelle il faut aller. Cela passe par des relations de bon voisinage : à une banque proche, nous avons proposé d’organiser conjointement un cours de yoga… Il s’agit de manière générale de casser le circuit fermé du théâtre et de s’ouvrir à la société. C’est dans ce sens aussi que nous nous sommes intéressées au projet Let’s experiment democracy, qui reconstitue un chœur de 500 citoyens pour Les Perses : 340 personnes se sont manifestées pour en faire partie, autant de liens inédits entre la ville et le théâtre. De même pour le projet Stations urbaines, succession d’interventions échelonnées sur deux ans dans différentes architectures publiques, et qui se confronte au texte Sportstück d’Elfriede Jelinek, à sa langue qui radiographie la complexité de la pensée contemporaine. L’urbanisme nous donne là des appuis pour investiguer, pour voir et entendre cette critique féroce, véhémente, ludique de la société.
M. P. : Le théâtre est vraiment un espace public important. Il y a donc ici des spectacles, des conférences, des rencontres. Le chaos, le bruit, la tourmente du monde doivent y entrer avec les spectateurs et les artistes. J’ai toujours beaucoup aimé le projet dans lequel Thomas Ostermeier avait remplacé un des murs de son premier théâtre à Berlin, la Baracke, par une paroi transparente, mettant ainsi en relation immédiate et non maîtrisable le théâtre et la rue.
B. D. : Votre projet est très ambitieux. Vous démarrez votre première saison sur le thème de la tragédie grecque ; la seconde serait vouée au théâtre de la Renaissance et la troisième centrée sur les auteurs contemporains… Comme si vous vouliez faire toute l’histoire du théâtre en trois ans ! Bien sûr les choses sont mêlées puisque, dans la création des Sept contre Thèbes, il s’agit du texte d’Eschyle et en même temps d’un véritable texte contemporain…
M. B. : Ce qui est le plus important au théâtre, c’est de se confronter à. Comme tu viens d’en donner l’exemple avec Les Sept contre Thèbes : il s’agit d’une traduction contemporaine bataillant avec un texte de l’Antiquité. Pour nous, il y a là un champ de frottement. Notre première saison n’est nullement une tentative de reconstitution du théâtre grec mais une mise en question, en situation, en confrontation des démarches contemporaines avec celles de l’Antiquité. Par exemple, je ne m’attends pas du tout au retour des masques (peut-être des masques de Mickey Mouse !). Mais je crois que le travail sur un matériau aussi riche peut nous ouvrir d’autres perspectives, une pensée très forte qui nous oblige à inventer de nouvelles formes ou simplement à utiliser l’espace et le temps autrement. La curiosité et le désir sont essentiels dans les domaines de l’art ; sans eux, on arrêterait tout. Depuis cinq ou six ans, il me semble aussi que les mythes reviennent en force comme référence : la figure d’Achille, Troie, Ulysse, etc., ce qui se passe au Moyen-Orient, les conflits et les guerres… Je pense que pour être un théâtre expérimental, il faut non seulement s’engager dans une démarche pluridisciplinaire, cela avec des outils concrets, mais aussi revenir sur le passé, sur les formes du passé. Il ne s’agit pas d’une école mais d’un lieu d’expérimentation qui a besoin de se frotter à des éléments qui peuvent résister. Comme l’Antiquité, par exemple… Peter Sloterdijk dit : « Sont classiques les textes qui résistent à leurs interprétations. » C’est utile, cette force-là.
- Voir son intervention lors des débats telle que retranscrite dans ce numéro en page 71. ↩︎