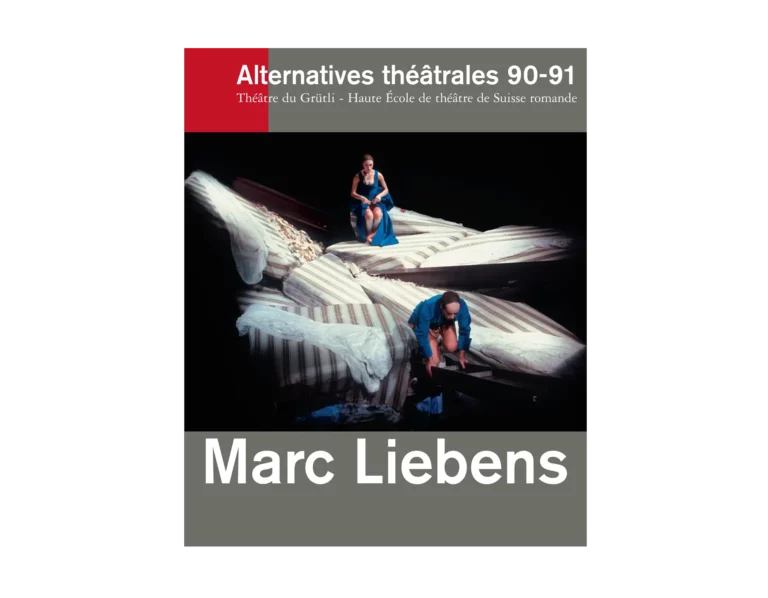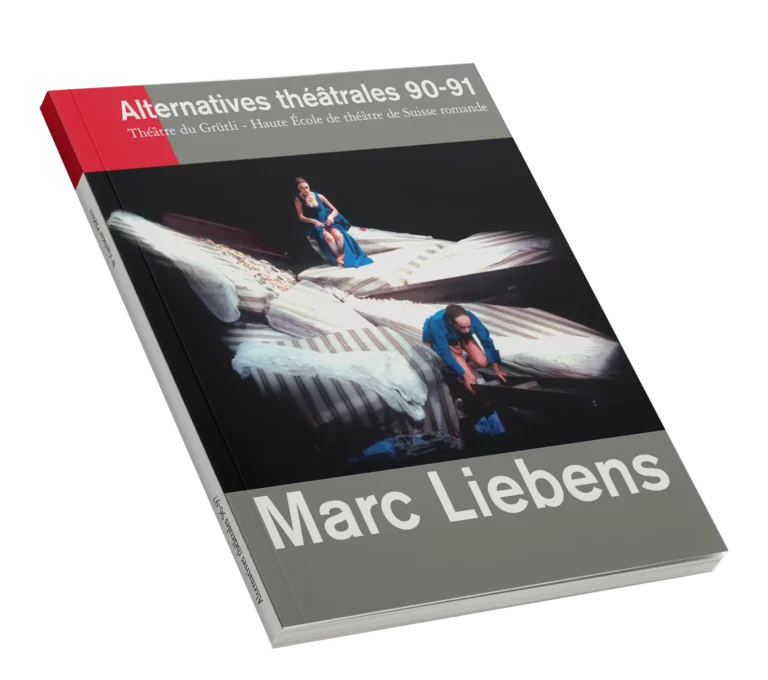Bernard Debroux : Près de trente ans après sa création, Hamlet-Machine a‑t-il encore quelque chose à nous dire aujourd’hui ? Les deux thèmes majeurs qui sous-tendent la pièce (la fin du communisme et la fin du théâtre) ont-ils encore une résonance en ce début de XXIᵉ siècle ?
Hans-Thies Lehmann : Trente ans après sa création, Hamlet-Machine fait partie des « pièces classiques » qui articulent aux yeux des intellectuels, aujourd’hui aussi bien qu’alors, la pensée, la virilité, le désir de la mort dans le contexte d’une réalité politique exclusivement déterminée par des conflits. Elle reste un événement unique de profondeur poétique, politique et intellectuelle. Alors que les idéologies d’une harmonisation néo-libérale et la séduction de sourire au nouveau Danemark y sont omniprésentes, la majorité des jeunes est saisie par le dégoût du monde des faiseurs. Le texte explosif de Hamlet-Machine leur offre un champ de paroles qui permettent, d’une façon toujours renouvelable, de présenter l’art comme le désir de « rendre la réalité impossible ». Même si l’on voulait trouver dans l’œuvre de Müller (ce qui serait d’ailleurs trop simple) la thématique de la fin du communisme, ce ne serait que pour prouver que le communisme n’en finit pas de finir, et même qu’il n’a pas encore commencé d’exister. Il reste que, comme Brecht et Pasolini, Müller est un poète significatif nourri de l’expérience communiste. À l’instar des paysages de Beckett, les champs de ruine de Müller n’en sont pas un endroit pour faire des diagnostics définitifs (ni pour annoncer la fin de quelque chose), mais offrent l’opportunité d’articuler des conflits complexes. Même si la forme du texte de Hamlet-Machine répond à la crise profonde du théâtre dramatique, elle n’annonce pas la fin du théâtre en tant que tel : elle offre un large spectre de figurations politiques post-dramatiques que les moyens traditionnels de la scène ne permettent plus d’exprimer. Il est indéniable que Müller s’appuie sur les épaules de Brecht, qui a réalisé, avec ses moyens, des choses analogues à son époque. Mais cette certitude ne peut faire oublier que Hamlet-Machine de Müller a été écrit dans un monde où aucun des repères et des schémas de Brecht n’est resté inchangé. Alors que le jeune Müller était le « fils » qui réfléchissait sur la crainte des influences, le Müller d’après — et certainement l’auteur de Hamlet-Machine — n’était plus qu’un descendant pour qui Brecht et quelques autres auteurs — pas nécessairement modernes, mais qui partageaient tout au moins les convictions politiques de Brecht — formaient l’horizon de son écriture et de ses idées théâtrales.
B. D. : Quels sont les rapports que l’on peut établir entre Bertolt Brecht et Heiner Müller ? Pour le premier, l’avenir semble éclairer le présent alors que pour le second le passé est source de pessimisme…
H.-T. L. : Cela ne mène à rien de poser la question de pessimisme ou d’optimisme, ni chez Müller ni chez Brecht. Et comme pour chaque auteur important de notre époque, le critère de « moderne » ou de « postmoderne » ne s’applique pas dans le cas de Müller. Il fait partie de la minorité d’auteurs contemporains qui considèrent, sur base d’une conscience acérée des conflits, que le tragique et la tragédie ne sont pas caducs, et qui ont relevé le défi de formuler le tragique. La question reste : comment définir son écriture entre le grotesque (postmoderne) et ce que Walter Benjamin nommait « tragédie », entre la question de savoir si la tragédie est possible aujourd’hui et l’impulsion anti-tragique qui est inhérente à la chose politique. Ce qui est sûr, c’est que son écriture et ses exigences du théâtre sont intimement liées à la nécessité de dépasser les cadres et les canons conventionnels d’une façon concrète. Comme le corps représente un bloc sur lequel butent les grandes idées, le fragment bloque la tendance à la grande synthèse. Ces aspects de son écriture font de l’œuvre de Müller une œuvre qui correspond à la fois à son et à notre époque, et qui est toujours d’actualité aujourd’hui.