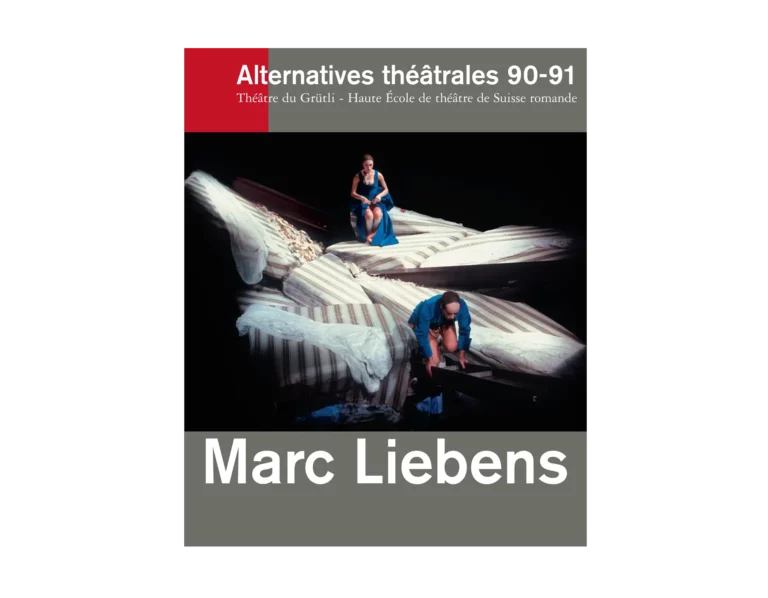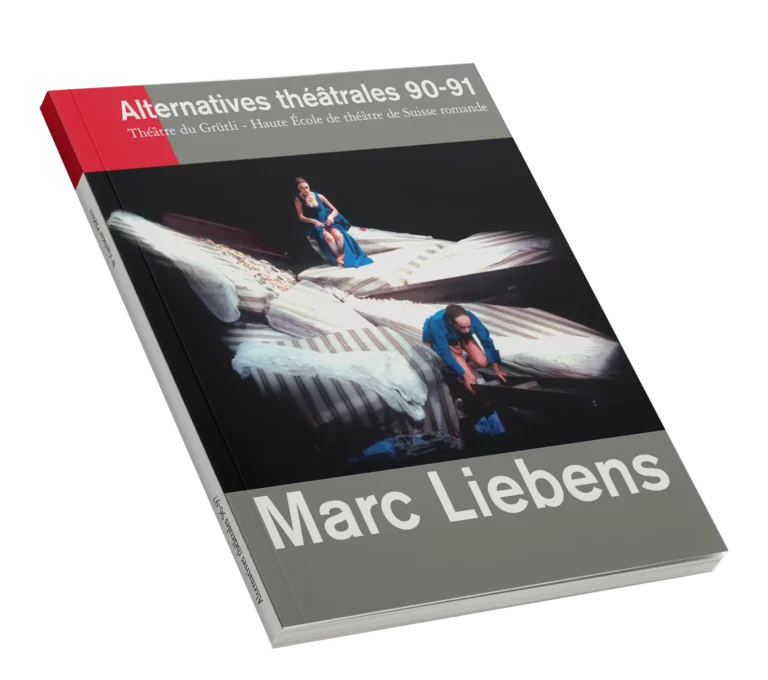Cette traduction des SEPT CONTRE THÈBES est bien sûr tout d’abord dédiée à Marc Liebens qui m’y a précipité, mais aussi aux acteurs et actrices ayant, du don de la pensée, la bouche. Je livre quelques fragments écrits, souvent à la hâte, durant le travail, mais c’est bien de cette hâte qu’ils me reviennent, à leur lecture, nécessaires :
Traduire ne consiste pas à tourner autour du pot mais à tomber dedans.
Traduire en rythme n’est pas encore traduire en souffle. Prendre la forme pour rythme, c’est vouloir corriger un bègue en l’obligeant à apprendre par cœur.
Passer en force quand l’image poétique est dite intraduisible n’est pas inventer mais ouvrir la porte de l’inconscient où l’image depuis toujours attendait d’être écrite.
En l’oralité, la tragédie va et vite. La langue le plus souvent va bourgeoise, lourde, grasse, comptable, de son savoir-pouvoir, langue pliée par le bourgeois lourd, gras, comptable en tournée électorale. Savoir-pouvoir affiché faute de savoir tenir compte du savoir perdu, du savoir caché, du savoir qu’au savoir on ne peut verser. Cette langue française si bien gelée au XXᵉ siècle… depuis on attend la fonte.
Traduire en poète, c’est avoir recours à la chair vive afin de ressusciter : entendre dans une langue morte l’immortalité du sens, c’est-à-dire l’écho des voix disparues qui la façonnèrent.
Le traducteur entre dans un édifice dont les trous de lumière ont été obstrués. Il les doit retrouver, les dégager, accueillir une lumière qui pour lui être étrangère n’en est pas moins la mère-lumière de sa connaissance, la mère-lumière revenue le toucher.
J’ai fait deux années de grec dans ma scolarité. Mon professeur, un vieux prêtre aussi pervers que méchant, nous enseignait la langue morte avec cette inébranlable foi de parvenir à nous faire croire en toute mauvaise foi que nous parlerions, un jour, couramment, le grec ancien. Lorsque je traduis, je n’oublie pas que je traduis une écriture mais lorsque cette écriture est destinée à l’oralité, je rappelle à moi les mots de Barthes : « Celui qui parle n’est pas celui qui écrit ; celui qui écrit n’est pas celui qui est. » Ceux qui à Athènes proféraient le texte d’Eschyle parlaient grec couramment, ils étaient des acteurs-poètes. Chez moi, l’acteur-poète qui parle couramment le français essaye d’être un traducteur-poète qui parlerait couramment de théâtre.
Retenir ces mots de Hölderlin dans la lettre à Bôhlendorf (4 décembre 1801), concernant le tragique grec : Mais ce qui nous est propre, il faut l’apprendre, tout comme ce qui nous est étranger. C’est en cela que les Grecs nous sont indispensables. Pourtant, c’est justement en ce qui nous est essentiel, national (c’est moi qui souligne), que nous n’atteindrons jamais leur niveau, car répétons-le, le plus difficile, c’est le libre usage de ce qui nous est propre. (…) Car ce qui est tragique chez nous, c’est notre façon de quitter tout doucement le royaume des vivants dans un quelconque empaquetage et non d’être dévoré par les flammes pour expier la faute de n’avoir pas su les dompter.
J’ai souligné le national qui, comme l’écrit Hölderlin, n’est ni la nation ni le destin des Allemands, mais bien ce qui nous est propre… notre façon de quitter…
Traduire, c’est fouiller l’humus.
Écrire, traduire… Ce que traduire induit de chance pour qui écrit, je crois, n’est formulable qu’en se plaçant en quelque sorte entre les chaises. Il me plairait de pouvoir énoncer cette chance. Peut-être : se voir penser ou pensé, à l’écoute de la voix de qui est parfaitement mort, ne serait-ce pas retourner le miroir de la mort contre le mur, n’écrire jamais qu’au cul de la prétention ? Le parfaitement mort partageant avec nous sa part.
Traduire est souvent passer en force, après jugement, décider. Somme toute, passer du kritiké au kritikos, du subjectif à l’objectif. La racine de ces deux mots grecs, la critique comme jugement et la critique au sens de décider de quelque chose, signifie crise. C’est par l’effet d’une décision que la réflexion entre en friction avec l’œuvre d’art qu’elle étudie et qu’elle crée une situation de crise où la vérité de l’œuvre peut apparaître.
Dans le travail de traduction, la crise est un saut qualitatif dans l’inconnaissance.
Je ne rêve pas d’une traduction spectaculaire qui produirait des effets snobs, je rêve de parvenir au seuil du sentiment vécu par l’un des premiers auditeurs-spectateurs d’Eschyle.
Le rythme est un travail d’horloger, une affaire de rouages, de poulies pour rester dans le domaine cher à Eschyle. Parfois, une petite poulie en entraîne une plus grande ou le contraire. De l’entraînement des mots, leur agencement, l’oralité apparaît ou disparaît. La description des boucliers faite par le Messager me pose ce genre de problème.
Je me rappelle que Miguel de Cervantès appelait la traduction un tapis à l’envers : on voit la trame, les couleurs, mais non pas la splendeur et la délicatesse des teintes et des contours.
J’aime, traduisant, me rappeler la légende de la mort d’Eschyle qui veut qu’un aigle prenant son crâne chauve pour rocher ait laissé tomber sur lui une tortue. Elle me dit que les mots comme des noix se doivent casser à l’aide de l’intuition et de la connaissance. La légende, en l’occurrence, célèbre la pensée du poète, la mort ouvrant son crâne terrestre au vent de l’avenir.