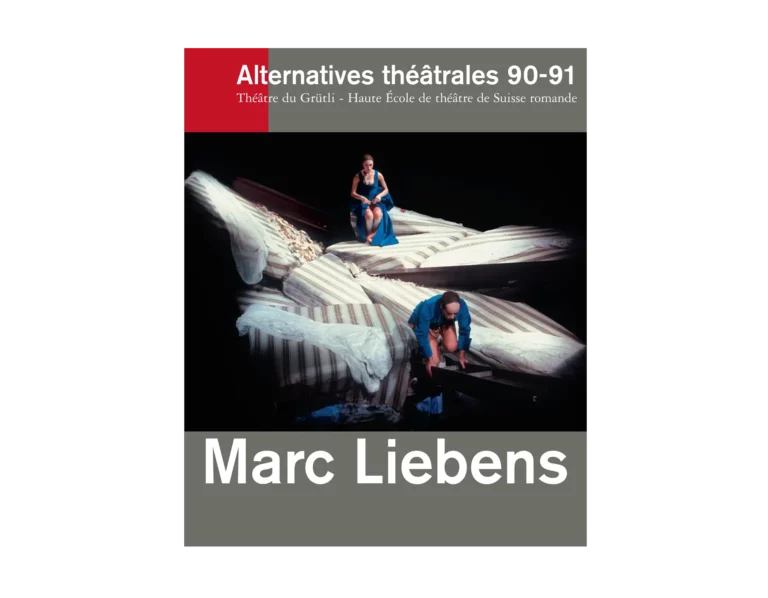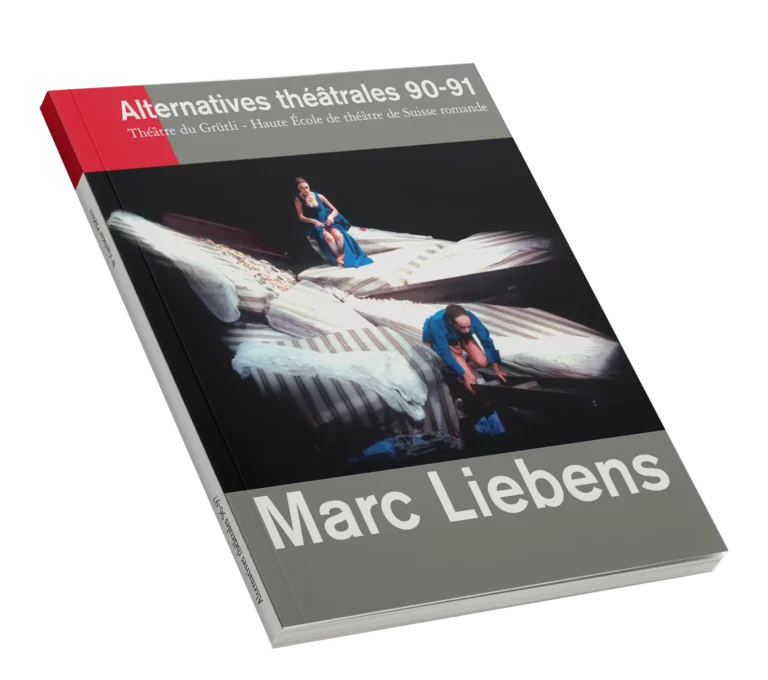Même s’ils sont de vieux complices, théâtre et photographie n’ont cessé de jouer un pas de deux plus ou moins mal accordé. Le premier n’est-il pas par essence fugace et mouvant alors que le second entend fixer ? Et même si c’est parfois pour y faire retentir indéfiniment une vibration, ce que Trivier recherche par exemple dans la lumière, comme dans les regards.
Cette contradiction, qui n’est pas sans renvoyer aussi à ce qui oppose par exemple en littérature roman-fleuve et poème bref, Marc Trivier entend la saisir et lui apporter une solution spécifique à un moment de son parcours où les portraits d’artistes, d’écrivains et d’aliénés1 font plus largement place à l’attention aux arbres et aux paysages, comme à la composition de livres dans lesquels le texte joue toujours, il est vrai, un subtil tempo avec l’image2.
Sa rencontre avec Marc Liebens et Michèle Fabien est certes antérieure. Trivier figure ainsi, notamment, dans le numéro de Didascalies3 élaboré par Patrick Roegiers et consacré à la photographie. Cet ouvrage se termine par un article de Chantal Meyer-Plantureux consacré aux photos de théâtre qui comporte un « petit lexique non exhaustif des photographes de théâtre ».
L’on sait d’autre part que Liebens voue à la photographie une passion très ancienne4. Très vite, entre Liebens et Trivier, quelque chose passe, qui touche à leurs esthétiques dépouillées comme à leur conception de la représentation ; qui concerne tout autant la distanciation et la violence critiques propres à une certaine forme d’art. Nous voici même propulsés, en un sens, dans le cercle des trois Marc, puisque je participe de la dynamique et que depuis, entre nous, « l’Autre » au téléphone désignera toujours celui des trois qui n’est pas en ligne.
Avec Michèle Fabien, quelque chose s’enclenche également, qui se dirige très vite vers une possibilité de conceptualiser, dans l’affection et la vivacité, ce qui se passe entre photo, scène et texte. Michèle songera même à une correspondance, comme elle l’avait esquissée avec Bernard Dort à propos des façons de repenser la représentation après Hamlet-Machine. Jaloux des secrets de l’art, les dieux semblent en avoir décidé autrement.
L’Atget et Bérénice5 de Michèle Fabien, créé à Arles le 11 juillet 1989 à la Maison de la Roquette, avec Jean Dautremay et Nathalie Cornet dans les deux rôles respectifs, voit Trivier se focaliser sur les signes de la représentation, non sur cette dernière : arbre sculpté à la Giacometti6, noué et élancé, au pied duquel, énigmatique, repose un fauteuil ouvragé et vide – celui dans lequel Trivier prendra toutefois et par deux fois le vieil artiste, son ancêtre7 ; et, une fois, la jeune Bérénice. Si l’une de ces photos d’Atget, celle où il est saisi de face – comme celle de Bérénice d’ailleurs – s’apparente à l’esthétique de Trivier filmant auparavant Ponge, Willems ou Van Velde, celle où l’on voit Atget endormi et de profil consonne avec une autre photo de cette série arlésienne, et qui concerne à nouveau l’arbre-sculpture. Celui-ci barre l’espace et paraît couvrir comme un fauteuil de pierre. Par le caractère tranchant de sa texture et de sa couleur – à l’instar du noir du costume d’Atget, mais en plus tendre –, il contraste avec le grisé un peu velouté et trouble des pierres du vieil espace dans lequel se sont déployés les mots de Fabien. Ce faisant, il accentue les enjeux de la lumière : elle constitue comme une vaste métonymie des cheveux du vieillard endormi.
Les objets de l’atelier (cadres, pendule…) sont par ailleurs saisis, à l’instar de ceux de l’atelier de Bacon filmé à Londres auparavant par Trivier – mais ici, c’est un Chardin ! – à la fois de près et en perspective. Dans cette photo, l’espace se focalise sur l’instrument d’Atget posé au centre, aussi svelte et monumental que les sculptures de Giacometti vues par Trivier : l’appareil photo sur pied, et le drapé sombre sous lequel se dissimulaient les photographes d’antan.
Trivier n’oublie pas de photographier par ailleurs, comme il le fera désormais, les deux acteurs à l’heure des préparatifs, ici dans le décor quotidien des Liebens. Il scelle ainsi, dans son travail de photographe-au-théâtre, une dynamique qui restitue le corps hors action, dans l’avant comme dans l’après. De la sorte, il cerne ce qui n’est pas le spectacle joué mais ce que l’image peut en restituer : comme signification foncière et donc comme mémoire qui continue d’intriguer. On ne parcourt pas rapidement les photos de celui qui choisit comme exergue à L’Épreuve des mots la phrase de Klee : « L’art ne représente pas le visible, il rend visible » ; on s’y arrête.
Plus tard, à l’occasion d’une nouvelle mise en scène de la pièce à Lausanne, avec André Steiger et Francine Bergé dans les rôles-titres, le principe de la photo conjointe des acteurs hors costume de représentation et des mêmes acteurs revêtus de leurs habits de lumière se confirme. Le pont, avec son balustre de fer forgé, devient le motif focal emblématisant la pièce. Racines tressées courant au ras du sol, le bois ligneux n’a pas disparu pour autant. Bérénice est debout (et non assise, comme sa consœur d’Arles), mains aux hanches à l’arrière. Elle paraît regarder, attendre et conquérir la vie, tandis qu’Atget, pris lui-même dans les dédoublements de sa cage de verre, tient cette fois l’appareil en mains.
Une synthèse toutefois, en outre… Car Trivier, désormais, va produire une image globale des acteurs à côté de l’image focale et des images dédoublées d’acteurs. Synthèse elle aussi dédoublée au sein même de l’image. La blanche et jeune Bérénice photographie en effet le vieil Atget vêtu d’un costume sombre. De la sorte, tout n’est-il pas dit ?
Entre-temps, Trivier s’est attaqué, en mars 1990, à une nouvelle mise en scène par Liebens de Oui8 de Thomas Bernhard9. Dans un décor somptueux et clos, tout de bois poli avec cheminée centrale et miroir encastré, des fauteuils profonds peuplent une pièce à laquelle on accède par une porte elle-même vitrée, découpée en petits rectangles. L’acteur, Patrick Descamps, s’y mire et s’y déplace ; s’y assied pensif ou interrogatif ; se tient debout, crispé et anxieux, comme l’est la Persane de Bernhard dont il module le très long et désespéré monologue. Mais, pour cette pièce-fétiche du parcours de Liebens, le jeu du double cher à l’œil de Trivier se porte directement au cœur de son questionnement puisque Liebens, assis dans un de ces fauteuils où s’installaient par ailleurs les spectateurs, dialogue avec Descamps, ou se laisse interroger par lui. Descamps est debout au centre de la pièce, la main gauche appuyée à l’oreille droite du fauteuil. Liebens est en vêtement clair, Descamps en peignoir sombre. Tous deux portent la barbe. Les Miroirs de Bruxelles ?
En 1991, Liebens triomphe au National avec Amphitryon10. André Baeyens, Marie-Luce Bonfanti, Nathalie Cornet, Claude Koener, André Lenaerts et Luc Van Grunderbeeck s’y donnent la réplique. Le programme renvoie, en couleur, aux Larmes d’amour de Chirico, à L’Annonciation de Fra Angelico ou aux Formes émíliennes de Carrache, mais aussi à des images en noir et blanc de Duane Michals tirées de The Fallen Angel. L’Extase de sainte Thérèse du Bernin leur fait suite, en noir et blanc toujours.
Pour ce spectacle, Trivier concentre son motif sur le lourd rideau de scène aux drapés dignes à la fois de la splendeur des Baroques et de l’exténuement moderne de Titus-Carmel. Drapés du spectacle et de la femme, drapés de l’alcôve et du plaisir, de l’au-delà et de l’en deçà des yeux… Il donne aussi à voir, bien évidemment, les six acteurs : en frac et alignés devant le rideau.
Superbe aussi – et cette fois Trivier innove : il va de l’autre côté du miroir – dans sa penderie, l’un des costumes masculins à l’arrêt : souliers rangés, pantalon à bretelles pendant dans son pince-pantalon, manteau reposant sur son cintre. Manteaux doubles ensuite, sur une autre photo, et sous un autre angle… on n’est pas pour rien entre Zeus et Amphitryon. Le côté loges donc, mais aussi, avec ces vêtements en attente, quelque forme de renvoi au plaisir des sens cher au maître des dieux comme à son rival.
Les loges, les voici en outre, et clairement. Et voilà chaque acteur s’y installant, s’y carrant même. L’appareil qui fut celui d’Atget se trouve à leurs côtés, mais fort diversement. Si Claude Koener s’y voit ainsi surpris entre des lumières indécises mais vives, tant à gauche qu’à droite, Nathalie Cornet, tout sourire sous ses bigoudis et devant ses lotions, se mire et se figure dans les lumières qui éclairent le miroir avec lequel elle ne se fond pas. Ces lumières, Trivier choisit de les faire clignoter sur la gauche du cliché-cadre.