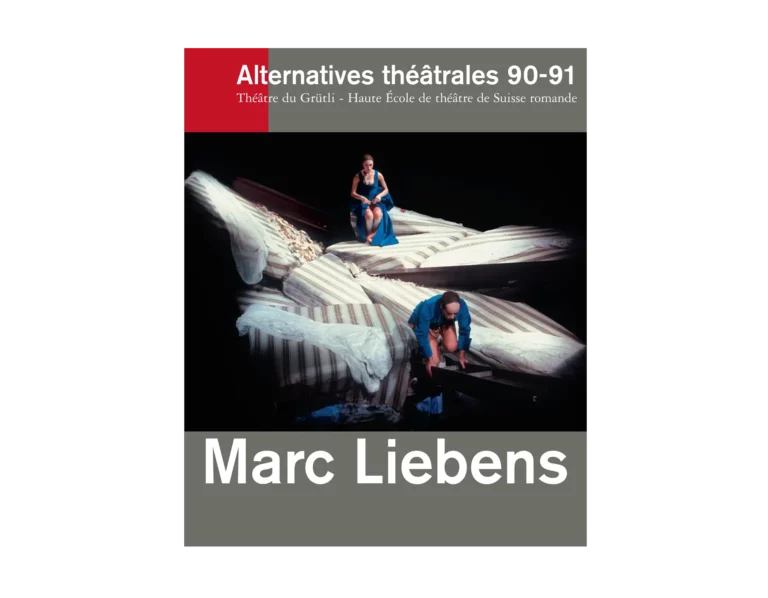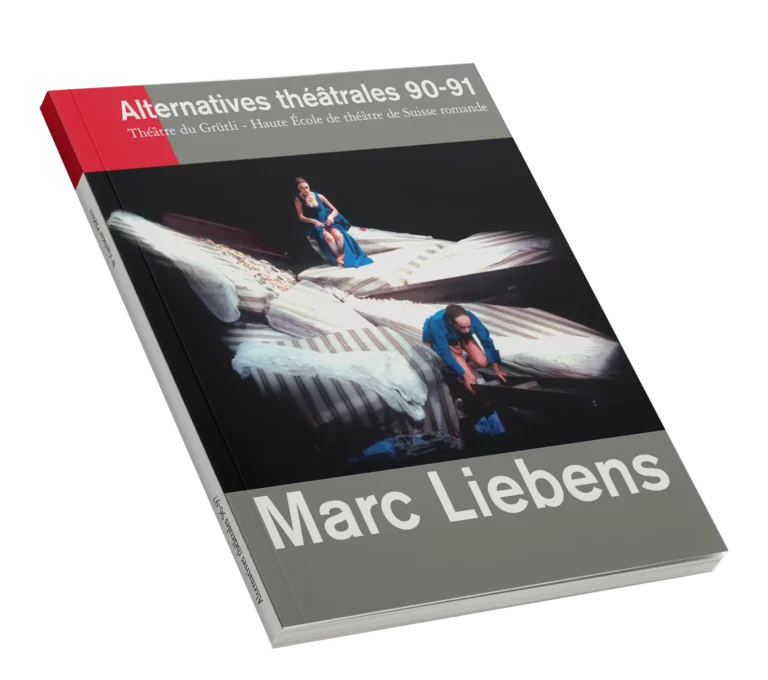À l’instar de Claude Étienne pour sa génération, qui l’accueille pour la mise en scène de l’adaptation des Paysans de Balzac en 1976 au Rideau de Bruxelles, à une époque très difficile de son parcours, Marc Liebens a constitué, pour le nouveau théâtre francophone belge — dont il fut l’un des principaux impulseurs à partir du tournant des années 60 – 70 — la référence la plus évidente mais aussi la plus complexe d’un théâtre de textes adaptés à la dramaturgie contemporaine. Au fur et à mesure de son évolution en compagnie de Michèle Fabien (1945 – 1999), Marc Liebens fut l’acteur et l’animateur d’une dynamique produite dans une singularité que l’on est en droit de rapprocher formellement de la rigueur classique. Ce qui veut dire qu’il avait bien évidemment rebrassé la notion même de texte dramatique.
De nombreuses adaptations de récits, initialement non destinés au théâtre, ont donc accompagné une petite quarantaine d’années de mises en scène exigeantes. Elles ont concerné des auteurs aussi essentiels que l’Autrichien Thomas Bernhard ou l’Allemande Christa Wolf, mais également des Belges. À deux reprises, Pierre Mertens : avec Les Bons Offices d’une part, et Une Paix Royale de l’autre. Choix judicieux autant que moments particulièrement significatifs — et du parcours de l’auteur concerné, et du mouvement culturel en Belgique. Car la mise en scène bruxelloise (en 1980, dans une cage de verre, rue de la Caserne) du roman de Mertens célébré par Régis Debray, Les Bons Offices (1974), se produit à l’heure de l’apogée de la belgitude, de l’évidence de ce que l’on continuait d’appeler le Jeune Théâtre, et du choc des manifestations littéraires liées à Europalia Belgique. Elle allait non seulement, et pour la première fois, amener autour du Théâtre Critique un René Kalisky (1936 – 1989) ou un Frédéric Baal, mais incarner à la scène, dans un dépouillement visuel qui accentuait la violence du propos et des situations, un récit liant une forme de « belgité » et l’état du monde à une théâtralité en prise avec la modernité.
Dix-huit ans plus tard, la mise en scène du roman de Mertens consacré entre autres au quatrième roi des Belges, dans un ancien cinéma vidé de tout son appareil — gigantesque espace de résonance — constitua sans doute le plus bel oratorio qu’on pût rêver pour une certaine idée du théâtre et du rapport d’un peuple à son histoire. Dans un lieu totalement réinventé par Marc Liebens et Michèle Fabien, le Marni, Janine Patrick incarnant Liliane de Rethy et ses comparses donnent à voir et à entendre, au sein de mouvements réglés comme un ballet, ce fragment essentiel d’une Histoire. On notera que, dans Une Paix Royale, le roi qui abdiqua ne parle pas mais est parlé. Requiem ? Nonobstant une adaptation1 un peu longue de ce texte-delta — à quoi ne saurait toutefois se circonscrire le problème du blocage —, le fait est que les noces de l’Histoire et de la Scène en Belgique, à un moment du monde marqué par l’apparent triomphe d’une mondialisation synonyme de non-Histoire, allaient se heurter aux effets mortifères de la haine postmoderne de l’Histoire. Haine qui ne fait que renforcer le vieux penchant belge à la « déshistoire ». Marc Liebens paiera très cher ce forçage d’un confortable tabou.
Certes, le metteur en scène d’Hamlet-Machine2 n’en est pas à sa première déconvenue de ce type puisque l’aventure novatrice du Théâtre du Parvis3 s’est achevée en 1973 par un autre coup de bambou des pouvoirs publics, totalement assassin cette fois-là. Certes encore, la première convention de l’Ensemble Théâtral Mobile, signée de confiance en 1984, se solda par la découverte d’un coup de hache dans la subvention négociée. Et l’on sait ce qu’il advint en 2003 de l’interruption brutale et univoque de son contrat-programme.
Sans doute ne fait-il pas bon, au pays de la négociation perpétuelle, de s’obstiner à vouloir occuper la posture critique de l’intellectuel. Et, pire, de vouloir l’inscrire au sein même de l’Histoire en marche et du travail des formes. Kalisky, dont le dessein peut à certains égards se comparer à celui de Liebens, même si ses façons de faire furent bien différentes, avait en son temps connu un rejet tout aussi constant et subtil4. C’est que les formes de cohésion sociétale de la Belgique sont bien plus profondes, fortes et subtiles qu’on ne le dit généralement, même si elles n’ont pas fait l’objet d’une analyse approfondie — si ce n’est à plaquer sur elles les modèles français, en la matière non pertinents.
Aussi, quand Marc Liebens s’attaque en 1982 à Lille et à Bruxelles — après qu’Antoine Vitez y a renoncé au profit de Falsch — à la pièce la plus osée du dramaturge, Jim le téméraire, pièce, soit dit en passant, qui noue plus d’un élément de l’histoire du nazisme et de l’Europe que l’on retrouve aujourd’hui dans le roman de Jonathan Littell Les Bienveillantes, assiste-t-on à un double barrage, et à des propos qui dérapent précisément dans la violence gratuite parce que le tabou est transgressé. Pensez donc ! L’esthétique critique et hiératique de Liebens appliquée à la pièce qui confronte, dans une étrange fascination, Adolf Hitler et un Juif plus au fait que les dignitaires du Reich de leurs propres façons de penser… Pire : l’insoutenable jeu de doubles, décalé et décalant, incarné par un seul acteur, Jim, lequel tient dans sa main droite la tête de cire du Führer.
L’histoire de la création des textes d’auteurs belges auxquels s’attache Marc Liebens pourrait par ailleurs constituer à soi seule un objet d’études et dérouler un fil rouge, significatif de son histoire et de la nôtre. Avec, bien sûr, au creuset, l’impact de la création mondiale en français, par ses soins, d’Hamlet-Machine, la pièce de l’écrivain est-allemand Heiner Müller. Cette création constitua une véritable révolution. Elle mit fin, en outre, chez Marc Liebens, à une certaine forme de prépondérance, dans les années 70, de la relecture dramaturgique si violemment dénoncée à l’époque par Kalisky. C’est cette mutation, à laquelle elle collabore, qui va propulser Michèle Fabien à la fois comme auteure emblématique et comme protagoniste d’un parcours d’une exceptionnelle cohérence — et cela, quelles que soient les apparentes dents-de-scie de la démarche créatrice du maître d’œuvre. Michèle Fabien a fort bien expliqué le choc et les conséquences de la création francophone d’Hamlet-Machine dans sa correspondance avec Bernard Dort publiée par Alternatives théâtrales sous le titre Tout mon petit univers en miettes ; au centre quoi5. La fin polie de quasi non-recevoir qu’y oppose Dort est logique. Cette révélation ne met-elle pas fin, de fait, au rite dont il est le grand prêtre ? Elle indique en outre une spécificité belge que la France a souvent du mal à accepter.
Au temps du Parvis6, Liebens avait certes métamorphosé Ghelderode par rapport aux mises en scène traditionnellement grimaçantes qui avaient servi — ou desservi — le dramaturge des Fastes d’Enfer. Liebens y touchait déjà à un hiératisme, quelque peu baroque toutefois, qui ne le lâchera plus, mais n’atteignait pas encore à cette modernité intériorisée qui allait, entre autres, le conduire, avec Michèle Fabien, à faire écrire un Faust à Jean Louvet ; et, qui plus est, à lui en faire composer deux variantes. Car, à côté de la version toujours quelque peu naturaliste qui caractérise la première version de ses drames, Louvet donne une autre version, plus scéniquement moderne, dont la version Didascalies d’Un Faust (1985) donne le parfait exemple7. La remarque vaut toutefois tout autant8 pour Conversation en Wallonie, dont la création à Tournai, en 1977, dans les locaux de la Maison de la Culture alors dirigée par Bernard Debroux, constitua un des nombreux chocs que nous réservèrent les années septante. Louvet, dont Liebens avait imposé le nom en 1972 avec la création au Parvis d’À bientôt, Monsieur Lang, fera désormais partie des référents majeurs du parcours de Marc Liebens. Il aura, par ailleurs, via Liebens — et nonobstant la résistance obstinée des grands théâtres belges ou français à le monter —, débouché en majesté sur la scène dramatique nationale et internationale. Louvet n’entend-il pas aussi lier forme, histoire et distance critique ?
C’est ce qu’à partir de la création de Jocaste, Liebens ne cessera de faire en outre pour Michèle Fabien.
Sa pièce-révélation n’est cependant point, il faut le rappeler, la première de son corpus — Notre Sade ou Sara Z, créées certes ultérieurement, ayant été écrites au préalable, comme Staline dans sa tête d’ailleurs9. À partir de 1981, l’aventure de l’Ensemble Théâtral Mobile et de Marc Liebens passe par la création régulière des pièces de l’auteure, qui vit non seulement à demeure dans l’équipe, mais en partage — et en inspire — les choix. Sans exclusive, on l’a bien vu. Le 195310 de Jean-Marie Piemme, créé en 1998 au Théâtre de la Place à Liège et joué ensuite au Théâtre National, constitue ainsi l’aboutissement d’une très vieille hantise de Marc Liebens : celle de voir écrire et monter une pièce consacrée au plus brillant des intellectuels que produisit le Parti Socialiste belge, Henri de Man, lequel se fourvoya notoirement en 1940. Marc Liebens avait tout autant souhaité voir naître un Horta… L’histoire réelle de sa démarche créatrice ne fera pas l’économie des œuvres non advenues ou encore à naître — Michel Gheude en sait quelque chose. Toutes ont à voir avec sa volonté d’interpeller le public sur son Histoire, au travers d’une forme épurée dont la seule marge de gratification, en conséquence, est la Beauté.
Marc Liebens est non seulement un incitateur, mais aussi un homme d’accueil et de traces. La collection Didascalies, créée en 1981 avec Michèle Fabien, accueille ainsi, outre des pièces de cette dernière, des textes de Paul Willems, de Jean-Marie Piemme, de Jean Louvet ou de Jean Sigrid. Elle réalise en outre la traduction française du Théâtre de Pier Paolo Pasolini, qu’il nous parut alors bon de proposer aux éditions Actes Sud afin d’en assurer une meilleure diffusion. Il n’est pas inutile de rappeler cette origine et ce travail, car les systèmes de diffusion et de production, et la mémoire qui en procède, tendent souvent à conforter les simplifications et les récupérations des logiques hégémoniques au sein des francophonies. Or, en la matière, ce qu’il convient d’interroger est, pour beaucoup, ce fait et sa logique au sein de la trajectoire de Marc Liebens. Une logique qui entend, à travers le texte, interroger l’Histoire dans les replis de sa plus grande violence. Cette logique concerne aussi bien le monde que cette Belgique natale que le metteur en scène entend sortir d’un ronronnement frileux qui la dispenserait d’affronter l’Histoire. Celle-ci, Michèle Fabien l’interpelle elle aussi, mais d’une façon plus introjectée, qui lui sera fatale11.