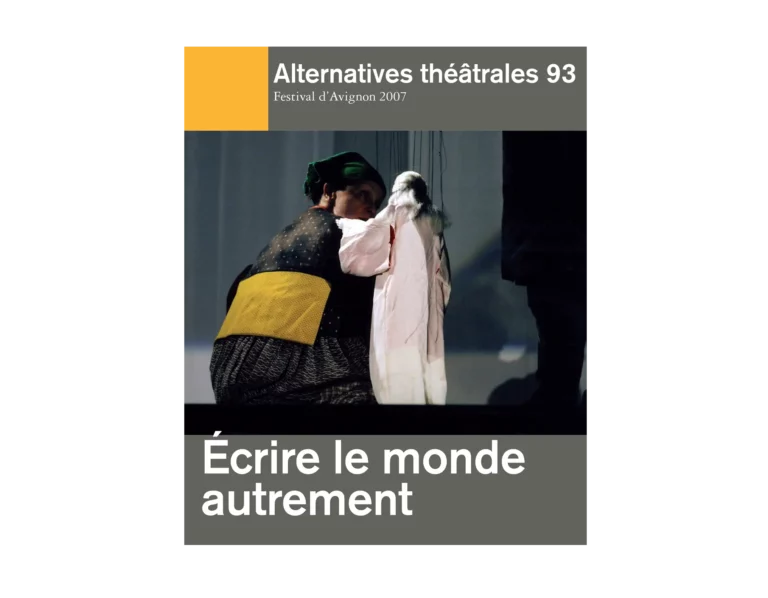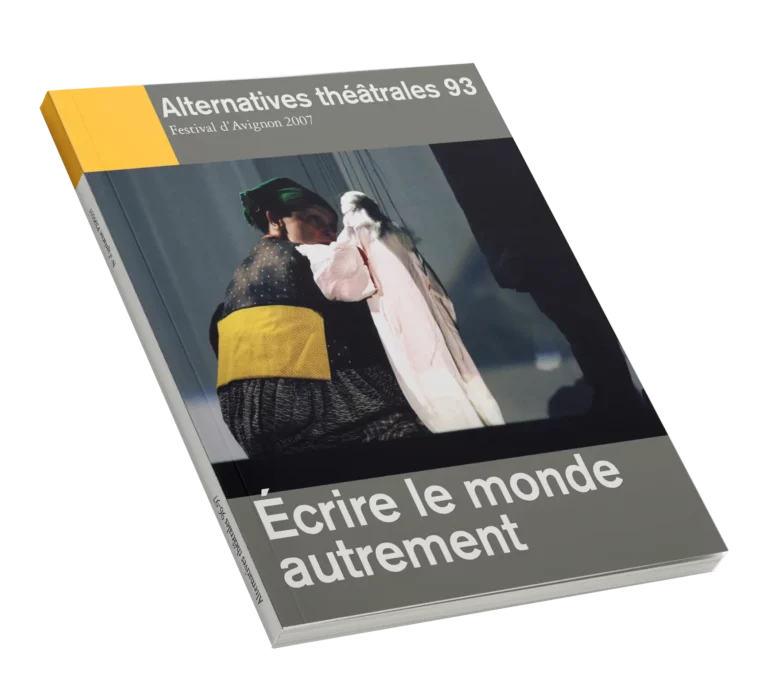Christophe Triau : Cela fait une dizaine d’années que tu fais de la mise en scène, et comme tu as pris, en compagnie de Robert Cantarella, la direction du 104 à Paris, tu te trouves à la veille d’un temps où tu n’en feras pratiquement plus. Avec le recul, comment analyses-tu ton parcours ?
Frédéric Fisbach : Il m’est difficile de partir du moment où j’ai débuté la mise en scène, parce que mon parcours de théâtre a commencé plus tôt, il y a une quinzaine d’années. J’ai été acteur dans une aventure bien spécifique, celle de la compagnie Nordey, travaillant sur un répertoire contemporain. Puis il y a eu un moment de bascule : j’ai eu envie de continuer autrement, et cet autrement est devenu la mise en scène. J’en avais déjà fait, mais « dans les coins » : de toutes petites formes, des spectacles pour enfants, des spectacles à installer partout, des travaux qu’on ne revendique habituellement pas beaucoup mais qui, moi, m’intéressaient. Passer à la mise en scène, même si cela peut sembler être une rupture, était donc une continuité. Cela ne voulait plus dire grand chose pour moi de continuer à jouer, j’étais allé au bout de mon aventure au sein de la compagnie Nordey, j’avais vécu ce que j’avais à y vivre, et j’avais envie de repartir sur quelque chose de neuf, que je connaissais sans connaître : la mise en scène, et donc, surtout, la mise en place de projets. Car c’est quand même cela qui, pour moi, est essentiel, c’est ce qui donne une cohérence à mon parcours de metteur en scène, si le répertoire n’en donne peut-être pas. Il s’agit toujours de mettre en place des projets ; pas seulement des projets de mise en scène, mais se demander ce qu’on se donne à vivre pendant plusieurs mois (généralement autour d’un texte, puisque je pars toujours de cela), et réunir un certain nombre de personnes autour de cette question. Ce qui m’intéressait, c’était l’idée d’aventure, d’un temps singulier qui ne serait pas un temps de reproduction d’une chose déjà connue, déjà traversée, mais un temps de découverte, de curiosité… « Pour la première fois ».
C. T.: Ce « qu’est-ce qu’on se donne à vivre, à partager », passait-il par la question : « avec qui ? »
F. F.: Bien sûr, car derrière tout cela il y a évidemment d’un côté la question du spectateur (puisque tout cela n’a qu’un but, c’est d’aller alimenter le spectateur, l’amateur de théâtre, d’art), et de l’autre celle des interprètes avec lesquels je travaille. Souvent, même, j’ai co-réalisé les projets : Bérénice, mais on peut dire aussi que Les Paravents est une co-réalisation avec la compagnie Youkiza. La position du metteur en scène – qui est souvent une position d’isolement –, je l’ai fréquemment partagée avec d’autres, avec bonheur.
C. T.: Il y a souvent un élément externe à ton identité artistique qui détermine la nature du projet. L’Annonce faite à Marie convoquait des amateurs (même s’ils n’étaient pas au centre du spectacle, leur présence en décalait la nature); Tokyo notes, même si dans le résultat final il n’y avait pas tant de Japonais que ça, est un projet qui s’est fait avec le Japon ; Bérénice a été conçu avec Bernardo Montet, et donc la danse…
F. F.: La mise en scène, c’est de la mise en rapport. Et il y a aussi un parcours intime qui se fait à travers cela ; il y a un désir, qui se travaille, puisque le désir, y compris celui de faire de la mise en scène, n’est pas quelque chose de donné une fois pour toutes. S’il n’est pas réactivé au contact de l’autre, il tombe, forcément. Et en ce qui me concerne, ce désir est vraiment celui de se mettre au travail. Or souvent, l’étranger, l’inconnu, m’excite plus – ou différemment – que le connu, le familier. Il y a donc toujours au moins un autre. Ce peut être des interprètes, mais souvent il y a encore une chose en plus : aborder Les Paravents avec l’art japonais de la marionnette (et la séparation œil/oreille qu’il implique), aborder Bérénice par le corps (et pas n’importe quel corps, mais un corps travaillé, écrit, par Bernardo Montet et ses interprètes), etc. C’est un peu différent pour l’opéra, où il s’agit plus de commandes, mais cela peut y ressembler : pour Forever valley, en retravaillant entièrement le livret avec Marie Redonnet, cela a été le désir de rencontrer l’auteur et de faire une adaptation à notre main, à Gérard Pesson et à moi, en incluant cet autre que je ne connaissais pas, pour éclairer une œuvre qui n’existait donc pas encore. À l’exception d’Agrippina, j’ai d’ailleurs toujours mis en scène des opéras qui n’existaient pas, puisqu’ils n’étaient pas encore composés au moment où j’ai accepté. Et quand j’ai accepté de faire Shadowtime, c’était aussi parce que j’avais envie d’aborder Benjamin, auquel je ne comprenais rien, à travers le regard de Bernstein (le librettiste) et de Ferneyrough. C’était aller vers quelque chose que je ne comprenais pas, via des compères que je ne connaissais pas plus mais qui me donnaient un point de vue pour y entrer.
C. T.: Tu dis qu’il y a eu des ruptures, que ton parcours est fait de périodes qui se succèdent et, en même temps, qu’il y a toujours eu une continuité…
F. F.: On peut distinguer deux choses : tout d’abord, on a tous une économie particulière de l’existence, qui fait qu’on est plus ou moins « entreprenant » – il se trouve que je le suis beaucoup –; et puis il y a mes goûts, le fait que j’évolue depuis des années et ai toujours voulu évoluer dans l’art. Cela aurait pu être une autre pratique, mais c’est passé par le théâtre pour différentes raisons : la mise en jeu du corps, dans une écriture textuelle, la rencontre avec les spectateurs, le sentiment de pouvoir éprouver la rencontre avec l’autre de façon concrète.
Mais cet esprit « d’entreprise », le désir de proposer des projets, je l’ai toujours eu : je continue le chemin, cela prend simplement d’autres formes. Non pas que la question de la mise en scène soit épuisée pour moi, mais j’ai toujours eu la bougeotte, et je me dis que beaucoup d’endroits restent à découvrir. Je ne me suis jamais vécu comme quelqu’un qui ferait la même chose toute sa vie. Quand j’étais acteur, je savais très bien que cela n’aurait qu’un temps, quand j’étais metteur en scène de même, et aujourd’hui que je participe à un autre projet, je sais très bien aussi qu’il y aura autre chose après, et que c’est tant mieux. C’est un parcours : c’est la même personne qui se construit. Une œuvre est constituée d’actions et de silences, d’action et d’inaction : Genet arrête d’écrire pendant six ans, puis pendant vingt ans – plus précisément, il arrête de publier, d’apparaître comme artiste. Peut-être que, d’une certaine manière, je continue à chercher l’endroit où je serais pleinement en possession de mes moyens, et l’endroit d’où je pourrais parler de ce qui constitue le monde dans lequel je vis aujourd’hui, le représenter, le questionner… De plus en plus, se pose aussi pour moi la question de la place de l’art – pas forcément de ma petite création à moi – dans le monde présent : en quoi c’est important, nécessaire, en quoi cela aide à vivre. Il s’agit alors de se mettre à l’épreuve du réel ; d’aller au contact, de comprendre, de découvrir des choses que je ne connais pas…
C. T.: Une des fonctions de l’art serait qu’il puisse nous aider à réinvestir nos vies, le réel ?
F. F.: Comme metteur en scène, j’essaye de travailler sur les modes de la représentation, puisque je pense que la question de l’art est toujours liée à la question de la représentation. Comment on travaille, quels signes et quels agencements de signes on choisit, qui redonnent au spectateur un espace de jeu, un espace qu’il peut investir par sa compréhension – d’une certaine manière par son talent d’interprète, lui aussi –, pour en comprendre quelque chose dont il peut avoir le sentiment que c’est universel, et donc partagé ou partageable, mais qui n’est pas forcément exprimé comme tel sur le plateau. Il y a donc un écart : en représentation, j’essaye d’ailleurs de créer un écart entre l’émission (pour être prosaïque : la volonté de « faire passer ») et ce qu’on entend. On sait bien que ce n’est pas forcément en essayant de bien faire passer que l’on fait le mieux entendre, mais qu’au contraire c’est parfois en étant en apparence extrêmement fermé dans l’interprétation qu’on suscite une écoute polysémique. Il s’agit donc d’un travail à l’intérieur de la représentation. Pour cela, j’ai besoin d’un certain type de spectateurs : il y en a qui fonctionnent comme cela et d’autres non… D’une certaine manière, en prenant la co-direction d’un lieu qui s’invente, j’essaie peut-être d’élargir le cercle de ces spectateurs-là. À l’intérieur d’un lieu qui a sa singularité – un lieu de passage, qui accueille des artistes qui eux-mêmes accueillent des spectateurs pendant le temps où ils sont en train de créer –, j’essaye de susciter des curiosités et des compréhensions par rapport à la question de la représentation, de l’art contemporain ; de faire que, peut-être, des gens, face à des œuvres abouties, les envisagent un peu différemment. Le rapport à l’art contemporain est extrêmement compliqué, parce que c’est un art qui évolue sans aucun repère ; on ne peut donc s’en remettre qu’à soi-même – et c’est difficile, lorsque tout le temps on nous demande l’inverse. Être face à quelque chose qui nous échappe et se faire confiance, se dire qu’on est capable d’en profiter : pour vivre mieux, exercer sa liberté, son regard, ses facultés singulières de voir le monde – à sa propre façon et pas « à la façon de ».
C. T.: D’un côté, c’est un principe d’appropriation, et de l’autre c’est aussi une rencontre avec l’étranger, avec l’autre… Cela passe par une familiarisation, mais tout en devant garder quelque chose de l’altérité – pour qu’il s’agisse réellement d’une relation esthétique, dialectique, tendue. Cela rejoint d’ailleurs ce que tu dis sur l’adresse au public : qu’il ne faut pas s’y soumettre complètement pour qu’il existe une cohérence, une existence presque autonome de l’œuvre (qu’elle ne se réduise pas à un produit). Comment lies-tu cela à ta volonté constante, à Vitry comme au 104, de montrer le processus de création au public ?
F. F.: À Vitry c’était différent, parce que montrer le processus, cela amène aussi de créer autrement ; les propositions sont forcément transformées par le fait qu’elles se sont ouvertes à d’autres à un moment donné – dans des moments de fragilité, de recherche…
Pour les spectateurs, cela peut être une façon moins impressionnante d’entrer en rapport avec l’art contemporain, même s’il ne s’agit pas de leur donner un mode d’emploi. Il s’agit de créer des occasions de mise en rapport avec la création, autres que la seule représentation ou exposition ; de multiplier les surfaces de contact, pour essayer de dédramatiser ce rapport. Quand j’avais travaillé sur Maïakovski, ce qui me passionnait dans le projet des futuristes russes, c’était le désir de mettre l’art dans la vie, en allant même jusqu’aux objets du quotidien… Même si ce sont le marketing et le packaging qui ont repris cette idée, elle demeure juste. La question de l’art est liée à la question de l’art de vivre. C’est la même question de la liberté, du choix de son mode de vie en dehors de toute forme préétablie.
C. T.: Ce spectacle sur Maïakovski, Un avenir qui commence tout de suite, en 1997, a‑t-il été important dans ton parcours ?