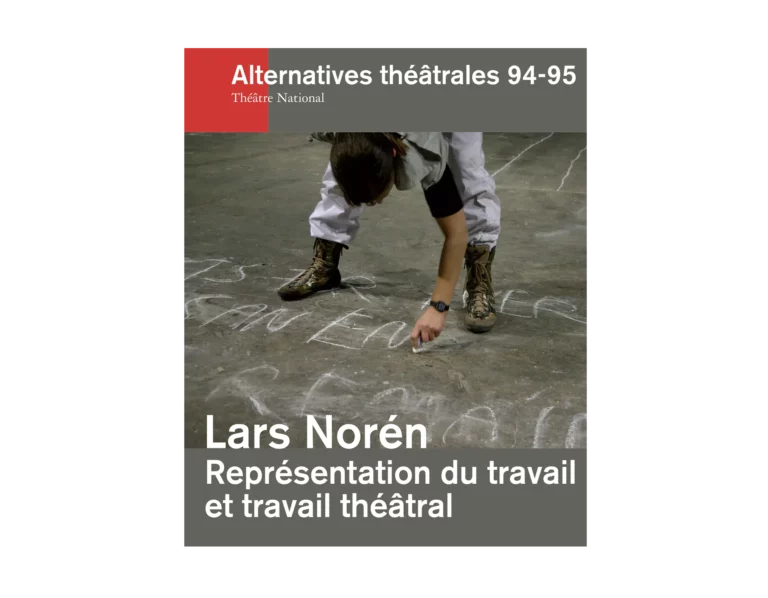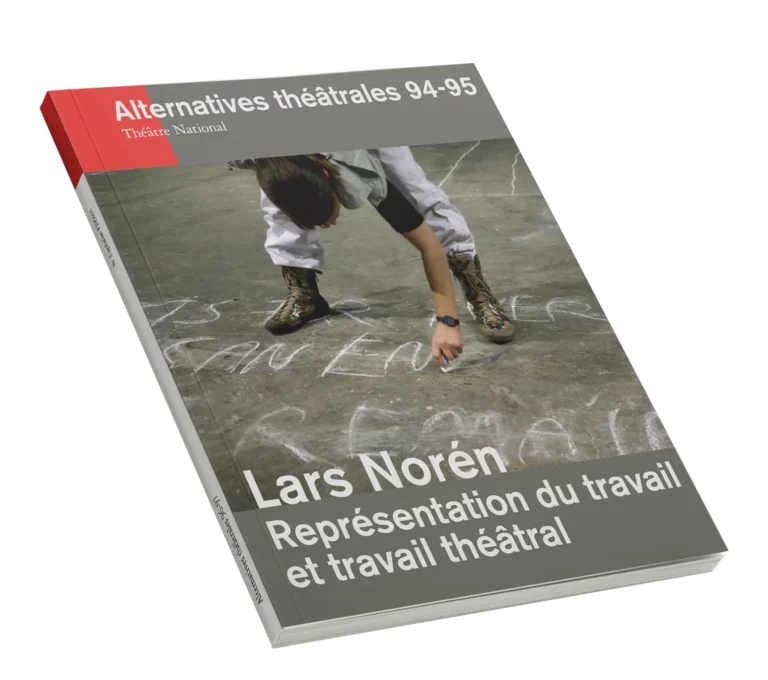Soit ACTE, la pièce de Lars Norén (L’Arche, 2003). Nous sommes presque à la fin, quand le personnage masculin dit : « Je crois que Dieu est en moi en ce moment. Je crois que Dieu parle à travers moi en cet instant quand j’accomplis ma dure mission. En Dieu je n’ai aucune liberté. Celui qui croit en Dieu ne peut faire que ce qui est bien et juste. C’est pour cela que nous ne douterons pas et que nous ne serons pas dévorés par les scrupules. » Celui qui parle s’appelle Mikaël Gott, un nom qui dit bien ce qu’il veut dire. Quand il s’agit de désigner la réplique de son personnage, l’auteur met pourtant un simple « G » comme s’il voulait lui donner quelque chose de moins pesant mais aussi de moins individuel, désigner en lui une dimension plus neutre, plus générale, qui excède l’identité singulière.
« G » dit qu’il croit en Dieu et que cela ne lui donne aucune liberté. « G » est pour ainsi dire prisonnier de Dieu. C’est un prisonnier heureux, il occupe une prison qui le rassure, une prison où les frontières du bien et du mal sont marquées, affichées, évidentes. Évidemment, « G » ne dit pas, ne pense pas, n’imagine pas une seconde qu’il est en prison. Il vit sa prison comme une liberté. Il vit dans la méconnaissance de ce qui le fait vivre. Néanmoins, ce qui est refoulé, non-vu, ne l’est jamais complètement. Çà et là, quelque chose remue qui signale que tout n’est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et la façon dont Lars Norén conçoit le personnage nous le fait savoir.
« G » est un médecin qui travaille dans un cadre judiciaire. Au début de la pièce, il se tient silencieux face à une femme désignée par la lettre « M ». Qu’attendent-ils l’un et l’autre ? La femme est une terroriste incarcérée depuis de nombreuses années, elle est chez ce médecin pour une auscultation de contrôle. Que faut-il contrôler ? Sans doute l’état de santé de la détenue. On peut en inférer que cette « patiente » est recluse dans des conditions spéciales, particulières. Un détenu politique est infiniment plus dangereux qu’un détenu de droit commun. La faute de droit commun ne menace pas la loi. L’acte terroriste oui. L’acte terroriste n’est pas un accroc à la loi, mais sa négation. À ce crime exemplaire, il faut une punition exemplaire : une destruction lente qui désagrège l’individu sous le couvert d’un enfermement démocratique. Bref, il faut pratiquer un usage de la démocratie que la démocratie devrait réprouver si elle était totalement la démocratie. On n’en est hélas pas là. Le terrorisme et la répression dont il s’agit n’ont pourtant rien à voir avec Guantanamo.
L’action de la pièce se passe en 1992. L’emprisonnement dont il s’agit remonte à un acte commis près de vingt ans plus tôt. Le terrorisme dont il est question s’est manifesté en Allemagne, c’est le terrorisme de la bande à Baader et Meinhof, le terrorisme de la Rote Armee Fraktion, que l’État allemand a combattu avec des méthodes « démocratiques » de privation sensorielle:cellules blanches, allumées jour et nuit, entraves au sommeil, etc. La pièce y fait allusion : « M : Nuit et jour. Année après année. Toujours. Elle éclaire toujours.Elle ne s’éteint jamais. Il ne fait jamais noir. Jamais. Il y a toujours de la lumière. Tout le temps. Vous comprenez ? » Et plus loin : « M : Il n’y a pas de sons ici. Pas de sons. Pas du tout de sons. Je voulais entendre des sons. » Et « G » sera plus explicite encore sur les effets d’une détention dans pareilles circonstances : « G : Il est aux chiottes pour le moment. On appelle ça les chiottes parce qu’on y place les personnes tellement traumatisées par leur situation en isolement total qu’elles ne peuvent même plus retenir leurs excréments. Elles ont complètement perdu le contrôle de leurs fonctions physiques et psychiques. »
« M » s’est peut-être engagée dans une grève de la faim (ou de la fin). En tout cas, elle ne s’alimente plus depuis cinq jours. Elle reste offensive néanmoins, provocante, personnellement et politiquement. « Pensez-vous que je suis jolie » dit-elle, comme pour installer avec le médecin un rapport qui parodie l’expertise, mais qui en fait en brise le mouvement et la prétendue objectivité. Et aussi : « Avez-vous été là-bas (à Auschwitz) […] Pensiez-vous que c’était propre et bien […] assez bien organisé dans l’ensemble […] compte tenu des circonstances ? » Elle pose aussi au médecin des questions personnelles. « Qui êtes-vous ? », demande « M » à « G » à la première page, et « G », qui s’est déjà présenté comme médecin, répète les mots « médecin », « docteur en médecine », « diplômé ». « M » comprend toutefois immédiatement que ce n’est pas la réponse à la question posée. Ou plutôt que, au qui êtes-vous, « G » répond par la nomination à plusieurs reprises de sa fonction. On attendait un homme, on a une fonction. « G » n’est pas seulement prisonnier de Dieu, il l’est aussi de sa fonction.
Du fond de son état de délabrement physique et psychique, « M » va fonctionner comme analyseur de cette fonction. Sous la maîtrise de l’expert, elle va faire apparaître le grouillement du trouble. Elle va faire voir que l’ordre n’est l’ordre qu’à la condition d’enfouir le désordre, de le refouler au-delà d’une ligne de visibilité. Après avoir cité le nom d’Auschwitz, « M » dit du médecin qu’il ne lui manque que l’uniforme, puis interrogeant le médecin sur son père, elle fait clairement apparaître la fonction médicale comme une fonction de mort et non de vie. « Je n’ai pas demandé quand il était mort (dit « M », parlant du père médecin de « G » ). J’ai demandé où ses patients étaient morts (sous-entendant qu’ils sont morts dans un camp). »
« M » est une traductrice en somme, elle ramène l’apparente innocence du langage d’expertise à des enjeux infiniment plus troubles. Elle fait entendre un terrible non-dit sous les apparences d’un dit inoffensif. À ses propres yeux, le médecin n’est qu’un honnête démocrate qui se tient à distance du nazisme, qui récuse cette idéologie. « C’est un devoir moral de s’informer de leur travail et du prix qu’ils y attachaient », dit « M » à « G », parlant du travail du père de ce dernier, et lui glissant du même coup une savonnette sous le pied. Et « G » reprend la balle au bond : « Évidemment. En général. Tout à fait. C’est aussi mon avis. Nous devons tirer des leçons de l’histoire, du passé. Si nous ne savons rien sur notre passé, nous avançons forcément à l’aveuglette. C’est évident. Personnellement, je n’ai pas eu la possibilité d’approfondir le passé autant que je l’aurais souhaité, ma formation en médecine et une vie de famille avec deux enfants à éduquer, et ce genre de chose ont pris tout mon temps en somme. Le temps manque tout simplement. »