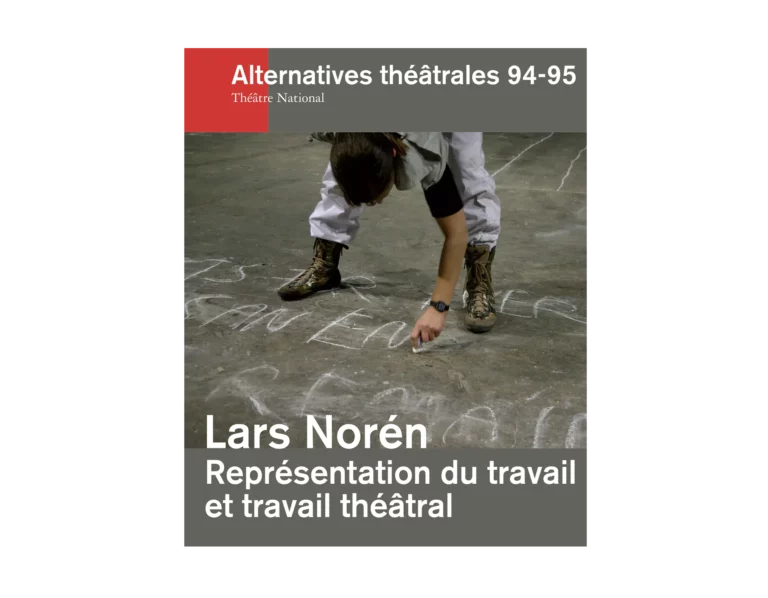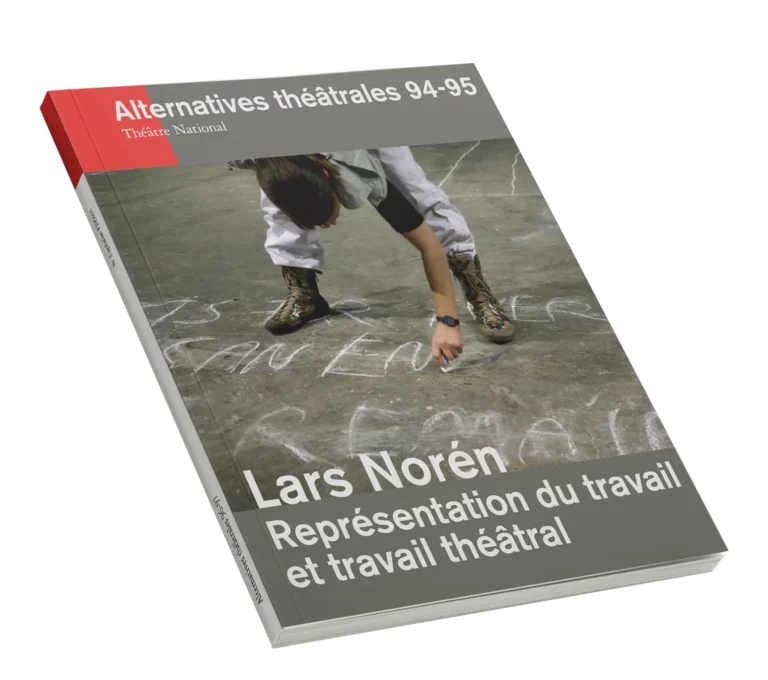Falk Richter met en scène sa pièce Sous la Glace
Une longue table noire, brillante, qui occupe toute la largeur de la scène. Trois micros, des chaises, et à l’arrière-plan, la démultiplication d’une atmosphère de bureau : sur l’image projetée, qui paraît haute comme un immeuble, des vitres d’une façade de bureaux ; on devine les ombres abstraites de tables inoccupées, une fois la journée de travail terminée. Au premier plan prennent place deux jeunes hommes et un plus âgé, seules sont différentes les rayures de leur chemise et la couleur de leur cravate. Le costume est leur uniforme. La scène est plongée dans une froide lumière bleutée, un bourdonnement croissant, puis les battements d’un cœur donnent le ton. Paul Niemand ( Paul « Personne » ) parle : Paul Niemand a passé la quarantaine. C’est maintenant son enfance qui refait surface. Et pourtant Paul Niemand est quelqu’un qui est tourné vers l’avenir.En proposant à la Schaubühne de Berlin, en 2003- 2004, un cycle de mises en scène intitulé Das System, Falk Richter, auteur et metteur en scène, n’envisageait rien moins qu’une vaste description des structures de la société post-industrielle et des rapports de pouvoir qu’elles entretiennent entre elles1. Il s’agissait de cerner ce que les politiciens appelaient, après le 11 septembre 2001, our way of living : un mode de vie qu’il fallait, selon George Bush, défendre contre l’Irak avec les moyens de la guerre. Une devise par laquelle le Chancelier de l’époque, Gerhard Schrôder, justifiait l’envoi de soldats allemands en Afghanistan : notre « manière de vivre » devait être protégée face à l’Orient. Mais qui définit ce « nous » collectif, qui définit ce qu’il y a de commun à tous dans un mode de vie dont la défense justifie tous les moyens ? Quelle forme d’existence détermine ainsi une pensée dominante, discernable aujourd’hui dans une sorte de durcissement affirmatif des sociétés occidentales ? Dans le contexte de la politique internationale depuis 2001, l’orientation dans une telle analyse de la société est redéfinie. Le projet de recherche que Falk Richter développe au sein du théâtre par le biais de travaux divers, de textes dont il est l’auteur mais aussi de mises en scène d’autres auteurs, reflète cette redéfinition : l’accent est mis sur les médias, l’économie, la terreur et la guerre2. Et ceci dans la position d’un observateur conscient dès le départ qu’il est partie prenante de cette société de consommation — et dans le cas de Richter du système global du fonctionnement théâtral. La conséquence ? La faillite déclarée d’une définition claire des positionnements. Une méfiance fondamentale vis-à-vis des explications idéologiques et des convictions d’ordre politique3. Une implication complexe dans les structures de pouvoir et les groupes d’intérêts, conçus comme un système à l’intérieur duquel chacun se meut avec des arguments recevables et en pleine conscience de sa propre relativité. Il ne peut donc s’agir, dans la série d’expérimentations théâtrales développée par Falk Richter, de représentations claires de « l’ennemi ». Mais comment la tentative d’une analyse globale du système peut-elle se raconter sur la scène ? Pourquoi le théâtre, là où la culture occidentale de l’écriture et de la lecture utilise traditionnellement l’essai ? Paul Niemand est consultant. Sa vie toute entière est vouée à l’entreprise, à la réussite, au progrès tel que le définit l’économie capitaliste. Il a été celui qui rationalise et qui structure, pour qui le remède universel était le filtrage des forces dites improductives, arrivées au terme de leur développement. Maintenant, tout comme le lourd corps du comédien Thomas Thieme est assis derrière la grande table, Niemand n’est plus celui qui résout les crises. La crise l’a rattrapé car il sent que ses forces l’abandonnent. Ceux qui vont lui succéder attendent déjà devant la porte, il aura bientôt joué son dernier atout, celui de l’expérience. Paul Niemand le sait. Conformément à la logique de sa profession et de sa vie, il va être supprimé, car il n’est plus en mesure de devancer les jeunes loups. Au début, un monologue donc : car le consultant Paul Niemand connaît la solitude comme une des données fondamentales de son milieu. Le travail remplace la famille, le mérite, par manque de temps libre, demeure un plaisir abstrait, les hôtels remplacent le chez-soi. Et l’individualiste Paul Niemand ne perçoit la réalité de sa propre existence que lorsqu’il entend son nom que l’on appelle à l’aéroport, tandis qu’il fait attendre les autres passagers à l’embarquement. Avec les crises de panique, ce sont aussi les souvenirs d’enfance qui le rattrapent : son père, qui régule la circulation des avions sur le tarmac, perd tout sens de l’orientation, indique de mauvaises directions, et sa propre défaillance conduit à la catastrophe. Ici disparaissent déjà dans le texte de Richter les niveaux distincts de la réalité et de la perception paranoïde, du souvenir et du symbolisme cauchemardesque. Dès le départ, le froid domine aussi l’imagination de Paul Niemand : la neige, la glace, le gel, l’engourdissement, sont les motifs récurrents des visions apocalyptiques par lesquelles se manifestent ses peurs. Dans l’image d’un chat que l’on a tué, figé dans la glace au moment de son agonie, culmine le tableau d’une période glaciaire. Thomas Thieme, un des grands comédiens du théâtre allemand, bouge très peu, comme toujours. Son drame se joue dans une voix qui évoque non seulement chutes et tentatives de repartir mais, par son rythme effréné, trahit aussi la perte de contrôle de l’exécutant insensible. À peine ce monologue intérieur a‑t-il développé une dynamique propre que surgit la réalité — celle des consultants en tout cas — avec son propre langage.Les jeunes prennent la parole avec les mots d’ordre qui définissent leur vie. Ils font irruption dans le monde intérieur du vieil homme, porteurs d’une langue exempte de tout sentiment.