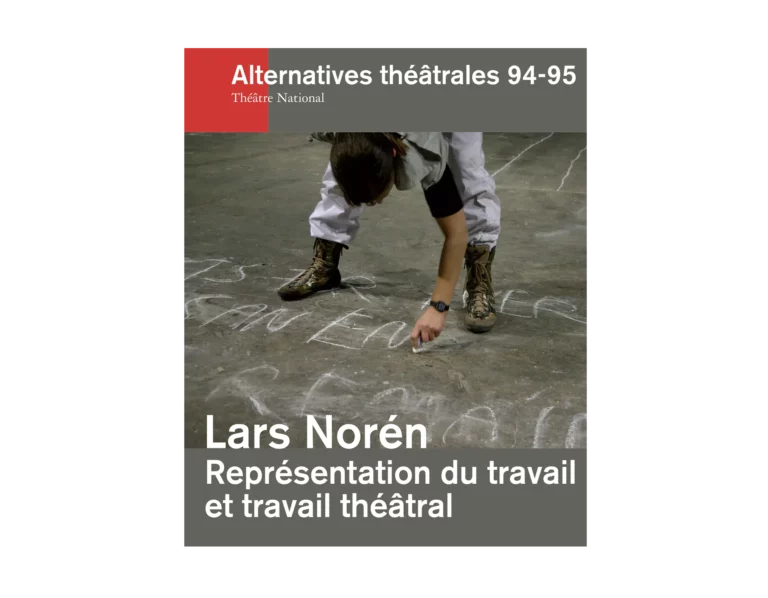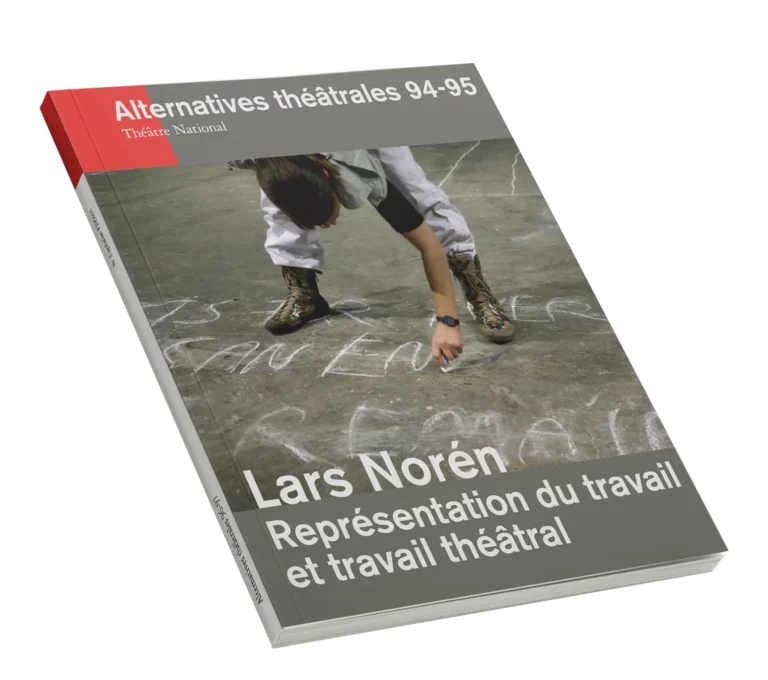Depuis quelques années, la scène italienne engendre des prises de position esthétiques et politiques qui amènent plusieurs compagnies au premier plan de la recherche et de l’expérimentation. Les festivals internationaux avaient familiarisé le public avec les outrances et la provocation dans lesquelles se coulait — jusqu’à la posture parfois — la volonté subversive de créateurs allemands tels Castorf, Pollesch ou Ostermeier. Ils avaient consacré l’effroi créé par la quête paroxystique de certains dramaturges anglo-saxons comme Bond et Kane. Avec Roméo Castellucci, Emma Dante, Pippo Delbono, Ascanio Celestini, Fausto Paravidino entre autres exemples, c’est à une multiplicité de gestes créateurs singuliers que nous sommes confrontés. Il s’agit là d’un renouvellement de l’expression théâtrale longtemps marquée par quelques grands noms— dont Dario Fo, Carmelo Bene et Eduardo de Fillipo —qui occultaient difficilement un paysage théâtral consacré à la relecture des classiques, du répertoire. Selon Franco Quadri, relayé par de nombreux praticiens dont Mario Martone, la raison de cette situation est à chercher du côté d’un certain figement des grandes institutions peu enclines à déconcerter leur public. Le lien étroit aux pouvoirs publics subsidiants constitua évidemment un autre facteur d’immobilisme lorsque ces pouvoirs tombèrent à presque tous les niveaux aux mains de la droite berlusconienne. Dans ce contexte, tous les observateurs s’accordent à considérer que le renouvellement vient de la périphérie, géographique et institutionnelle. De nombreux artistes (Castellucci, Dante, Punzo, Delbono…) établissent, en effet, leur lieu de travail en dehors des grands théâtres établis et même des grands centres urbains. La pression de la « rentabilité » est moins forte là où ne règne pas de véritable tradition théâtrale. De plus, il semble que les pouvoirs locaux aient joué un rôle en favorisant l’installation de nouvelles compagnies sur leur territoire. S’il peut alors se créer un lien avec une population qui s’identifie à « son » théâtre, cela peut aussi engendrer des frictions.Toutefois, c’est une telle dynamique qui a permis l’émergence de ces créateurs désormais consacrés sur la scène internationale. Parmi ceux-ci, certains sont devenus plus familiers du public belge qui a pu suivre leur travail à travers plusieurs spectacles. Outre Pippo Delbono qui semble tisser un lien privilégié avec le Théâtre de la Place à Liège, Ascanio Celestini et Emma Dante sont invités régulièrement par le Festival de Liège ou le Théâtre National, tandis que les textes de Fausto Paravidino ne quittent guère nos scènes.
« Laboratorio sul racconto orale »
Peut-être la place d’Ascanio Celestini dans le paysage théâtral est-elle la plus singulière. Celestini a fait du théâtre à l’université avant de se former dans une école de théâtre. Mais très vite, il s’oriente vers l’élaboration d’une parole orale pour retenir et transmettre la mémoire de toute une Italie populaire. Il opte pour un théâtre narratif fondé sur des témoignages, des récits qu’il récolte en fonction du thème du spectacle. Celestini recueille ainsi les traces verbales ou gestuelles de la vie et du travail paysan et ouvrier (Fabbrica) mais aussi des sous-bassements archaïques de l’Italie moderne. Il transmet ainsi ce qui est menacé de disparaître. Principal performer de ses spectacles, il façonne un rythme fondé sur la vitesse du débit et sur les répétitions, il module le timbre de sa voix, ponctue de quelques gestes. Généralement, le dispositif scénique est peu développé, Celestini dépouille la scène, plante un embryon de décor et s’appuie sur quelques objets qui, loin de tout réalisme, concrétisent un « espace de la parole ». Dans cette fonction ancestrale de conteur, de griot, il s’investit de la même fonction de transmission d’une mémoire qui est aussi un message. Dès lors, il maintient son récit en deçà du drame, en deçà de tout personnage construit sur une psychologie trop nette et qui permettrait l’identification. Ici, les codes du récit oral ne se font jamais oublier. Car il ne s’agit pas pour Celestini de donner à voir, mais de faire travailler l’imagination, de surcroît dans un sens critique.
Gestus sicilien
Après une formation d’actrice à l’Académie « Silvio d’Amico » à Rome, Emma Dante revient à Palerme pour y faire du théâtre autrement. Elle a passé la trentaine et ne se sent plus en accord avec la position généralement réservée à l’acteur, celle d’un interprète qui part à la fin de son contrat. Elle fonde alors sa compagnie, Sud Costa Occidentale, en 1999, en recrutant les membres via un laboratoire qu’elle organise à Palerme. Emma Dante dit écrire ses textes « sur le corps de ses acteurs »1 mais chacun participe pleinement à la recherche. D’ailleurs, chaque spectacle est préparé pendant une année. Revenir travailler à Palerme après une formation à Rome, c’est se confronter à une ville très traditionaliste et très provinciale où l’usage du geste et de la langue sont quasi « préhistoriques »2. Or, précisément, ce choc, ce décalage, va motiver tout son travail artistique. Elle fait de la vie et de la mentalité siciliennes très archaïques sa source première d’inspiration. Elle transforme la confrontation en une dynamique où elle affirme toujours plus sa modernité. Elle revendique donc son décentrement par rapport aux grands lieux d’activité théâtrale et assume un certain isolement géographique certes, mais aussi idéologique. Ville située politiquement à droite dans une Italie dominée par la machine Berlusconi, Palerme, pour Emma Dante, est fermée sur ses certitudes ; la politique y est obtuse et ne reconnaît jamais sa propre ignorance. Or, la metteur en scène entend démolir les certitudes, construire des doutes et faire de son art une petite révolution.Très bien accueillie par le public qui s’habitue peu à peu à son geste artistique et augmente progressivement, elle est en revanche ignorée de l’institution et aucun théâtre à Palerme ne lui permet de faire ses spectacles. Elle travaille dès lors dans un « centre social occupé », sorte d’équivalent italien des squats, sans aide et sans subvention. Elle crée plusieurs spectacles dont Il Sortilegio et Insulti puis viennent Palermu et Carnezzeria qui tournent en Italie, obtiennent notamment les prix « Premio Ubu » (en 2002 et 2003) et la révèlent au public international. Son théâtre prend essentiellement pour terrain d’observation et d’expérimentation la famille sicilienne, véritable microcosme de cette société, qui abrite une terrible violence sous la forme d’incestes, de morts prématurées, de puissantes coercitions… La sphère intime constitue pour elle la matrice où se forme la personne et où, d’emblée, toutes les lois sont déjà inscrites.Dans la lignée de Kantor, davantage peut-être que de Grotowski, Emma Dante construit un langage théâtral appuyé sur le geste et sur les attitudes du corps. Elle se saisit des règles absurdes et des comportement ataviques en œuvre dans les familles souvent pauvres quelle met en scène et crée des images très claires qu’elle mène alors vers la distorsion pour pointer l’oppression. Elle part de clichés (religion, famille, machisme, mafia…) comme lieux de mémoire historique de la collectivité3 pour les retransformer, les grossir démesurément, par exemple. Elle met ainsi en lumière comment les corps ont été façonnés au point d’incorporer littéralement les règles, la rigidité d’un ordre dont ils ne perçoivent même plus l’origine ni les raisons d’être. Dans ce théâtre, la femme tient la première place, victime privilégiée mais aussi corps plus malléable qui devient vite le relais privilégié et le soutien inconditionnel, par exemple, d’une religion qui ne prend même pas la peine de paraître dialoguer avec la modernité. Et ce qui depuis si longtemps fait corps avec ces êtres, structure leurs façons de voir mais aussi de se déplacer, de manger, d’échanger etc., ne peut être, on le conçoit, facilement séparé, critiqué voire extirpé. Tout le travail d’Emma Dante consiste dès lors à construire une distanciation « juste », qui ne bloque pas le spectateur dans un refus massif, mais ne l’entraîne pas non plus dans une caricature hilarante et sans effet. L’impact social de ces prises de position finalement assez circonscrites mais aussi très affirmées et très précises semble double. Le public de l’Italie du sud affiche une plus grande réserve à se retrouver devant un tel miroir, tandis que le Nord et les pays étrangers accueillent la metteur en scène à bras ouverts. D’où une certaine dépendance par rapport à la scène internationale qui rejaillit sur l’esthétique, Emma Dante reconnaissant volontiers que les couleurs utilisées dans la scénographie de La Scimia, par exemple, doivent davantage à l’atmosphère d’Anvers où elle a travaillé qu’à celle de l’Italie du sud. Mais puisque la tension, la confrontation, constitue la dynamique de sa création, postulons qu’elle saura résister aux formatages imposés par la circulation internationale des spectacles.