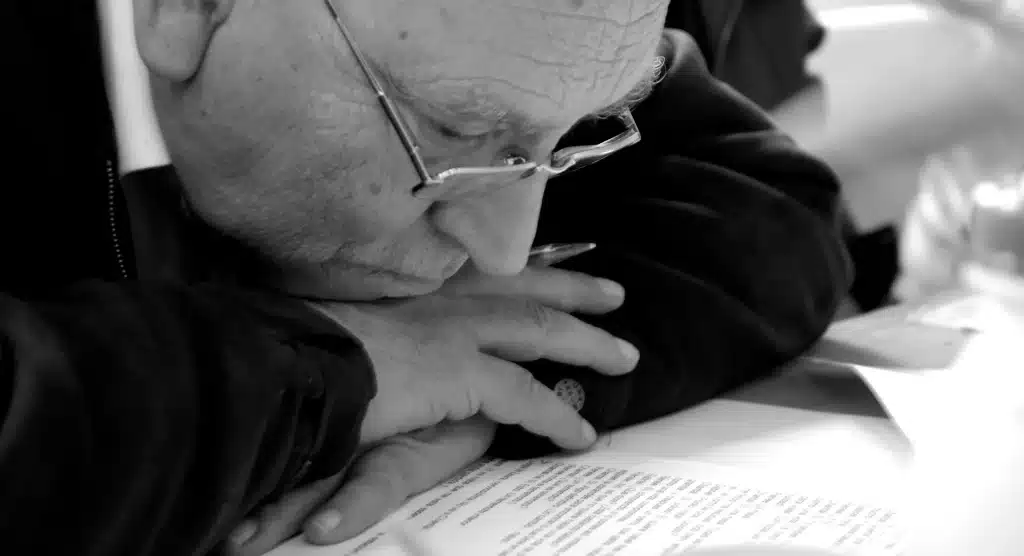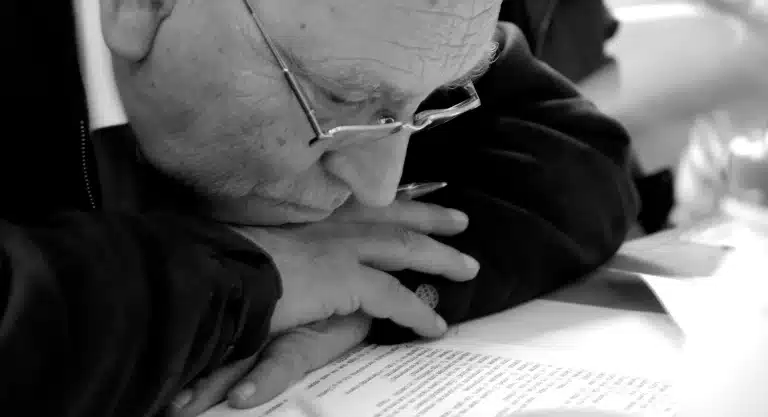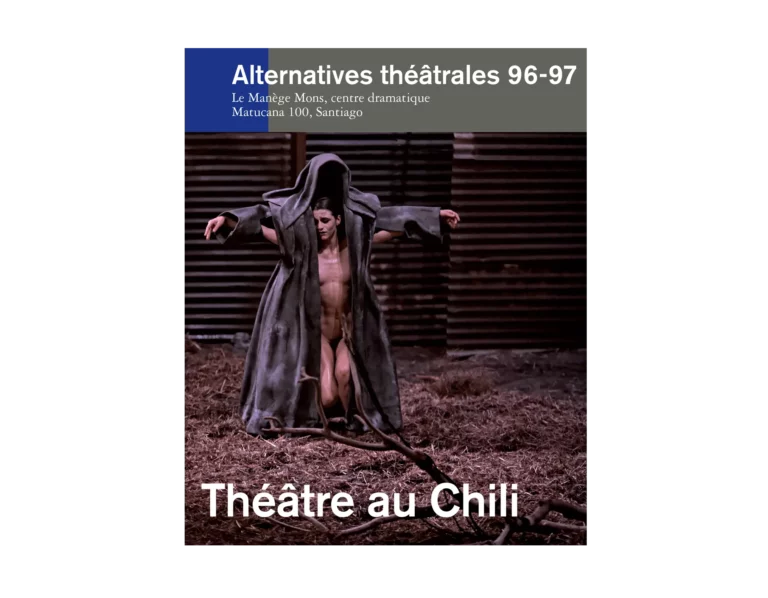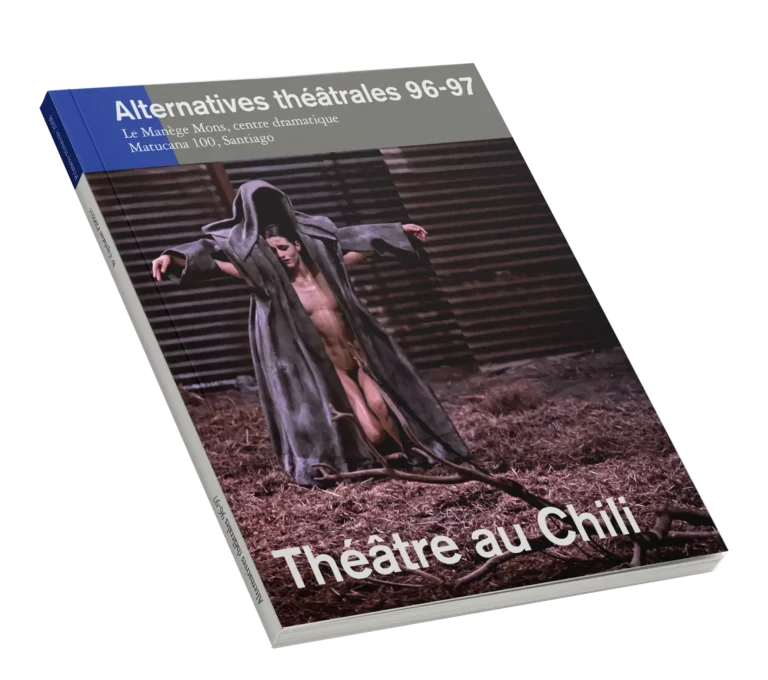BERNARD DEBROUX : Si le théâtre est un art collectif, l’écriture est un exercice plus solitaire, plus singulier et donc ici, pour AMARRADOS AL VIENTO VOUS VOUS êtes engagés dans une expérience d’écriture croisée.
Était-ce un exercice difficile et avez-vous dû changer votre façon de travailler ?
Juan Radrigán : Continuellement. Nous avons apporté beaucoup de changements, beaucoup. Parce que nous ne sommes pas partis avec une idée de sujet très claire. Nous avions une vague idée, mais il s’agissait surtout de trouver comment travailler quelque chose de vague à deux …
C’est venu de façon naturelle. Nous nous sommes réparti le travail.J’écrivais une scène, elle en écrivait une autre, nous mettions tout en commun et nous nous corrigions mutuellement. J’écrivais, elle écrivait. Il y a une telle fusion que les comédiens ne savent pas qui a écrie celle ou celle partie.
B. D.: Chacun n’a donc pas écrit des parties spécifiques, il y a une véritable écriture mêlée ?

Veronika Mabardi : Chacun de nous a travaillé de son côté des morceaux et puis nous avons tout retravaillé ensemble. On s’est aussi amusé un peu à s’imiter pour essayer de comprendre l’écriture de l’autre, après on a tout mis en commun et on a mis des quantité de couches ensemble. On a tout mélangé.
B. D.: Oui, il semble que même les acteurs ne peuvent pas repérer quelle est l’écriture de l’un et quelle est l’écriture de l’autre … Comment le thème s’est-il peu à peu défini ?
J. R.: On l’a traqué, cherché. Nous avions plusieurs idées au départ, mais elles ne nous ont pas servi. Le thème n’était pas très clair, c’est-à-dire que dans une production telle que celle-ci, belgo chilienne, c’est difficile, car la présence belge est aussi dans l’écriture. Au début, je pensais que nous allions le travailler de manière collective, c’était pour moi la première fois. J’avais travaillé de la sorte avec des acteurs en fin de cursus, nous mettions tout en commun. Personnellement, je n’aime pas trop les œuvres purement collectives. C’est une histoire écrite par beaucoup qui finalement n’est l’histoire de personne. Il faut bien choisir ces personnes, qu’elles aient la même idéologie, qu’elles aient beaucoup de choses en commun pour que cela fonctionne. À Santiago, au Chili, il y a eu une vague de création collective à un moment. En Colombie, les productions sont majoritairement collectives, je pense. Au Pérou aussi. Au Chili, nous sommes plus individualistes, mais il fut un temps où la création collective avait son heure de gloire. Le problème des œuvres collectives faites avec un groupe c’est qu’ il est très difficile qu’elles soient représentées par un autre groupe, parce que l’œuvre naît avec l’âme de ce groupe. Cela vaut pour LA NEGRA ESTER qui est la pièce de théâtre qui s’est le plus joué. Elle n’a pas été montée par un autre groupe. Cela tient sans doute à sa forme de création collective. Mais cette pièce est très solide. Elle pourrait tout à fait être montée par un autre groupe. Bien sür il faudrait changer la scénographie, changer les lieux, les personnages, mais je pense que cela pourrait se faire avec beaucoup de facilité.
V. M.: On est parti aussi de la question d’Étienne Van der Belen, le metteur en scène : que se passe-t-il au Chili aujourd’hui;, Après Allende, après le coup d’état et le retour de la démocratie… D’autre part, toi, Daniel, tu nous avais dit aussi : « gardez votre naïveté, ne décidez pas à l’avance de ce que vous allez faire ». Notre première rencontre avec Juan a donc été ingénue et cela se retrouve finalement dans la pièce. Quand nous sommes arrivés et qu’on s’est demandé avec Juan s’il restait quelque chose de l’utopie, c’est ça qui a lancé le dialogue. C’est cette urgence d’Étienne qui a été transmise. C’est plus cette urgence-là qu’une commande, il n’y avait pas de commande thématique. Et puis, nous avons eu des écailles qui nous sont tombées des yeux, on a vu ce qui pouvait être entendu aujourd’hui au Chili et en Belgique.

J. R.: Il semble que lorsque Pinochet s’est vu obligé de rendre le pouvoir, l’une des clauses tacitement imposée était l’oubli. Ne pas parler de la dictature pendant cinquante ans … Et visiblement le peuple s’est vu affecté par cette clause, parce qu’il a commencé à oublier, il s’est produit une espèce de « ne rien faire » imprévu. C’était très étrange. Nous nous sommes donc imprégnés de ce thème, des attentes, de la résistance ; résistance qui n’existe pas au Chili, il n’y a pas de résistance physique ou politique, mais bien un espoir, on ne sait pas quoi, mais on espère. On espère que quelqu’un, avec suffisamment de charisme pour rassembler de nouveau les gens, fasse son apparition.
Daniel Cordova : On peut dire que le peuple a observé ces cinquante ans de silence et qu’aujourd’hui, il n’y a plus personne qui parle, tout le monde est dans l’oubli et à la fois dans l’attente. La pièce est complètement imprégnée de cette attente et de cet oubli, de réminiscence d’un passé qui vient malgré soi.
J. R.: C’est un peu comme une maison qui doit être évacuée et que ses occupants refusent d’abandonner, mais en même temps ils n’ont pas le cœur à résister. .. Nous ne savons pas quelle est la vérité au Chili. Donc présenter un thème comme celui-là était presque du mensonge. Nous avons dû chercher la forme, ce que signifiait résistance, mais résistance à quoi ? Le pouvoir aujourd’hui porte une cravate.
B. D.: L’écriture de Juan est à la fois très réaliste, mais en intégrant des éléments métaphoriques et allégoriques. Cela provient sans doute du fait que lorsque l’on écrivait sous la dictature, il fallait utiliser des métaphores, des allégories. Le texte de AMARRADOS AL VIENTO est-il écrit dans cette veine-là ou s’agit-il d’une forme plus lyrique, puis poétique ?
V. M.: Nous sommes partis sur des choses très réalistes et même des personnages et une situation hyper réalistes. Lorsqu’on s’est rencontré, on s’est demandé ce que l’on avait en commun. Les histoires, les personnages, une situation, comme un langage commun aux deux écrivains. Ensuite, on était dans une impasse et l’on s’est dit que ça n’allait pas parce que c’était trop référentiel, trop contextuel, ça restait anecdotique et donc tout le travail a été de sortir la métaphore de tout cet élément anecdotique que l’on avait mis en place. Et donc je pense qu’on est complètement dans cet univers là, à la fois onirique et métaphorique, qui peut se lire sous différents angles, ici comme là-bas. C’était ça l’enjeu. Pour répondre à ta question, on est assez proche de ce que Juan fait d’habitude. Il s’agissait de trouver un lieu. Un lieu qui pouvait devenir métaphore d’un esprit, d’un désir. Ensuite on pouvait construire sur ce lieu, sur sa décadence et pour finir se demander pourquoi il ne tenait pas debout.
J. R.: Peut-être que si c’est proche et en même temps pas très proche, ça pourrait être comme du surréalisme, non ?
V. M.: Mais est-ce ressemblant à ce que tu fais lorsque tu travailles seul, au niveau de la forme ?
J. R.: Oui, un peu. J’aime beaucoup ce mélange d’ambiguïté mêlée de lyrisme. Cela m’a toujours semblé une bonne atmosphère pour refléter ce qu’est le Chili. Nous n’avons pas trouvé le chemin pour nous confronter à un nouveau spectateur au Chili.
On ne l’a pas trouvé. Après une dictature, le spectateur change. Il n’est plus le même. C’est une autre personne, autre que celle que nous pouvions coucher. Alors je cherche. Il ne me reste plus beaucoup de temps (rires), mais je cherche. Je cherche une forme pour toucher ce nouveau spectateur. On ne pouvait pas continuer à écrire comme on écrivait avant, c’est-à-dire après le coup d’état. Parce que c’est une personne qui a subi la torture, l’exil, la persécution, qui sait beaucoup de choses et qui a enduré beaucoup de choses, ce n’est donc plus la même personne. Comment arriver à la toucher, on n’a pas trouvé la forme ou le moyen d’arriver à cela …
C’est d’autant plus difficile parce le spectateur suppose qu’il veut oublier. Et en même temps il ne veut pas oublier, il ne peut pas.
D. C.: Est-ce que vous croyez qu’avec ce type d’écriture mixte, cette pièce va rencontrer le public « amnésique » ?
J. R.: Oui, lorsque nous avons commencé nous n’en étions pas loin. Après nous avons canalisé la pièce pour qu’elle soit valable pour le Chili. Donc, elle va résonner au Chili, tout comme dans d’autres endroits, d’ailleurs. Aujourd’hui, on a fini le travail, il reste la mise en scène et le travail des acteurs …
D. C.: J’aimerais te poser la même question à toi, Veronika, est-ce que tu crois que la pièce telle qu’elle est écrite pour répondre au désir d’Étienne de retranscrire une réalité surtout chilienne, peut être lisible ici en Belgique ? Juan nous dit qu’il pense que ce que vous avez écrit ensemble va résonner au Chili. Et toi, est-ce que tu crois que cela va résonner ici ? Et comment ?
V. M.: Ça résonnera ici mais de manière totalement différente. On a beaucoup parlé du mot utopie qui était devenu un mot maudit et qu’il valait mieux ne pas utiliser au Chili parce qu’il irritait. J’ai l’impression qu’on vit la même chose d’une autre manière ici aussi. Il s’agit de ne pas se placer naïvement en défenseur d’une utopie d’un monde meilleur, cela semble assez clair qu’ici ce n’est pas possible non plus. Mais pour d’autres raisons et d’une autre manière. Nous vivons d’autres désillusions, un autre type de fatigue, d’usure qui n’est pas due à un coup d’état, mais qui est due à la routine d’être petit à petit grignoté par une espèce de pression continuelle d’un monde extérieur de consommation et de perte de sens, de perte de parole aussi et je pense qu’il y a des choses qui peuvent vraiment résonner à partir de là, ici aussi, même si nous n’avons pas la même mémoire.
D. C.: Dans coutes les discussions que vous avez eues, j’ai entendu une volonté de balayer complètement la question chilienne. Vous vouliez une pièce qui puisse concerner les Chinois ou les Russes, les gens de La Louvière ou Charleroi … Vous avez travaillé dans ce sens et pourtant ce que j’ai entendu me semble malgré tout être une pièce extrêmement chilienne.
V. M.: Je pense que l’on ne se refait pas. Qu’à la fois Juan est extrêmement chilien et que nous, Étienne et moi, restons complètement imprégnés et passionnés par cette question-là et je crois que la question chilienne a aussi influencé fortement la Belgique, qu’il y a des traces de cela dans notre manière de penser, dans notre manière de penser la politique, de penser le collectif, je crois qu’on en est contaminé. Il y a toute une génération qui a été nourrie par l’histoire du Chili. On a encore retrouvé dernièrement des disques, des vinyls …
Il y a une réflexion qui est arrivée ici et je pense qu’il en reste des traces, même si les gens aujourd’hui ne peuvent plus dire : cette idée-là nous vient du Chili ou d’Amérique latine, elle est là et elle vient de là. Il y a un héritage, les gens ont circulé. Quand je parle avec des gens de la génération de mes parents, ils étaient suspendus à leur radio pour savoir ce qui se passait là-bas, ils avaient des contacts. Il y a toute une communauté chilienne ici qui a eu une influence sur la Belgique.