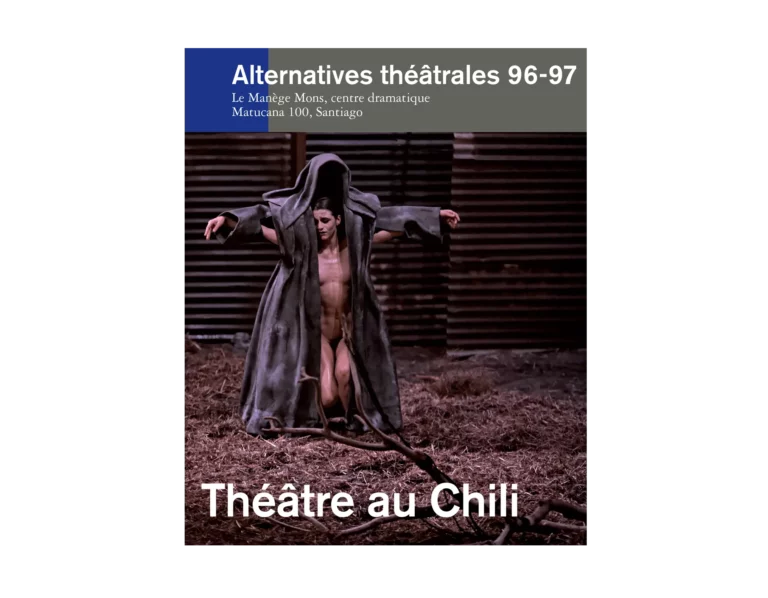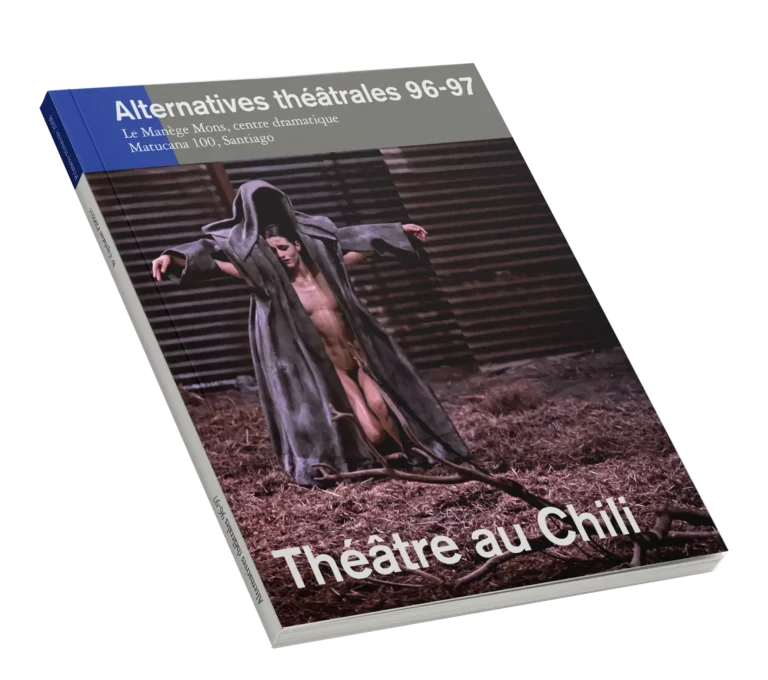DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XXe siècle, la dramaturgie chilienne multiplie les points de vue et anticipe l’échec social auquel conduira la dictature militaire. À leur tour, les auteurs post Pinochet reprennent le travail en se méfiant des récits officiels et en privilégiant les outils théâtraux.
Appelée à revitaliser l’écriture théâtrale dans le Chili post Pinochet, la Muestra de Dramaturgia Nacional surgit au milieu des années 90 comme une vitrine pour dramaturges consacrés et émergeants.
Sous des pseudonymes particuliers, ils prennent part de manière enthousiaste au concours organisé par le gouvernement, proposent des textes et semblent sortir de l’ostracisme auquel les avait condamnés une vague de théâtre visuel.
En peu de temps, ils deviennent le centre d’intérêt, récupèrent un certain statut hérité des années 50 — lorsque les compagnies universitaires renforcèrent la création avec des concours similaires — et assistent à la mise en scène de leurs pièces présentées dans un festival estival fort applaudi.
Ils doivent, cependant, payer un tribut en accord avec les temps qui courent, puisque — dans la pratique — la muestra est conçue comme un tremplin pour attirer d’éventuels producteurs et entrepreneurs disposés à investir dans le théâtre.
C’est pour cela que les pièces sélectionnées sont proposées en résumé par des metteurs en scène reconnus afin de ne pas dépasser cinquante minutes, de telle sorte que si, à partir du synopsis ou de la semi-mise en scène, quelqu’un veut connaître la totalité de la pièce, il doit recourir à l’original ou croiser les doigts pour que l’associé capitaliste s’aventure à monter la pièce.
Tout comme le Godot de Beckett, l’investisseur du secteur privé n’est jamais arrivé et ce sont les théâtres universitaires qui ont dû assumer la tâche de monter quelques titres avec des partenariats prometteurs qui, ce nonobstant, ont succombé face aux exigences de l’autofinancement.
Malgré cela, la muestra a été, jusqu’à l’année 2000, une tradition estivale grâce à laquelle se sont confrontés points de vue théâtraux et formes de mises en scène avec une forte fréquentation du public, une participation significative d’auteurs (en moyenne 180 textes par an) et une appréciation tacite du talent de certains acteurs.
Avec le temps, les attentes de l’événement se sont amoindries et les objectifs ont changé : il ne s’agit plus d’attirer l’attention d’un producteur mais de promouvoir une écriture scénique à laquelle l’état n’accorde aucun moyen.
Les louables objectifs ont perdu de leur éclat à la suite des réformes successives du concours (on essaya de classer les auteurs par génération), des changements de calendrier (programmation au printemps dans des salles fermées, avec des appels d’offres quant à la production) et des modifications administratives ( révision des subventions destinées à l’événement et retards fréquents de paiements).
Les présentations de ces dernières années ont donné lieu à de fortes critiques. On accuse la muestra de ne pas retenir d’écritures soutenues, de devenir une vitrine d’école de théâtre et de sélectionner des créations de qualité discutable contre certains textes qui ont été favorablement salués hors du cadre du concours.
La version 2006 — qui présente environ cent trente pièces dont trois en mise en scène intégrale et six en lecture mise en espace — donne à l’ouverture la lecture d’une espèce de manifeste de Jorge Dfaz, figure emblématique de la scène locale et promoteur enthousiaste des premières versions du concours. C’est un moment historique car, quelques mois après la rédaction et la lecture de ce discours, il meurt des suites d’une maladie diagnostiquée depuis longtemps.
L’auditoire majoritairement jeune est témoin du scepticisme caractéristique de l’auteur. « Convive de pierre », ainsi qualifie-t-il celui qui aborde l’écriture théâtrale. « Il se sent comme un intrus dans le banquet panique. N’osant pas entrer, il regarde par le petit trou de la serrure la grande fête du théâtre. Il a une fesse sur sa table d’écriture et l’autre sur scène ».
Le plaidoyer a une résonance particulière lorsqu’on se penche sur les aléas que lui et ses pairs ont dû affronter au Chili : la publication de textes dramatiques est occasionnelle (dernièrement on assiste à un dévelop- pement éditorial grâce aux labels comme Lom, Ril et Ciertopez qui servent de base de consultation); les metteurs en scène, en général, ont le dernier mot sur les pièces ; et le spectateur moyen n’est pas toujours prêt à se reconnaître dans l’imaginaire que proposent ces auteurs.
Ces jours-ci (mai 2007) on attend que le tout récent Consejo Nacional de la Cultura y las Artes prenne le taureau par les cornes, pour reprendre le titre d’une des pièces de Juan Radrigàn, un des auteurs qui se remit à écrire pour la scène à l’occasion du concours mais qui en chemin finit par prendre part aux discussions sur le style avec les nouvelles générations.
Entre temps, les gestionnaires du concours font les comptes et constatent qu’en une décennie, la muestra a accueilli des noms illustres de l’histoire du théâtre chilien (Egon Wolff, Jorge Dfaz, Juan Radrigân et Marco Antonio de la Parra), a contribué au renforcement d’une écriture de la transition (Benjamin Galemiri) et a été le berceau de nouvelles voix émergentes, réunies sous le nom de Nouvelle Dramaturgie (comme Juan Claudio Burgos).
Pour le reste, les fonds de l’État consacrés aux concours (spécialement ceux du Fondartet le Fondodel Consejo del Libro) ont dynamisé la scène en attribuant des subventions à l’écriture et la mise en scène de textes ultra-contemporains comme ceux de Manuela Infante.
Il y a eu aussi ceux qui ont fait seuls leur chemin, comme Guillermo Calderon, dont l’indépendance rappelle celle d’Oscar Stuardo dans les années 1970 mais avec une reconnaissance immédiate plus importante. Le complément de formation qu’il a reçu à l’étranger le situe dans la lignée de Luis Alberto Heiremans.
Dans les œuvres de ces auteurs s’entremêlent l’histoire locale, la rénovation et l’expérimentation de langages qu’a connues la discipline au niveau mondial.
Enfants de leur temps, ils portent la proclamation de Dìaz comme une leçon d’espoir : « Cher dramaturge, pathétique scribe de dialogues, tu as l’air en perpétuelle errance, inutile et indispensable, mais sans toi il nous manquerait à tous une expression humaine, une vision du monde, une poétique, une image de l’homme qui, malgré ses erreurs, sera un jour prophétique ».
Luis Alberto Heiremans, l’existentialiste de l’espoir
Reflet de la transformation qu’accuse le roman chilien face au réalisme antérieur, la dénommée Générationdes années 50 regroupe des auteurs qui apportent une force littéraire et une profondeur de contenus à la dramaturgie locale, prise au piège, en grande partie jusqu’aux années 40, du détail « criollistas » (créoles) ou costumbrista (peinture de mœurs).
Bien que les thématiques de leurs pièces aient pris des chemins différents, ce groupe d’auteurs a modelé des personnages et des structures qui ont résisté à plusieurs révisions et qui, à leur époque, ont acquis une légitimation grâce aux compagnies universitaires.
C’est ce qui est arrivé aux pièces de Luis Alberto Heiremans (1928 – 1964), médecin et fils d’une famille aisée. Il est passé de l’écriture de contes à l’écriture théâtrale et, pour renforcer son style, il a pris des cours d’art dramatique à la LondonTeatralAcademyofDramatic Arts et à l’Actor’sStttdiode New York.