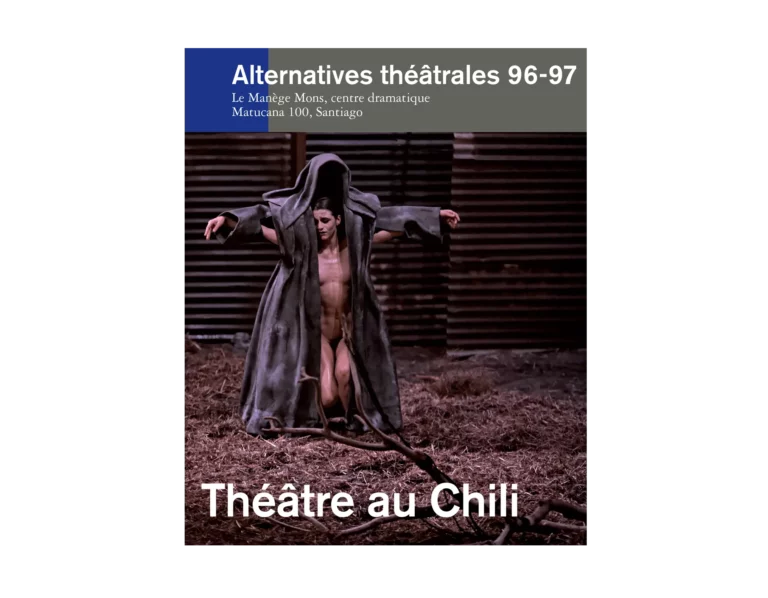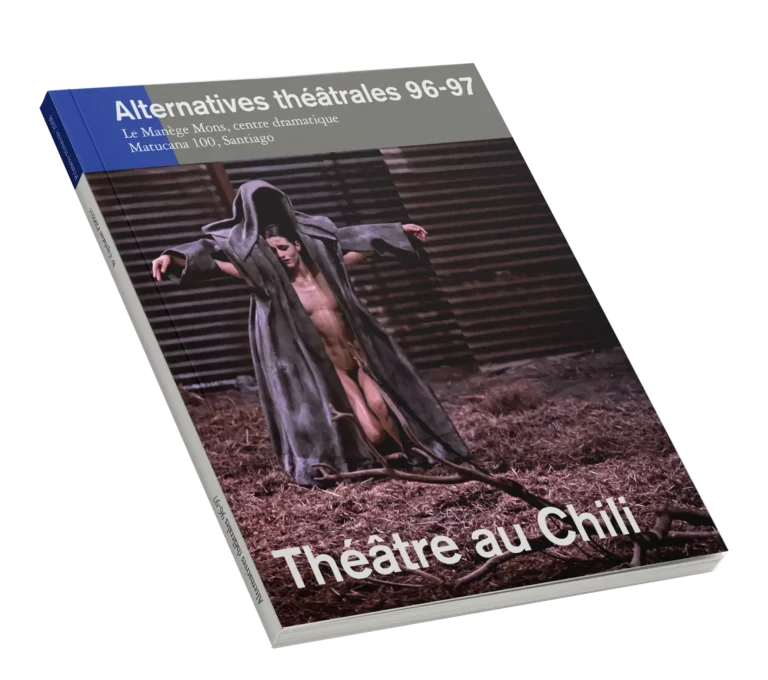BERNARD DEBROUX : Pour commencer, peux-tu expliquer ton trajet personnel dans le paysage culturel chilien ?
Ernesto Ottone : Je suis fils d’exilés politiques, et j’ai donc vécu pendant dix-huit ans en Europe, dans différents pays, différentes cultures. Je suis revenu au Chili avec mes parents en 1989. Je faisais déjà depuis pas mal d’années du théâtre, de l’art, à l’école, et au moment de choisir des études, j’hésitais entre sociologie, histoire ou cinéma. Comme il n’y avait pas d’école de cinéma au Chili, je me suis inscrit en théâtre. Je faisais du théâtre depuis l’âge de quinze ans, j’avais aussi fait de la télé dans d’autres pays, mais je savais que je ne voulais pas être comédien. À cette époque, il n’y avait pas d’école de direction de théâtre, ce qui m’intéressait pourtant beaucoup plus que l’interprétation. J’ai donc fait une formation de théâtre en parallèle avec une licence en art.
J’ai travaillé dans quelques compagnies, j’ai fait un peu de télé, et au bout d’un moment je me suis dit que je voulais être directeur de théâtre. J’ai alors formé ma troupe qui a fonctionné pendant quatre ans. J’ai vécu là une crise de manque d’espace, de manque de possibilités. En 1993 – 94, c’était très dur au Chili pour une troupe de théâtre de trouver une audience, un espace, un financement. C’était la crise des années 1990, pendant laquelle il y a eu un essor de la culture au Chili mais aussi très peu d’espace pour les artistes. Je me suis alors rendu compte que je voulais aller de l’autre côté, c’est-à-dire trouver des interlocuteurs qui, au moment de lire des projets, ne te regardent pas avec méfiance parce que tu as des boucles d’oreille ou les cheveux longs, des gens qui aient confiance et puissent parier sur ces projets.
J’ai décidé alors de faire des études de gestion culturelle ; j’ai fait un Master ici au Chili et je me suis aperçu que les profs étaient les mêmes que ceux que j’allais voir et qui ne me donnaient pas d’espace … Je suis ensuite parti grâce à une bourse étudier à l’université Dauphine à Paris, en Gestion politique et Institutions culturelles.
J’ai travaillé pendant un an à la Grande Halle de la Villette, en programmation. Puis, je suis revenu au Chili et j’ai eu la chance de commencer à travailler dans un centre culturel, et, en parallèle, j’ai travaillé au Théâtre National, pour un projet de gestion du théâtre. Ça a
été une expérience formidable. J’ai travaillé avec une cinquantaine de compagnies de théâtre, on a fait une trentaine d’expositions … Puis je suis parti pour des raisons personnelles en Allemagne, à Berlin, et j’ai fait une pause d’une année, pour pouvoir réfléchir et voir comment le théâtre était organisé en Allemagne. Au bout d’un an, à Berlin, je reçois un appel pour me dire qu’il y a un nouveau projet du gouvernement Lagos pour rénover des entrepôts abandonnés qui appartenaient à l’État. On voulait faire un projet culturel mais on ne savait pas exactement par quoi ni par où commencer. Je suis donc revenu en février 2001, et cela fait environ cinq ans que l’on travaille sur le projet de Matucana 100.
B. D.: Il y avait déjà eu une occupation de ce lieu par Andrés Pérez ?
E. O.: Oui, mais quand on m’a demandé de venir, on ne m’avait pas raconté l’histoire de ce lieu. Ces entrepôts appartenaient à la direction de l’approvisionnement de l’État. C’était un espace de 8 500 mètres carrés, où il y avait pas mal de choses : un squat de famille, un garage clandestin, un entrepôt de chaises roulantes, et la compagnie Gran Circo Teatro d’Andrés Pérez qui occupait ce qui est aujourd’hui (depuis quelques mois) la galerie. Ils espéraient que l’État leur donnerait cet espace en concession. Je ne savais rien de cette histoire en arrivant, et j’ai été confronté à cette réalité. Ces entrepôts sont situés dans un quartier très populaire, Estacion central (le quartier de l’unique Gare de train de Santiago). Le gouvernement avait l’idée de faire non pas un espace dédié spécifiquement à un théâtre mais plutôt un projet plus large de centre culturel, avec des disciplines qui n’étaient pas encore représentées dans les centres déjà existants.
B. D.: Quelles sont les lignes directrices de ta politique à la tête de Matucana 100 ?
E. O.: Il y avait au départ trois grandes orientations : la première était la création d’audience, c’est-à-dire qu’il y avait un manque de participation d’une partie de la population chilienne, celle qui était la plus abandonnée pendant les années de gouvernement militaire et pendant les premières années de démocratie, et qui avait très peu de participation dans la vie culturelle. La première chose était donc de trouver des mécanismes pour inciter des gens qui n’avaient que très peu d’accès à la vie culturelle de faire partie de ce réseau. Deuxièmement, nous cherchions comment réaliser un espace où il se produise réellement un échange culturel entre les différentes disciplines artistiques. Troisièmement, nous voulions réaliser un projet autosuffisant et autogéré à partir de fonds publics et privés, ce qui était un modèle assez récent au Chili.
B. D.: C’est une fondation qui gère le lieu ?

E. O.: Oui. Au Chili, il y a des fondations et des corporations. Dans les fondations, il y a une assemblée générale d’associés qui participent à l’élection d’un comité de gestion (le directoire) de sept personnes.