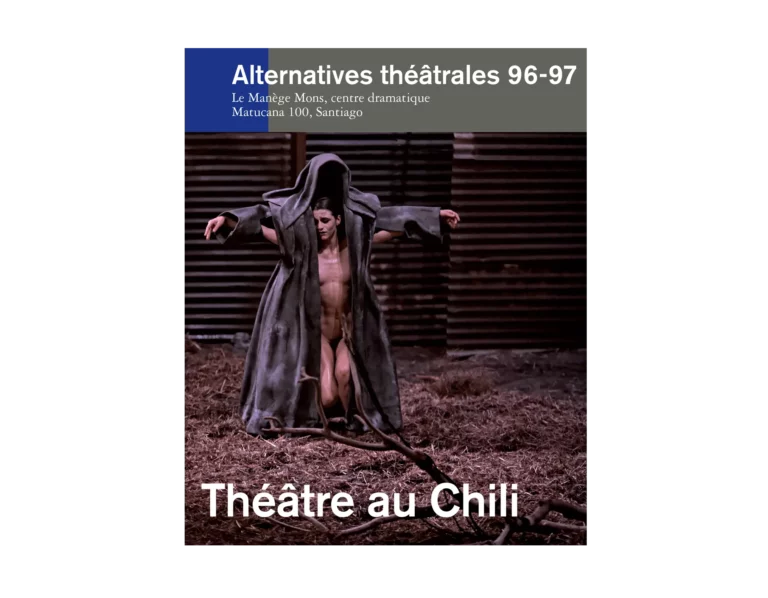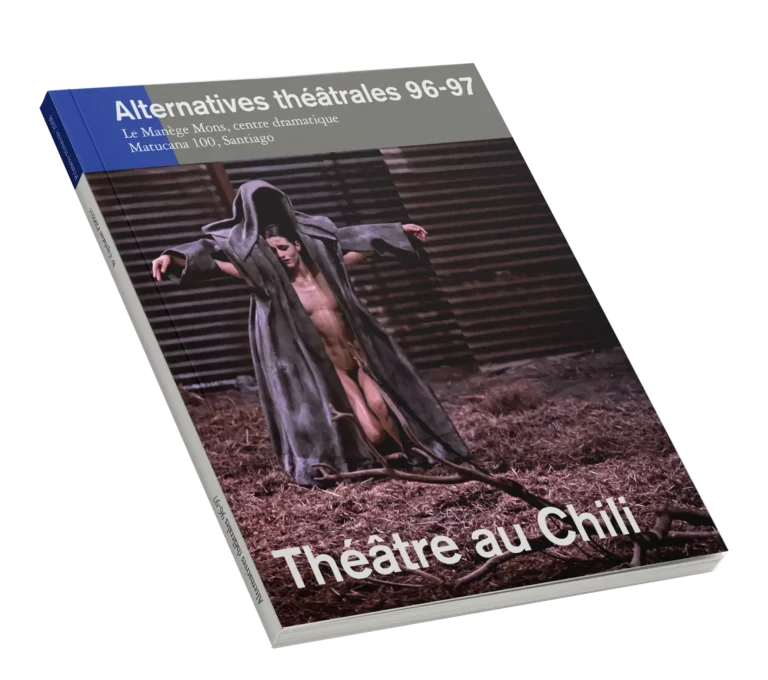BERNARD DEBROUX : Comment ton parcours théâtral a‑t-il débuté ?
Jaime Lorca : Je suis tombé dans le théâtre par hasard. Quand j’ai quitté l’école secondaire, j’ai étudié la philosophie. Ensuite je voulais étudier la sociologie, mais la faculté de sociologie était fermée ( je parle de l’époque de la dictature). Je me suis dit alors, j’avais 21 ans, que j’allais étudier le théâtre. Je n’avais vu que deux spectacles de théâtre jusqu’alors ! Mais je me suis rattrapé ensuite, j’allais au théâtre presque tous les jours, j’ai beaucoup lu ; j’étais émerveillé. C’était en 1981, ma vie a été bouleversée par la connaissance du théâtre. Mais à l’université catholique du Chili à cette époque, l’enseignement était très limité. On ignorait Brecht, Antonin Artaud … L’enseignement était très traditionnel. Alors, en sortant de l’école nous nous sommes dit avec Juan Carlos Zagal et Laura Pissaro que, puisque nous ne connaissions pas beaucoup de choses et que nous avions envie d’entrer dans le monde du théâtre pas seulement en tant que comédiens mais aussi comme scénographe, écrivain, éclairagiste, que nous devions envisager le théâtre dans sa totalité. Nous avons étudié dans une école de théâtre qui donnait beaucoup d’importance aux textes et pas du tout à l’image. Nous étions très influencé par le cinéma, la bande dessinée, les vidéo-clips … Nous avions envie de trouver la poésie dans les images, pas seulement dans les textes, nous aimions travailler sur la métaphore des images. Nos premiers spectacles furent un échec complet. Un jour, nous avons même joué pour deux spectatrices seulement, deux dames âgées qui étaient venues et que nous n’avions pas voulu décevoir. Après ce premier spectacle réalisé avec des moyens très pauvres (un rideau, une échelle), nous avons commencé la recherche d’images à partir de textes de la littérature, de romans. Ça nous a donné plus de liberté pour créer notre propre univers. Lorsque nous avons travaillé sur un spectacle qui relatait la découverte d’un continent par un explorateur, nous avons dû imaginer la mer, les bateaux, tout cela avec des moyens proprement théâtraux. Nous avons travaillé avec un scénographe pour qu’avec un seul objet (un fauteuil à bascule) nous puissions représenter un château espagnol, un navire ou le mouvement de la mer … Le décor pour nous n’est pas un décor, c’est le monde qui habite les personnages. Nous étions trois sur scène, mais le décor était comme un quatrième personnage. Nous ne voulions pas de décor réaliste, pauvre en images.
Ensuite nous avons créé PINOCCHIO, spectacle très important car il nous a permis de survivre économiquement et de travailler seulement au théâtre. Il nous a permis aussi de sortir, d’aller en Colombie, puis à Madrid. C’était notre premier voyage, en 1991. Depuis ce moment, nous n’avons pas arrêté de voyager, d’aller à la rencontre de théâtres différents, de techniques différentes. C’est la chance que nous avons eue. C’était aussi le retour de la démocratie. Le théâtre était très faible, très différent de ce qui se passe aujourd’hui où l’on voit une renaissance du théâtre. Je crois que si nous étions restés au Chili, jamais nous n’aurions pu faire ce que nous avons fait avec La Troppa. Nous avons appris, surtout en France, l’artisanat du théâtre. C’est ce que nous faisons … l’art du théâtre sans doute, mais aussi l’artisanat … La scénographie, les lumières, la régie, l’apprentissage d’un métier. ..
B. D.: C’est à partir de PINOCCHIO que vous avez vraiment pris votre envol. Comment expliquer ce succès ?
J. L.: Oui, ce spectacle a fait une quasi-unanimité. C’est à cette occasion que nous avons rebaptisé la compagnie (auparavant elle s’appelait Los QUENON ESTABAN MUERTOS, Ceux qui n’étaient pas morts). C’est un spectacle optimiste, simple, direct. Je crois aussi que nous avons bien compris l’état d’esprit des Chiliens à ce moment-là. Nous étions en train de sortir de la grande nuit et nous avions besoin d’un peu d’espoir. On avait envie de rire, de se reconnaître un peu plus aimable …
Il y avait aussi un décor très particulier : une pince à linge qui tournait, changeait de position : très simple mais très efficace. Après cela, nous avons fait un spectacle inspiré d’un roman de Boris Vian, LE LOUP-GAROU. Nous l’avons appelé LOBO (Loup) et nous l’avons situé à Santiago à la fin du XXe siècle, c’était un spectacle très « pop/ rock », très visuel, une esthétique de vidéo-clip, avec la présence du métro de Santiago. Ce spectacle a beaucoup impressionné les jeunes, qui, encore aujourd’hui, se le rappellent et m’en parlent. C’était un spectacle ambitieux, radical et sans concessions. Après, nous avons traversé une crise. Nous faisions beaucoup de spectacles pour la jeunesse et les écoles pour pouvoir survivre. C’est en pleine crise que nous avons créé GEMELOS. Ce fut un vrai cadeau qui nous a ouvert les portes en France. Nous avons été invité au festival d’Avignon 1999 et nous avons trouvé notre public. Avant GEMELOS, nous avions une bonne réputation mais dans un cercle limité.
La reconnaissance de l’Europe a été un élément déclencheur dans notre reconnaissance au Chili.
Après douze années de travail, nous n’avions pas un véritable public. Il est arrivé avec le succès de GEMELOS. Nous l’avons tourné beaucoup, partout dans le monde, peut-être un peu trop car nous n’avons plus créé autre chose. Nous jouions le spectacle plus de deux cents fois par an. Nous n’avions plus d’énergie pour répéter et inventer autre chose. Notre école, ce fut La Troppa : dix- huit ans de travail pour apprendre le métier.
B. D.: Il y avait une volonté de suivre chacun une voie qui lui soit propre ?
J. L.: Oui, après ce temps d’apprentissage en commun, nous avions envie de dire quelque chose d’individuel, de personnel.
Daniel Cordova : Au Canada, quand une troupe fait un travail comme le vôtre, populaire, universel, ce spectacle est doublé en deux ou trois langues et présenté avec des équipes d’acteurs différents. C’est le passage d’une démarche artisanale en une démarche d’entreprise. Avec GEMELOS, on aurait très bien pu imaginer une carrière de ce type, comme à Broadway où on joue des spectacles pendant vingt ans !
J. L.: Moi, ça ne m’intéresse pas. Je n’ai pas l’énergie pour développer ce type de projets …
D. C.: Il y a donc quelque chose de plus vital … qui vous anime. Vous travaillez pour rendre compte de votre perception du monde d’aujourd’hui.
J. L.: Quand nous avons commencé avec notre compagnie, nous étions en pleine dictature. Le théâtre était un peu une excuse. Faire du théâtre, c’était comme créer notre petite république. Nous vivions dans un monde à part. Un petit paradis, un monde merveilleux pour résister. Nous avions notre propre économie, tout à fait en « noir », nous vivions en dehors des règles, c’était le seul moyen de travailler sous une dictature. Nous étions en résistance, nous ne profitions pas de l’establishment, nous étions alternatifs. Avec le retour de la démocratie, nous avons continué à travailler de cette manière. Nous avons changé notre mode de production seulement pour le dernier spectacle. C’était une coproduction avec la maison de la culture du Havre, une production tout à fait à la française.
B. D.: Et pourtant, toi, tu voulais revenir à un mode de production plus artisanal ?
J. L.: Non, ces moments merveilleux ne peuvent être vécus qu’une fois dans une vie. Je n’ai pas envie de recommencer cela, d’ailleurs ce n’est pas reproductible. Aujourd’hui je travaille avec des jeunes, je leur transmets ma méthode que j’ai acquise par l’expérience. Je profite aussi de leur approche, très différente de la nôtre. La jeune génération des comédiens chiliens est extraordinaire. Nous, nous étions tendus, raides, eux ils sont beaucoup plus souples, complètement disponibles, flexibles, malléables à différentes techniques et esthétiques. Ils sont beaucoup plus cultivés. Nous n’avions pas de livres, pas de théâtres à voir, pas de films. Eux ont pu être ouvert sur le monde. Nous, nous étions enfermés dans une nuit. Quand nous répétions GEMELOS, il nous est arrivé plusieurs fois de pleurer. Quand nous l’avons créée le 15 janvier 1999, nous l’avons jouée avec méfiance et distance. Les masques étaient une défense pour ne pas laisser transparaître trop l’émotion.

LA TROPPA, ou la troupe, est un terme qui s’applique aussi bien à une armée qu’à une bande d’acteurs. De fait, la compagnie de Jaime Lorca, Laura Pizarro et Juan Carlos Zagal a été fondée à Santiago du temps de la dictature militaire. Compagnons d’études à l’École de Théâtre de l’Université Catholique du Chili au début des années 80, leur association s’appela d’abord Los que no estaban muertos (Ceux qui n’étaient pas morts). L’expression désignait à leurs yeux leur génération, celle des Chiliens pour qui la démocratie n’était qu’un souvenir d’enfance, et qui, parvenant à l’âge adulte, se débattaient dans l’étouffant climat répressif imposé par la junte. En 1987, leur première création collective, EL SANTO PATRONO, ne met aucun corps en scène : à eux trois, ils manipulent simplement un escalier et quelques cubes noirs De cette expérience, ils sortent convaincus qu’il leur faut se remettre eux-mêmes en jeu en tant qu’acteurs, quitte à se rebeller contre une certaine conception du « théâtre pauvre » inculquée à l’université. Se proclamant désormais « sans maîtres », le trio décide de prendre en main lui-même sa formation, à la recherche d’un théâtre « qui nous plaise, nous émeuve, nous passionne, nous amuse ». Un an plus tard, avec SALMON-VUDU (qui raconte la quête par un mystique espagnol d’un continent perdu où se situe le paradis), ils transforment une grande chaise à bascule en galion voguant dans les tempêtes entre Europe et Amérique et apprennent à cette occasion une leçon qu’ils oublieront plus : l’accessoire, actionné, transformé, poétisé, s’il fait corps avec l’acteur et le pousse à prendre des risques, est source de magie dramatique et visuelle. Après ces deux créations collectives, EL RAP DEL QUIJOTE marque en 1989 leur première tentative d’adaptation d’un texte littéraire Dans les années 90, dès le retour à la démocratie, la petite bande ne tarde pas à se rebaptiser La Troppa. Le nouveau nom de cette « trouppe », avec sa lettre de trop qui fait discrètement déraper le mot vers l’italien (« la troppa » ou « l’excessive »), maintient l’allusion au régime militaire et sa mise à distance, tout en multipliant ironiquement les effectifs de la troïka à laquelle se résume toujours la compagnie. Aux yeux de La Troppa, « faire du théâtre est une guerre spirituelle », qu’il faut mener sur tous les fronts : non seulement ses trois membres jouent à eux seuls tous les rôles, mais ils conçoivent ensemble les canevas, les décors, les masques, les costumes, les marionnettes et les accessoires, tandis que Zagal écrit les musiques de scène. Poursuivant leur recherche à partir d’ œuvres non théâtrales, Lorca, Pizarro et Zagal créent un PINOCCHIO d’après Collodi (1990), LOBO (d’après une nouvelle de Boris Vian, 1994) et un VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE très librement inspiré de Jules Verne (1995). À chaque fois, le groupe gagne en cohésion, en conviction, en discipline.
En 2005 ils décident de suivre des chemins séparés, Jaime Lorca d’un côté, Laura Pissaro et Juan Carlos Zagal de l’autre.