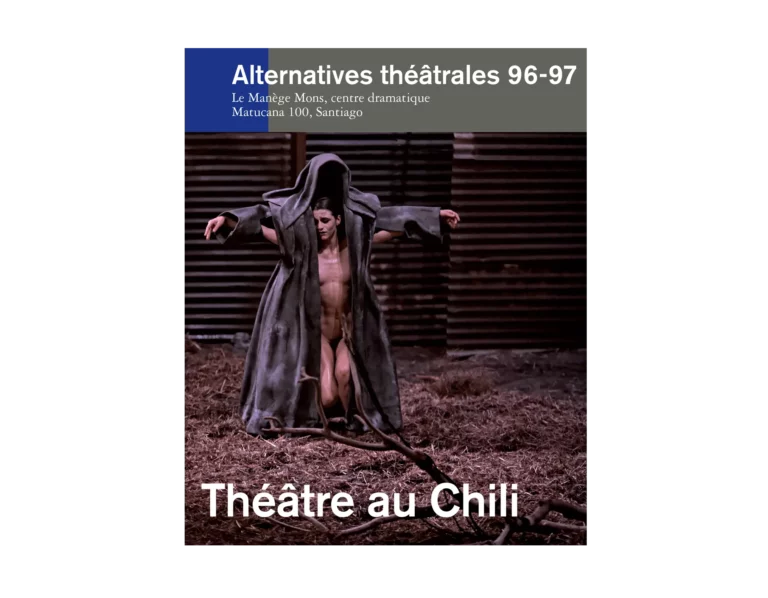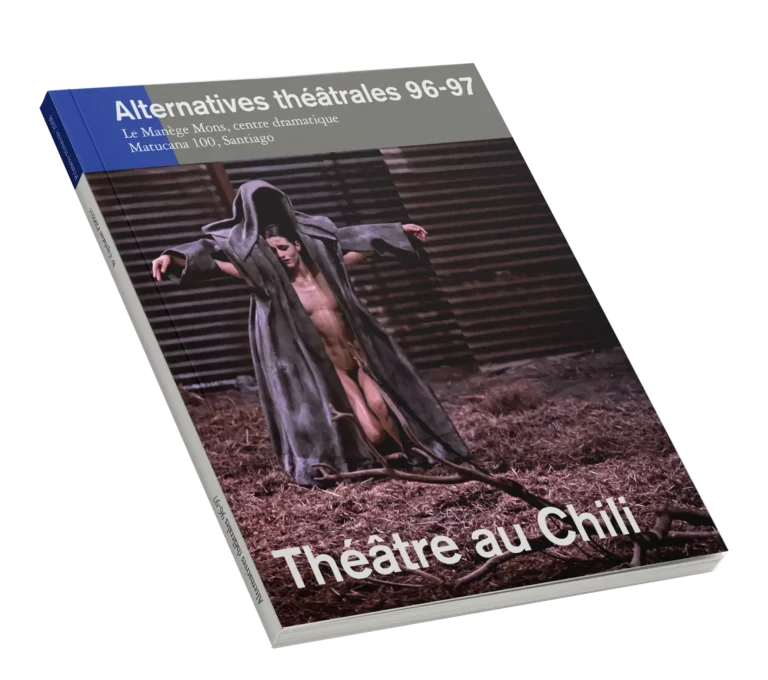LE CHILI est un pays fascinant. Pour les hommes et les femmes de ma génération, il est lié, entre autres, à l’immense espoir qu’avait fait naître la révolution démocratique conduit par Salvador Allende et la douleur que l’on ressentit quelque temps plus tard lorsque cette expérience s’arrêta brutalement dans la violence et le sang.
La longue nuit qui s’en suivit a laissé des traces profondes, et, on le verra, le théâtre a été un témoin privilégié de ces années obscures.
Dans l’article qui introduit ce dossier, Maria de la luz Hurtado explique que le théâtre fut pendant la période de la dictature un lieu de résistance que ne pouvaient pas être aussi facilement le cinéma, la télévision et la littérature, plus directement contrôlés par le pouvoir.
Lorsque la démocratie reprit ses droits, il appartint aux artistes de symboliser cette expérience, ce qui fut mené par une esthétique carnavalesque, une poétisation de la scène et progressivement la puissance de la parole reprit ses droits. Cela s’accompagna ces dernières années par une véritable explosion de la création (plus de deux cents créations théâtrales en 2006).
Figure emblématique véritablement nationale, Andrés Pérez, disparu en 2002, reste très présent dans l’imaginaire théâtral ; j’ai pu m’en rendre compte dans les nombreux contacts que j’ai eus lors des deux voyages effectués au Chili pour la préparation de cette publication.
Considéré par beaucoup comme le plus grand rénovateur du théâtre chilien, Andrés Pérez est devenu un héros au moment où, après la dictature, se vivait un climat de réconciliation nationale. Il fut l’animateur d’un théâtre massif et populaire empruntant au cirque, à la magie, à la pantomime, à la musique et à la danse en s’appuyant sur de grandes machines scénographiques.
Dans l’article qu’elle lui consacre Anna Harcha montre comment, comme pour Antonin Artaud, le théâtre d’Andrés Pérez est un rituel qui a à voir avec le sacré et que l’on n’atteint que par une grande ascèse de travail.
La dramaturgie chilienne s’est révélée diverse et prolixe dans la deuxième moitié du xxe siècle. C’est encore le cas aujourd’hui, où chaque année la Muestra de Dramaturgia nacional reçoit près de deux cents textes ongmaux.
J’ai demandé à Javier Ibacache de présenter dix figures emblématiques de la dramaturgie chilienne. On trouvera donc, dans cette livraison, les portraits de Luis Alberto Heiremans, Egon Wolff, Jorge Diaz, Juan Radrigan, Oscar Stuardo, Marco Antonio de la Parra, Benjamin Galemiri, Juan Claudio Burgos, Guillermo Calderon et Manuela Infante.
Pour chacun d’eux, Javier Ibacache a relevé les thèmes récurrents et les innovations de style et d’écriture. De la nostalgie, de l’inquiétude ou de l’angoisse au portrait social, du diagnostic sévère de l’isolement auquel conduit le confort matériel à la description de la marginalité, du réalisme du parler populaire gorgé de lyrisme à la réécriture des grands mythes universaux jusqu’à un langage parfois baroque, les auteurs de théâtre chiliens maîtrisent une écriture luxuriante, souvent métaphorique, où les petites histoires donnent rendez- vous à la grande Histoire.
Nous avons aussi pour ce numéro voulu présenter, avec l’aide de Soledad Lagos, deux cycles de spectacles qui ont marqué la scène chilienne de ces dernières années : LA TRILOGIE TESTIMONIALE du théâtre La Memoria d’Alfredo Castro, qui, à travers le traitement de la marginalité (la prostitution, l’univers des cliniques psychiatriques et la criminalité) a voulu aborder ces thèmes qui sont habituellement exclus de l’écriture de la mémoire collective et les accompagnent d’une recherche de nouveaux langages scéniques.
L’autre trilogie — LA PATRIE- mise en scène par Rodrigo Pérez pour le théâtre La Provincia, aborde le rapport entre l’histoire individuelle et sociale. Identité sociale, identité idéologique et identité individuelle ont été le fruit d’un long travail de recherche (deux ans) qui aboutit à une esthétique de forme chorégraphique qui exclut tout pathétisme et qui pourtant déclanche auprès du public de l’émotion.
Les travaux d’ Alfredo Castro et de Rodrigo Pérez ont eu un réel impact sur la nouvelle génération de créateurs de théâtre.
On ne peut penser théâtre au Chili sans donner la parole à Carmen Romero qui lui a donné, grâce au festival Santiago a mil, une véritable dimension internationale. Animatrice d’une équipe qui se revendique d’une sensibilité et d’une démarche « féminine », Carmen Romero s’inspire du travail coopératif hérité d’Andrés Pérez avec qui elle a longuement collaboré. Tout comme le pays a sa présidente, le festival a sa passonaria qui, tout en occupant un nombre important de lieux fermés durant le festival, veut défendre et présenter le théâtre de rue, assignant à l’art du théâtre d’occuper l’espace public. C’est la marque de Santiago a mil d’être à la fois populaire et tout à fait contemporain.
Autre figure marquante de ces dernières années, Ernesto Ottone a fait de Matucana 100 un lieu incontournable des arts de la scène chiliens. Son objectif de créer un nouveau public, d’opter pour un travail résolument multidisciplinaire et d’inventer de nouvelles formes de financement qui allie mécénat privé et subventions publiques a permis à tous les groupes de théâtre qui comptent de passer par Matucana 100 et d’y présenter leurs créations.
Ernesto Ottone s’est donné comme point d’honneur d’être à la croisée des demandes des artistes et de celles des spectateurs. Il a réussi son pari.
La venue en Europe de GEMELOS, spectacle de la Troppa a constitué un événement majeur. C’était la reconnaissance internationale après celle obtenue quelques années plus tôt par le groupe au Chili avec le spectacle PINOCCHIO. Jaime Lorca et Juan Carlos Zagal se considèrent comme les héritiers de la grande histoire du théâtre chilien. Pourtant leurs débuts furent difficiles, eux qui voulaient d’un théâtre qui soit une alternative à la vanité, à l’argent, à la télévision mais qui ne se privaient pas d’une esthétique empruntée à la BD et au cinéma.
À l’heure où Jaime et Juan Carlos ont décidé de se séparer pour vivre chacun leur propre vie, nous leur avons donné la parole, eux qui n’ont pas oublié que « la alegria ya v1ene ».
Parmi les troupes qui ont émergé dans le paysage théâtral, la Patogallina occupe une place forte et singulière. America Molina Burgos montre comment leur démarche se veut politique, à partir d’une scénographie et de costumes élaborés dans le souci d’une esthétique du quotidien. Leurs interventions dans l’espace public sont spectaculaires et le public s’y reconnaît entièrement.
Ramôn Griffera définit son théâtre Fin de siglo comme un lieu de résistance aux fictions de la réalité. Lui aussi s’inscrit dans la grande histoire du théâtre chilien, producteur d’une richesse et d’une variété présentes depuis près de deux siècles.
Il attache une grande importance à la définition de l’espace scénique, ce qu’il appelle une dramaturgie de l’espace, union entre les poétiques du texte et les poétiques de l’espace.
Parmi les thèmes présents dans son œuvre, on trouve l’idée centrale que les fictions servent à démasquer notre monde environnant. Il a commencé à écrire pour résister aux discours de la dictature. Il n’hésite pas à traverser plusieurs périodes de l’histoire et à développer une écriture oningue.
Une partie importante de ce numéro rend compte à partir d’entretiens et de textes de l’aventure intercontinentale d’AMARRADOS AL VIENTO. Il fallait une bonne dose d’audace et d’utopie pour mener à bien ce projet qui rassemble artistes belges et chiliens. Deux auteurs, Juan Radrigan et Veronika Mabard ont eu le courage de se livrer à une écriture croisée. Comme le dit le metteur en scène Étienne van der Belen, il s’agissait de partir et arriver ensemble de la page blanche au rideau rouge. Le miracle, c’est que partant d’une petite pension de Valparaiso, la pièce a abouti à une problématique universelle : comment vivre dans le monde d’aujourd’hui…
Les auteurs se sont jetés dans la langue, les acteurs leur ont emboîté le pas …
Il y a entre Royal de Luxe et le Chili une véritable histoire d’amour. Il fallait pour sen convaincre assister à la traversée de Santiago par la petite géante en janvier 2007 devant 800 000 personnes !
Le succès de l’entreprise, comme le soutient Pedro Celedôn, tient sans doute au défi de Royal de Luxe de créer un dialogue avec des individus isolés, déconnectés de leur environnement et éloignés de tout rite collectif. La troupe explore les limites de la confusion entre fiction et réalité, jeu et manipulation technique et prend le parti d’une vision muliculturelle et multi ethnique (PETITS CONTES NÈGRES).
La rue est généralement occupée de manière fragmentaire par les manifestations politiques, les supporters de football ou par des actes de protestation. Avec Royal de Luxe, il s’agit d’une occupation festive des espaces publics.
La présence au Chili de Royal de Luxe est significative de la relation ancienne et privilégiée qui existe entre la France et l’Amérique latine. Amalà Saint-Pierre analyse cette relation qui s’est cristallisée sous la dictature par l’exil en France de trois grands artistes chiliens : Oscar Castro, Andrés Pérez et Mauricio Celedôn. Ce dernier a d’ailleurs constitué une véritable compagnie franco-chilienne, assuran ces créations tantôt en France, tantôt au Chili.
Celedôn et Pérez ont tous deux été acteurs au théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine. C’est sans doute pour cette raison qu’ils envisagent le théâtre comme un art total, proposant une forme qui allie le rite, la fête, la théâtralité des corps et des mouvements, l’expérience du collectif et du baroque. Santiago a mil multiplie aussi les coproductions franco-chiliennes et a programmé à plusieurs reprises des spectacles français.
Nombreux aussi sont les auteurs français présents sur la scène chilienne (Valère Novarina, Noëlle Renaude, Michel Vinaver, Véronique Olmi, Joël Pommerat … pour n’en citer que quelques-uns).
Nous avons clôturé ce tour d’horizon de la scène chilienne par une petite incursion dans le domaine de la danse grâce à la collaboration de Javier Ibacache qui s’est entretenu avec Elizabeth Rodrìguez. On peut, en suivant le parcours de cette chorégraphe, suivre l’évolution de la danse au Chili. Initiée au départ par les techniques de Martha Graham, Elizabeth Rodrìguez rencontre Patricio Buster, figure marquante de la danse au Chili dans les années 80. Grâce à une bourse, elle poursuit sa formation aux États-Unis au centre du Movement research. De retour au pays, elle s’engage progressivement dans une remise en question de l’art traditionnel de la danse et expérimente de nouveaux langages. Comme beaucoup d’artistes de cette époque, elle était prise dans le dilemme entre le cheminement de l’expérimentation propre et l’engagement dans la lutte contre la dictature. Ce n’est qu’au terme d’un long parcours qu’elle se débarrasse des aspects narratifs pour se concentrer sur la mémoire des corps tout en menant une approche pluridisciplinaire (travail avec des sculpteurs et intégration d’éléments audiovisuels). Elizabeth Rodrìguez a aussi participé comme interprète à la trilogie LA PATRIA mise en scène par Rodrigo Pérez.
Le hasard a voulu que je rencontre Dominique Mercy à Santiago lors de la présentation en janvier 2007 de A MASURCA FOGO, chorégraphie de Pirra Bausch.
Dominique Mercy animait à cette occasion des stages pour danseurs dans le cadre de Santiago a Mil et a pu voir plusieurs spectacles de danse. Il a été touché et ému par le lien, l’espace mental entre ces spectacles. Comme moi, il a été frappé par la contradiction que l’on ressent entre la gentillesse, l’amabilité, la tranquillité des rencontres avec les Chiliens et l’explosion de la violence qui surgit souvent dans les spectacles sans que l’on en comprenne véritablement la raison. Comme il le dit poétiquement : chaque Chilien est un volcan.