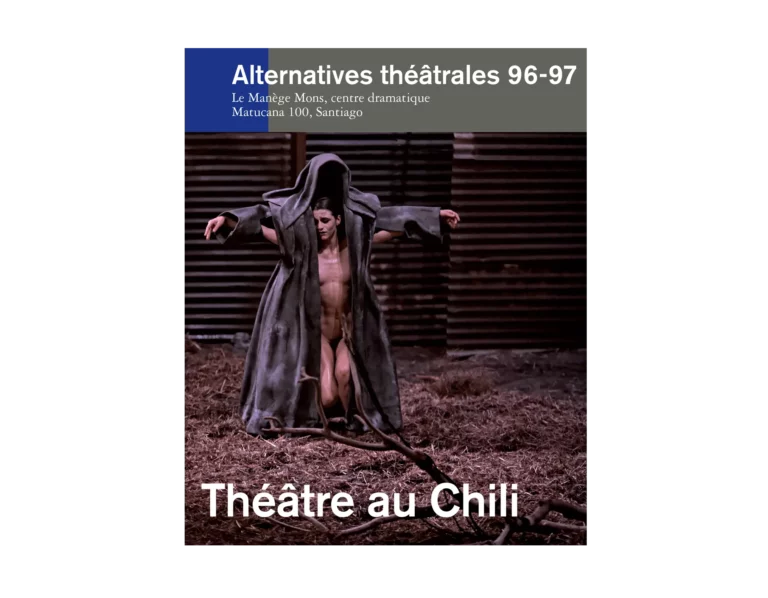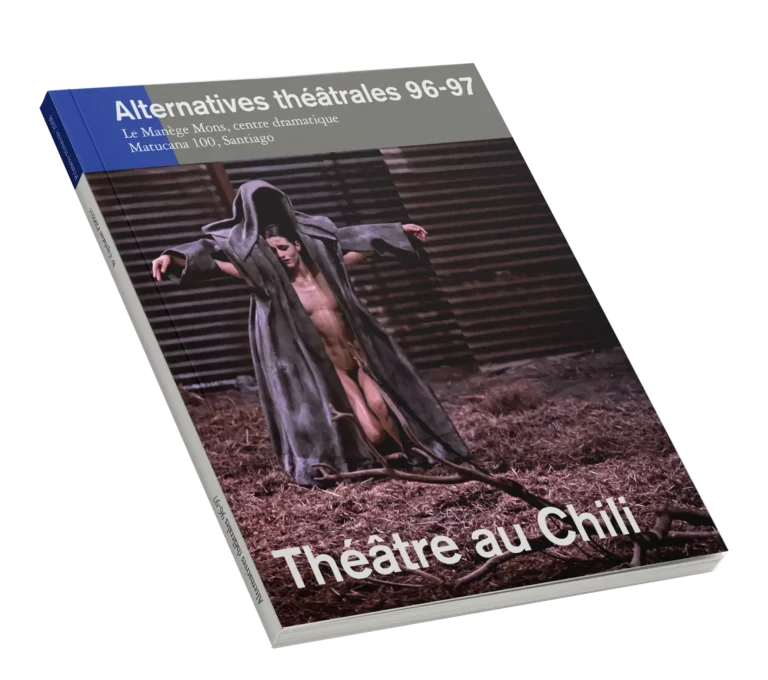BROSSER UN TABLEAU des différentes tendances du théâtre chilien depuis le retour de la démocratie en 1990 jusqu’au début du xxre siècle est un défi qui comporte bien des difficultés. Afin de mener à bien cette tâche, j’appliquerai, pour le théâtre, la notion d’ « historicité », donnée cruciale dans l’élaboration de la réalité qu’entreprend le créateur à partir de territoires marqués, démarqués et transcendés par une relation sujet/ corps historique qui implique, à son tour, la tâche de trouver l’image ou les images qui auront un impact sur la sensibilité historique du spectateur qui se confronte aux événements représenté sur scène1.
Il est important de préciser que le champ théâtral de Santiago, siège principal du théâtre professionnel chilien, est à la fois dense et multiple, puisqu’au solide noyau de théâtre universitaire et indépendant, qui a maintenu ses activités pendant la dictature militaire (1973 – 1990), il faut ajouter les groupes formés dans les écoles universitaires2 , ce qui représente un ensemble comprenant des dizaines de compagnies en activité dans les anciennes et nouvelles salles et dans les espaces non traditionnels. L’accroissement est exponentiel : en 2006, il y eut environ deux cents créations (contre vingt en 1960, quarante en 1970 ; en 2000 on comptait environ cent créations d’auteurs nationaux et soixante d’auteurs étrangers). Le nombre donne-t-il lieu à des sursauts qualitatifs ? Pouvons-nous voir quelques constantes dans ce champ pluriel et hétérogène ?
Je crois qu’il existe des courants souterrains, des séries en puissance ; des traditions actoriales et des esthétiques revisitées, des écolesque l’on peut clairement identifier malgré leur caractère mouvant. Pour les comprendre, il est important de les considérer à deux moments histo- riques qui s’opposent clairement mais qui présentent, c’est mon postulat, un lien sous-jacent.
Pendant les dix-sept ans du Gouvernement Militaire dirigé par Pinochet, la résistance culturelle s’est centrée fortement sur le théâtre, car le cinéma, la télévision et l’industrie éditoriale étaient sous le contrôle d’une censure acharnée. Le théâtre a accompagné de très près les discussions critiques, la dénonciation, l’expression d’une sensibilité blessée par les nets changements culturels et sociaux que vivait le pays. Avec la distance, on peut y voir une période héroïque où l’on prenait à la fois des risques personnels et des risques artistiques soutenus par un public qui célébrait et partageait une telle démarche. Il y avait un « sens » qui unissait le travail théâtral à sa propre identité.
Dans un deuxième temps, lorsque la Dictature a été supplantée en 1990 par le premier gouvernement centre-gauche de la Concertation pour la démocratie, les diagnostics des pratiques culturelles ont cessé d’être nets et consensuels. Une opinion assez répandue affirme que le théâtre post-dictatorial en Amérique Latine, le Chili inclus, répond à des obsessions d’auteurs ancrées dans des biographies particulières qui ne sont représentatives ni d’un prétendu espace national ni de l’époque en cours. Cette appropriation du privé serait une évasion de la mémoire, une volonté d’oublier une histoire politico- sociale des plus douloureuses et conflictuelles vécue récemment. Ce serait un théâtre dépolitisé, tourné vers des sous-groupes dont la capacité à réunir le public décroîtrait en même temps que son historicité.
Je m’inscris en faux contre ce diagnostic : je pense que la mémoire historique ainsi que les thèmes les plus pressants de l’actualité constituent bien le matériau et le référent du théâtre chilien post-dictatorial, mais ils sont abordés d’une manière très différente de celle du mouvement théâtral antérieur. Témoigner ou dénoncer ne suffit plus : la reprise des pratiques politiques et des mouvements sociaux qui ont œuvré à la fin de la dictature ont assumé cette tâche. Cela a conduit à mettre en place un courant de re-théâtralisation de la scène pour accéder à d’autres dimensions encore absentes de la conscience sociale : on est passé de la chronique socio-politique à la symbolisation artistique de l’expérience. De nouveaux paradigmes esthétiques sont apparus qui se sont traduits par une explosion de formes d’expression empreintes d’ambiguïté ou de poésie et conjuguant données personnelles et historiques.
C’est une transition difficile qui consiste à redéfinir le rôle du théâtre et à repenser ses besoins et ses modes d’expressions3. En fixant le regard sur lui-même, le dramaturge se reconnaît comme sujet en situation de conflit et d’autoréflexion. Bon nombre de pièces prennent comme protagonistes des créateurs du champ poétique, dramatique ou de la pensée scientifique innovante, considérant que les conflits existentiels et politiques de la création sont comparables et servent de point de départ à une réflexion sur les aspects sociaux dans leur ensemble.
Au début de ce nouveau mouvement, proche de l’instauration du gouvernement de la Concertación, un théâtre plus symbolique et hermétique se met en place et, au fur et à mesure que s’écoulent les dix-sept années de ces gouvernements et que les problèmes du modèle économique néocapitaliste et de la politique du consensus affleurent, les thèmes non résolus de la mémoire et de l’équité ressurgissent dans un théâtre critique et référentiel. Je développerai ces deux transformations en évoquant deux périodes de ce devenir : les années 1990 et ensuite le début des années 2000.
Sensibilités fin de siècle : les années 90
Les années 90 s’ouvrent sur une nouvelle sensibilité, un nouveau positionnement du théâtre face à lui-même et à la société. C’est une génération de rechange qu’en assure la conduite, particulièrement sous la férule de metteurs en scène qui créent leurs propres pièces, projetant et promouvant ainsi leur esthétique scénique. Cette génération qui n’a pas vécu la période antérieure au gouvernement militaire et n’a pas baigné dans le contexte restrictif des années 70 et grande partie des années 80.
Lare-connexionqui s’ensuit adopte les clés d’interprétation mondiales fin de siècle, qui coïncide avec la chute des utopies et avec un climat intellectuel postmoderne qui, loin de prôner radicalement des positions propres à l’ère moderne, s’ouvre au contraire à une multitude d’expériences et de sources d’inspiration, allant des plus archaïques à la culture audiovisuelle mondialisée.
La volonté de mettre en forme dramatique et scénique pose une série de questions, qui relèvent plus de l’exploration sensitive que de certitudes rationnelles, se traduit par un langage de la distorsion, de l’extrapolation, de la fragmentation du récit et des personnages. Le réalisme bat en retraite face au grotesque, excessif et carnavalesque, ou à la stylisation onirique fortement symbolique, qui épure la scène et tend vers le minimalisme.
Lucidité carnavalesque
Le grotesque fait son apparition avec toute la panoplie de la mascarade médiévale et un jeu avec les éléments scéniques. Des personnages mis en relief par des masques et des costumes archétypiques se déplacent sur des plateaux immenses, avec une gestuelle dynamique, souvent expressionniste, qui évoque un rituel ancré dans des traditions populaires récupérées avec un regard ironique, festif et dépourvu de préjugés.
Ce théâtre syncrétique par excellence réunit les courants américains, européens et orientaux les plus divers, mêlant théâtre, cirque et guignol, commedia del l’arte et théâtre stanislavskien. Ce courant croit en la capacité du grand spectacle théâtral à réunir des foules pour partager avec elles une fête des sens et renouer avec une dramaticité inscrite dans ses racines et son identité collective. L’histoire, le passé, devient ainsi métaphore du présent et son actualisation théâtrale récupère, simultanément, le sens de la comédie grotesque et de la tragédie.
Dans ce mouvement, on peut remarquer les créations d’Andrés Pérez et son Gran CircoTeatro, LA NEGRA ESTER(La Noire Esther), 1988, POPOL VUH, LA CONSAGRACIÒN DE LA POBREZA, (Le Sacre de la pauvreté), MADAME DE SADE, NEMESIO PELAO QUÉ TE HA PASAO (Nemesio le pelé, que s’est-il passé), 1995 ; les travaux de la compagnie El Sombrero Verde, EL DESQUITE (La Revanche), 1995 ; ainsi que les mimodrames de Mauricio Celedón (OCHO HORAS, TACA-TACA MON AMOUR);ceux du Circo Imaginario d’Andrés del Bosque EL TONY CALUGA ou EL PAPAY LA VIRGEN, (Le Pape et la vierge); la production polyvalente du Teatro Imagen sous la direction et création auctoriale de Gustavo Meza, MURMURACIONES ACERCA DE LA MUERTE DE UN JUEZ (Rumeurs autour de la mort d’un juge); LA REINA ISABEL CANTABA RANCHERAS (La Reine Isabelle chantait des rancheras). Certaines de ces œuvres sont basées sur des auteurs chiliens (Roberto Parra, Alfonso Alcalde, Hernan Rivera, Cristian Soto), sur des mythes américains ou sur des auteurs d’autres latitudes (Dario Fo, Mishima).
Le groupe La Troppapartage ce ludisme carnavalesque mais, dans son parcours à travers le conte fantastique, il utilise une imagerie magique, surprenante, pléthorique en effets scénographiques. Parallèlement à son archaïsme référentiel, il convoque le langage de la BD, du cinéma, avec gags, changement de cadrage, d’angle de vue et tord le récit jusqu’à en extraire son essence. Le groupe adapte, avec une forte charge personnelle, des romans d’aventures mettant en scène le parcours initiatique de héros à la recherche de leur humanisation, comme
EL QUIJOTE (Cervantes, dans EL RAP DELQUIJOTE, Le Rap du Quichotte, 1989), PINOCCHIO (Collodi), VIAJE ALCENTRO DELA TIERRA,Voyage au centre de la terre (Verne), GEMELOS(,Jumeaux), 1999, basée sur LE GRAND CAHIERd’Agotha Kristof, et JEsûs BETZ, 2003, Bernard y Roca).
La vivacité de ce théâtre, qui exorcise les séquelles générées par le fait d’avoir été « enfant de la dictature », d’avoir grandi sans parents, sans maîtres et qui, pendant les années 90, a conduit le groupe à changer de nom — Los que No Estaban Muertos ( Ceux qui n’étaient pas morts) sont devenus La Troppa- nous révèle un esprit nouveau, inimaginable pour le Chili des décennies antérieures.