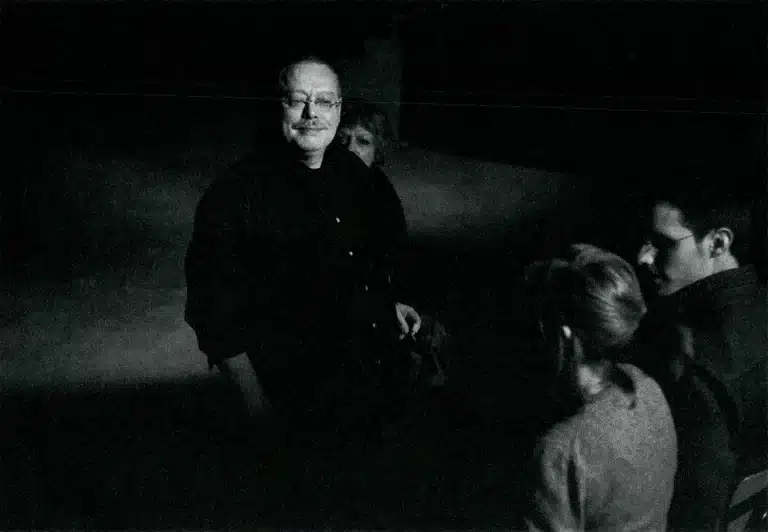BERNARD DEBROUX : Partant de l’idée que l’enseignement moderne du théâtre est concomitant de la naissance de la mise en scène, peut-on concevoir la mise en scène comme l’acte de créer un acteur différent ? Lié à cette première interrogation, s’agit-il de créer un acteur pour soi ou un comédien autonome ?
Jacques Delcuvellerie : Cette dernière partie de la question est plus à poser aux écoles qu’à la mise en scène. À savoir si l’école doit former des comédiens autonomes, c’est-à-dire capables d’autonomie (pas une autonomie autoproclamée). Autrement dit, des gens très informés, aussi bien des traditions que de la création contemporaine et dont la formation a rencontré à différents moments, sur le terrain de la pratique, des épreuves qui leur permettent, plus tard, soit de se plier à des exigences dramaturgiques très diverses, soit d’affirmer leur propre singularité, si possible les deux. Voilà pour la question de l’école.
Pour la question de la mise en scène, est-ce qu’on se fait un acteur « à soi » et dans quelle mesure cela postule-t-il un « nouvel » acteur ? Ce « nouveau » fut-il défini, comme le plus souvent, non pas comme un acteur du présent ou du futur, mais comme celui qui « retrouverait » l’essence archaïque, et comme originelle, de cet art.
Tout dépend du sérieux qu’on met, de la profondeur qu’on confère au mot création. Si on est vraiment dans la création (c’est-à-dire avec l’effroi, comme dit Millier, de ce qu’est le surgissement du nouveau qu’on réussirait à faire advenir), alors, pour du nouveau, il faut sans doute un nouvel acteur. C’est la raison pour laquelle au moment où on veut un théâtre beaucoup plus en accord avec l’évolution de la société fin XIXᵉ — début XXᵉ, on voit surgir à la fois une nouvelle manière de faire du théâtre, je pense bien sûr au Théâtre d’Art de Stanislavski comme symbole majeur, et une nouvelle formation, une nouvelle pédagogie.
Il n’y a d’ailleurs pas de pédagogie intéressante de l’acteur qui n’ait été liée d’une manière ou d’une autre à l’accouchement de nouvelles dramaturgies (je parle bien sûr d’un temps révolu où le terme « nouveau » n’était pas totalement dévalué et illégitime comme aujourd’hui).
Pour pouvoir jouer le théâtre de Brecht, comme il l’imaginait, comme il n’a cessé de le ré-imaginer, son point de vue sur la formation et les capacités des acteurs a aussi changé et c’est bien évidemment qu’il leur demandait des capacités et des moyens d’expression et des valeurs différentes de celles auxquelles ils étaient habitués dans le théâtre qu’il considérait comme aristotélicien, bourgeois, etc. C’est également la même chose quand Grotowski a voulu confronter à un acte, un acte total qui transcende, disait-il, Éros et Caritas… Donc, une telle violence d’ébranlement intérieur, qu’il fallait que l’acteur soit capable d’un dévoilement intime, un être sans masque.
Mais, paradoxalement, pendant tout le temps où Grotowski a fait du théâtre, cet acteur saint devait emprunter quand même le chemin d’un personnage, même si ce personnage était réélaboré à partir de lui-même, dans un hiéroglyphe indémêlable, comme le Prince de Cieslak. On a eu tort de voir dans Grotowski ce qui a fasciné de prime abord : une richesse expressive à la palette beaucoup plus étendue que d’ordinaire en Occident (où l’on se contente vite de la présence en scène et de l’usage varié du langage parlé) pour le doter d’un corps nouveau, de voix nouvelles. Or, en réalité, toute cette richesse expressive n’était qu’une ascèse pour l’acteur, afin d’arriver à cette espèce de simplicité, de dévoilement intime qui ébranle au plus profond le spectateur.
Pour atteindre ce résultat, il fallait tout à fait un acteur nouveau dont Richard Cieslak est évidemment l’exemple le plus rare. Le rêve s’est peut-être incarné une fois.
Presqu’à l’opposé, pour pouvoir jouer dans le style à la fois farcesque, semi-improvisé, enraciné dans la tradition populaire, de certaines des meilleures pièces de Dario Fo, il faut aussi un acteur qui ait un entraînement et, au-delà de l’entraînement, des racines, ou qui tente de retrouver des racines qui ne sont pas souvent mises en jeu dans d’autres types de répertoires. Rien à voir avec Pirandello ou Ibsen, par exemple. On ne peut pas plus jouer Mistero Buffo que Le Prince Constant ou Mère Courage, sans que l’acteur ne se « refasse ».
La question est maintenant : est-ce qu’on accouche encore du nouveau ? c’est-à-dire de la création au sens de l’in-ouï. La position du Groupov depuis longtemps, c’est que ça n’advient plus, ni en littérature, ni en musique, ni au théâtre. On a le post-modernisme avec tous les mixages possibles et imaginables, mais il n’advient pas de l’in-ouï. Par conséquent, on peut se contenter des acteurs avec ce qu’ils savent faire, ce qui fait que, au-delà du répertoire, au-delà de ce qui se dit, qui est mis en jeu sur le plateau, le plus souvent, ce qu’on voit, c’est la réitération lourde ou légère, naïve ou insignifiante, séduisante ou lassante, voire brillante et sincère, du déjà-vu. Sur le plan de l’ébranlement théâtral, sur le plan du langage théâtral, la réitération de choses déjà depuis longtemps explorées.
Je peux prendre des exemples au-delà de mes préférences personnelles et de ce qui a pu avoir un rôle direct sur mon trajet. Prenons Robert Wilson. Dans les premiers spectacles de Wilson, il y a Christopher Knowles, qu’on ne peut pas appeler un acteur ; il y a Lucinda Childs, il y a Sherryl Sutton, il y a des gens qui, dans ces expériences, ne sont pas strictement des acteurs. Parce qu’on déplace et on ébranle le caractère traditionnel de la représentation, quelque chose de fort et d’indéfinissable naît. Naturellement tout ça se fige à un moment donné. On passe de la magie au maniérisme, parce que ce qui seul ébranle profondément, c’est le « naissant », l’espace « naissant », le signe « naissant », parce qu’il naît à la surprise même de ses géniteurs, avant la maîtrise, dans le mouvement d’invention obligée d’une maîtrise incertaine…
Lorsque, après Kanami Kiyotsugu, son fils Zeami, après une longue maturation, fusionne différentes formes d’expressions traditionnelles japonaises pour créer le Nô, on est devant l’accouchement d’un nouvel acteur. Et après, pendant des siècles, on essaye de maintenir vivante, dans une tradition, une chose qui a été inventée à la recherche de sa maîtrise dans l’incertitude même de sa naissance. Est-ce que la fleur dont parle Zeami en décrivant le trajet individuel d’un acteur peut à nouveau s’épanouir sur des siècles, dans le maintien d’une tradition ? Question très complexe.
Si on redescend d’un étage et qu’on prend la création dans un sens plus restreint, c’est-à-dire : on monte une nouvelle pièce, on fait une nouvelle « création » à partir d’un thème contemporain ; peut-être alors n’a‑t-on pas besoin d’un acteur « nouveau » au sens où Cieslak aurait été nouveau par rapport à Louis Jouvet, mais on a besoin d’un chemin nouveau. Si la création a une haute singularité, sans doute faut-il suivre, pour accoucher de la théâtralité de cette création avec des acteurs, entre autres, un processus de gestation de cette création qui soit lui-même singulier, qui décale l’acteur par rapport à son processus habituel.
Si je retourne à ma propre expérience, les créations significatives du Groupov ont suivi des chemins, des méthodologies qui commençaient d’ailleurs souvent par ce que nous appelions des opérations de décalage. Elles se sont inventées chaque fois un processus spécifique qui n’est en aucune manière celui qui veut qu’on dispose d’un texte, qu’on se laisse émouvoir et interroger par lui, qu’à partir de là on se renseigne par de la documentation, qu’on questionne la dramaturgie, qu’on fasse des voyages, des rencontres, etc., et puis qu’on commence à expérimenter en répétitions notre première lecture élaborée de la pièce et qu’on passe ainsi progressivement vers la représentation.
Non. Avec ce chemin classique, vous avez une théâtralité et en particulier un jeu de l’acteur « classique », quel que soit le contenu. Brook, entre autres, rappelait déjà cela dans L’Espace vide. Cela ne veut pas dire que le résultat sera inintéressant ou inadéquat à son objet. On n’est simplement pas sur la voie de l’in-ouï, la recherche fût-elle maladroite ou naïve. L’important est qu’il faut penser et expérimenter ces chemins. L’académisme, le théâtre clé sur porte, c’est un non-chemin, et le « happening » pur aussi. Pas de chemin, c’est reconduire des clichés. Un dernier classique, un siècle né classique.
Mais les créations les plus troublantes de ces dernières années, dans le monde, ont suivi d’autres chemins. Chemins, chaque fois, non seulement particuliers au créateur et à l’équipe qui les a portés, mais sans doute différents aussi selon les spectacles et les créations.
B. D.: Reprenant une distinction proposée par Georges Banu, on peut concevoir dans la pédagogie du théâtre une première catégorie qui serait la pédagogie frontalière : à partir de Stanislavski se créent des ateliers, des laboratoires, des studios qui se trouvent à la frontière du spectacle proprement dit, où la formation se développe en amont de la représentation. La seconde catégorie, qu’il appelle une pédagogie de l’intérieur (Brook, Mnouchkine, Grotowski) se développe totalement en fonction du spectacle à créer, le théâtre est pensé comme un site pédagogique en lui-même. Comment le Groupov se situe-t-il par rapport à ces deux démarches ? Il me semble que dans certaines expériences, le travail qui est mené au départ semble loin de ce qui va advenir…
J. D.: Si on parle du Stanislavski « frontalier », on se trouve effectivement dans un lieu étrange, à mi-chemin entre l’école et le théâtre : les différents studios à caractère plus expérimental qu’il a animés ou qu’il a laissé s’autonomiser plus ou moins. Il est quand même le maître d’école le plus rigoureux et le plus ouvert du XXᵉ siècle. Après, de « l’intérieur », Brook, Mnouchkine, Grotowski développent une formation de l’acteur directement en vue de la création, c’est-à-dire : « comment se rendre capable de quoi » ; voire, comme au Groupov du début : « comment se rendre capable de ce qu’on ne sait pas qu’on sait » ?
Au Groupov, je me souviens de Trash (a lonely PRAYER), 1992, où il s’agissait de comment nous rendre capables de porter une parole de femme, obscène, furieuse et en même temps politique. Spectacle de femme écrit principalement par une femme. Quel type de décalage, de processus, de méthode faut-il inventer pour pouvoir porter ça, pour pouvoir habiter cette langue ? Nous avons inventé des décalages très particuliers. Et c’est évidemment complètement différent si on travaille sur le génocide comme dans Rwanda 94 où il y a par moments des formes limites de la représentation, avec le témoignage de quelqu’un qui n’est pas acteur, avec une cantate, une conférence…
« Comment se rendre capable de quoi » est bien l’objectif des répétitions. Sauf que le mot répétition est inapproprié pendant longtemps dans une véritable création, puisqu’il s’agit en même temps d’accoucher et d’apprendre, de découvrir et de tracer un chemin. Dans l’idéal même : d’entrer dans un territoire inconnu dont on ne sait pas comment ça fonctionne, ce qu’il nous réserve. Ça a commencé dès le début, puisque les tout premiers travaux du Groupov étaient basés sur ce que nous appelions les « écritures automatiques d’acteurs », c’est-à-dire : comment accoucher de ce qu’on ne sait pas qu’on sait ? Comment apprendre à survivre d’une manière expressive à quelque chose dont on est soi-même, littéralement, stupéfait ? Ce que j’appelle chevaucher le tigre. Là où il y a un danger, ce qui fait la valeur ici / maintenant de l’acte en scène. C’est très loin de ce qu’on appelle la répétition au sens classique.
Ce qui fait que quand on parle de transmission, on devrait plutôt parler d’exemple, de modèle, d’incitation, car ce qu’on peut transmettre dans une démarche de ce type, c’est précisément cette attitude et les formes que prend cette attitude selon les défis qu’on se pose. J’ai à un moment tel défi et je l’ai rencontré de telle manière. Mais on ne peut pas léguer en tant que tels des exercices car ils seront inappropriés à ce que la personne qui voudrait s’en emparer doit inventer elle-même.
D’un autre côté, à l’école, je crois très fort aujourd’hui à l’inverse, à la nécessité de transmettre au sens presque scolaire du terme, car c’est une forme de résistance à la marchandisation, la réification, la spectacularisation généralisées qui sont basées, pour l’acteur, sur la vente d’une image de soi — à peine modifiée — on lui demande de « rester lui-même », avant tout. C’est, pour nous, à l’école, une forme de résistance et en même temps une condition pour une création authentique que d’être très informé de ce qui nous a précédé et de ce qui nous entoure. Pas seulement par une connaissance indirecte, par exemple par un excellent professeur d’histoire du théâtre qui vous montre des vidéos, qui vous commente Pina Bausch aussi bien que les ballets russes et qui va de Meyerhold à Castellucci. Non, il faut aussi organiser des épreuves, des confrontations pratiques avec tout ça.
Je crois qu’il est nécessaire qu’un jeune acteur, un jeune metteur en scène qui veut aujourd’hui définir sa propre parole, son propre « être-en-scène » doive avoir rencontré un jour les grandes exigences du grand style versifié, tragique, et à un autre moment le jeu dialectique, mesuré, réservé, calme et signifiant, brechtien. Toute cette pratique du gestus, etc. C’est important d’en faire soi-même l’expérience avec une forme de guidance pour découvrir physiquement et mentalement ce que ça exige de vous.
C’est donc une forme de résistance parce que l’art de l’acteur est tout le temps annihilé dans des formes de représentation de plus en plus proches du quotidien et que ce sont des dimensions entières non seulement du passé mais de l’homme qui s’effritent et qui le diminuent.
Je relis pour l’instant l’autobiographie de Müller, Guerre sans bataille, qui doit être de l’hébreu et du chinois pour les jeunes générations. Qu’a signifié l’Allemagne de l’Est, le parti, les guerres, là-dedans, comment se frayer sa propre voie, comment accoucher de sa propre écriture de représentation authentique ? Voilà des questions très spécifiques à une tranche d’histoire dans un espace européen particulier. Mais elles ont aussi une valeur plus générale. Une des choses qui m’a frappé le plus en le lisant aujourd’hui, c’est son insistance presque désespérée sur la disparition du tragique, le refus du tragique dans la société contemporaine. L’accent mis partout sur l’ironie, voire le cynisme quand ce n’est pas la blague de potache. Il dit que son théâtre n’est pas du tout ironique. La plupart des mises en scène qu’il n’a pas assumées lui-même, il pense qu’elles l’ont effacé en esthétisant cette dimension tragique. Retrouver ce qu’est le sens du tragique, et ce que sont les formes d’expression du tragique qui sont de grandes formes, comme, par exemple, dans la tragédie française, l’alexandrin, avec une musicalité habitée, pas une musicalité formelle, et qui pourtant répond à des règles précises, qu’un jeune acteur retrouve ça, comprenne ce que ça demande de lui au niveau vocal, mental, au niveau de la sollicitation (à travers une partition gestuelle, vocale) de l’inconscient jusqu’à une profondeur qu’il ne soupçonnait pas, cela me paraît une expérience de résistance contre la déshumanisation ambiante et contre un style hégémonique aujourd’hui du « naturel » et du quotidien, qui banalise tout, même si on dit des horreurs ou si on simule des choses soi-disant violentes.
Je me souviens d’une adaptation d’Andromaque vue en Avignon, il y a quelques années, avec des répliques comme « Oreste, vous êtes un enculé ! » Oreste : « Je suis un soldat ». Gros rires dans les gradins. Tout le monde est rassuré, on est « post-moderne » (Jarry est loin) et on sait que rien ne viendra vous perturber réellement. Ouf ! triomphe…

Je pense que si nous avions quelque chose à transmettre, c’est : à contre-courant. Qu’est-ce que c’est le tragique ? Qu’est-ce que c’est représenter de l’Autre ? Toute cette problématique du personnage sans laquelle Stanislavski est complètement superflu et incompréhensible.
Le comédien aujourd’hui, dans les écoles, est de moins en moins entraîné à toute cette chose extrêmement complexe : penser dans la tête d’un autre, être dans la tête et le corps et les pulsions et la langue d’un autre, avec ses propres moyens, son propre corps, son propre imaginaire. Généralement, non seulement on s’arrange de lui tel qu’il est, comme au cinéma, mais on lui apprend que cet « Autre » n’existe pas (quelle découverte !), et qu’il n’a donc en rien à entrer dans cet enfer de double bind qui est l’essence même de son art. Non, « sois toi-même ! » lui dit-on, ce soi-même étant donné d’avance.
L’art du comédien se réduit désormais le plus souvent à ce que j’appelle l’être du casting. On lui apprend à aimer de lui ce qu’il dégage, tout en lui mettant les paroles de Marivaux, de Corneille ou de Shakespeare dans la bouche. On trouve complètement idiot, ringard, superflu, l’idée qu’une figuration imaginaire qui s’appelle le personnage et qui naturellement n’a pas d’existence intangible, perpétuelle, mais qui est une stimulation résistante, soit nécessaire au travail de sa création. Ce renoncement narcissique est une chose terrible qui rabaisse l’art de l’acteur au reality show. Mais ce n’est pas ça jouer, au théâtre, où on doit faire entendre la parole et figurer l’incarnation du mort et des morts. Je fais entendre dans mon corps vivant, si c’est Eschyle, une parole de plusieurs milliers d’années. Tenir compte de cet écart, tout en sachant qu’on ne pourra pas le combler, mais faire des pas au-dessus de cet abîme, donc, au moins, avoir conscience de cet abîme, c’est devoir exiger de soi beaucoup plus que de venir avec son charme naturel en train de parler avec « naturel » (l’horreur !) un poème avec lequel on n’a a priori vraiment plus rien à voir au premier degré, et faire « comme si c’était proche » et que ça ne me demandait pas quelque chose qui est un profond remodelage de mon être-en-scène.
C’est une des raisons pour lesquelles je suis devenu maintenant un farouche partisan, pour certaines pratiques, de la copie intelligente. Comprendre pourquoi tout le monde a voulu s’éloigner du Berliner de la grande époque en disant : c’est le musée. Alors que le musée est aujourd’hui très intéressant, il est à contre-courant. Faire l’effort de mettre ses pas dans les pas d’un autre et voir en quoi on est différent, en quoi on peut apprendre en ne mettant pas en avant cette différence pour justifier qu’on est plus capable de représenter ce qui est exigé par tel ou tel type de théâtre, que ce soit Brecht, le tragique ou la comédie farcesque, c’est entrer dans le processus de déshumanisation, de nivellement, de cynisme et de cabotinage dominants. Dans le travail avec l’acteur pour une création, dans un travail de formation, il est essentiel de mesurer la distance qu’il y a entre nous et les œuvres, y compris quand c’est une œuvre qu’on porte en soi, et de mesurer tout ce qu’on doit changer en soi pour avoir le droit de monter sur scène.
B. D.: Une autre distinction que propose Georges Banu est celle de la pédagogie processus et son auxiliaire, le temps, indispensable de la formation, et la pédagogie événement. Dans la pédagogie processus, on est dans l’évolution, dans l’intime, alors que dans la pédagogie événement, on fait plus confiance à un désir, à un éblouissement, à une rencontre inhabituelle, à un décalage.