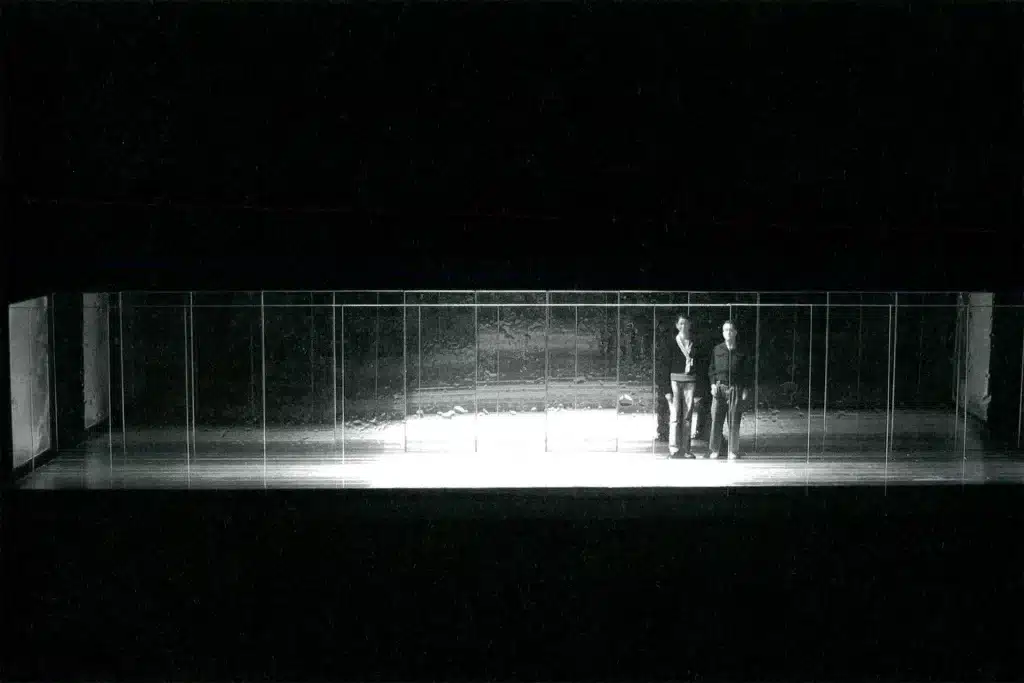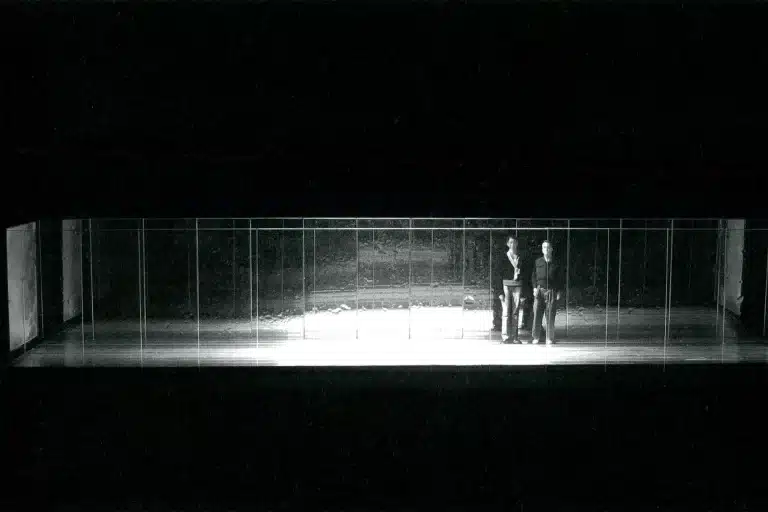Christophe Triau : Est-ce que la question de la transmission se pose à toi, dans ton parcours de créateur ?
Daniel Jeanneteau : Elle se pose évidemment, ne serait-ce que parce que j’ai quarante-cinq ans, que je travaille depuis longtemps, et qu’il m’arrive d’enseigner ou de travailler avec des personnes très jeunes. Pourtant je ne pense pas ces rencontres en termes de transmission. Je n’aime pas beaucoup cette notion. Et je n’aime pas beaucoup les maîtres, d’ailleurs. La seule chose, à mon avis, que l’on devrait transmettre, que l’on puisse vraiment transmettre, c’est le relais, c’est-à-dire laisser la place, laisser exister, en donnant confiance, en s’effaçant — pour que d’autres, plus jeunes, puissent grandir… Nous venons, avec Marie-Christine Soma, de diriger un exercice à l’école du TNS : avec les élèves de toutes les sections, nous avons monté un spectacle ensemble. C’est une expérience nouvelle pour moi, et que j’ai beaucoup aimée précisément parce qu’il ne s’agissait pas de transmettre, que nous n’étions pas là en tant que maîtres et que nous n’avons donné aucune leçon. Nous les avons embarqués dans nos incertitudes, notre inexpérience, notre besoin d’aventure. Nous ne leur avons pas transmis quelque chose que nous avions déjà, nous avons acquis en même temps qu’eux quelque chose que nous n’avions pas. Et s’il y a eu transmission, plus que dans les quelques conseils que nous avons pu leur donner, qui valent ce qu’ils valent, c’est dans ce partage du doute et de la découverte, de l’étonnement, qu’elle s’est tenue. Ce qui me paraît le plus important à transmettre aux personnes très jeunes avec qui nous travaillons, c’est un certain rapport à l’existence, vivant et ouvert, plutôt que le capital de connaissances et de maîtrise, d’expérience, que nous avons accumulé au long des années… Et cela nous place dans l’obligation d’être nous-mêmes particulièrement vivants et ouverts, plus que dans toute autre situation. Ça ne fait pas de mal de temps en temps. La capitalisation du prestige, de l’intelligence, de la connaissance, de la pratique, faire des leçons, je trouve ça terrible, et le contraire du don. En revanche, je pense qu’avoir des référents, des personnes qui dans la distance inspirent, font rêver, troublent, ça c’est intéressant. J’ai passé la première moitié de ma vie à admirer plein de gens, avec une ferveur absolue, et cette admiration un peu exaltée m’a plongé à chaque fois, momentanément, dans un nouveau devenir : la force de fascination et d’attirance qu’exerçaient sur moi ces personnes a provoqué des sortes de glissements, de dénaturations dont j’étais assez conscient, que je choisissais, mais qui m’aidaient à me déplacer intérieurement et à élargir mes champs de conscience. C’était épisodique et limité, cela correspondait en quelque sorte à des années d’apprentissage, ces années pendant lesquelles l’être se construit à travers des rencontres pour la plupart fantasmées, fictionnelles, et s’accomplissant dans la distance.
Mais il y a aussi une autre transmission, essentielle, qui se fait par l’expérience de l’œuvre d’art. Les œuvres que nous a laissées le passé, celles, parfois, qui sont produites aujourd’hui, recèlent, dans le spectre de leur présence, des sommes d’informations complexes, une richesse humaine qui se transmet sans qu’on l’analyse mais qui nous remplit, nous développe intérieurement, nous stimule, nous alimente ; qui dépose en nous des structures, des messages, des informations compressées qui reprennent de l’espace en nous par le biais de l’émotion. Les œuvres d’art ont le pouvoir de déplacer, de révéler, de changer des vies, parfois d’en sauver.
C. T. : Dans tes « années d’apprentissage », il y a ta collaboration avec Claude Régy. Ce qui est très singulier, il me semble, dans cette relation, c’est qu’elle s’est tout de suite jouée dans le faire : tu as dès le début travaillé, comme scénographe, avec lui. Et j’ai l’impression que tu t’es très vite « singularisé » ; tu as été fortement lié et associé à lui, mais sans que ce soit aux dépens de ton individualité propre, au contraire : tu as été reconnu pour toi-même, pour ton apport particulier à son travail, et non comme le « bras », l’assistant ou l’élève de Régy.
D. J. : C’était justement ça le miracle de cette rencontre : Claude ne s’est pas tenu devant moi comme un maître. Et je pense d’ailleurs que la manière dont je vis le travail de formation aujourd’hui est liée à la modalité de notre rencontre. Au tout début, il s’est présenté à moi avec ses inquiétudes, ses fragilités, ses incertitudes, ses doutes. Et il demandait, à moi qui ne savais rien, qui étais encore à l’école et n’avais aucune connaissance ou expérience réelle des choses, de lui répondre, de le rassurer ou de l’aider. Il avait le courage d’assumer un grand dénuement (qui, je l’ai compris par la suite, fait partie intégrante de sa force). Le travail s’est placé d’emblée sur un plan d’« égalité » troublant, inquiétant et heureux à la fois, qui a révélé en moi des forces que je n’aurais jamais cru avoir. C’est là qu’il y avait de sa part une générosité réelle : nous étions dans un rapport vivant, de personne à personne, un rapport de rencontre et d’écoute. Le modèle hiérarchique des maîtres et des élèves n’est pas très intéressant. Je préfère celui de l’« être ensemble », et d’une certaine égalité dans l’expérience, une égalité liée à l’instant, à la découverte — l’expérience plutôt que la leçon. C’est précisément le danger, le risque lié à l’expérimentation qui fait que les êtres ont besoin les uns des autres et se rapprochent, se solidarisent dans un moment de travail et d’action. La verticalité des rapports n’est pas très intéressante, sinon, évidemment, dans une stratégie de pouvoir. On confond souvent la responsabilité et le pouvoir. C’est l’horizontalité des réseaux, des circulations de pensées et de gestes, qui fait que parfois, pendant un temps, un être nouveau, immatériel, organique, se constitue et vit entre les différentes personnes qui se sont associées pour que se produise la représentation : c’est une expérience inépuisable, toujours différente et nouvelle, et une des plus belles méthodes dont nous disposons pour explorer l’humanité. Une expérience au-delà de la morale, un rapport de nécessité plus urgent que le fait de simplement « partager » un peu de ce qu’on a déjà.
C. T. : Mais tout cela n’est pas destiné à partir en fumée : les expériences produisent de l’expérience.
D. J. : C’est les deux. Les expériences que nous vivons disparaissent dès qu’on ne les vit plus, mais nous transportons en nous, évidemment, des modifications, des germes qui en entraîneront d’autres, qui iront ailleurs, plus tard, fleurir autrement… Certains spectacles que je n’ai pas vus m’ont marqué parce que j’ai perçu chez ceux qui m’en ont parlé un trouble, une émotion réelle. Leur trouble m’a transmis quelque chose de la réalité vivante de la représentation, suffisamment pour que je place moi aussi ces spectacles dans le registre des expériences vécues, gravées en moi. Ce que j’aime dans le théâtre, c’est sa part d’immatérialité — une immatérialité agissante. C’est que le vrai résultat de la création s’accomplit de façon invisible dans le plus secret des êtres, et de là génère des transformations, de nouvelles possibilités d’expériences, de nouvelles pensées… On ne sait pas ce qu’on saisit, ce qu’on retient, et l’essentiel de ce qu’on perçoit et vit au théâtre passe par un bain d’oubli. L’oubli est l’une des conditions d’existence du théâtre : vouloir retenir est contre nature, c’est le tuer. Il y a dans l’oubli assumé une sorte d’acte de confiance, de prière laïque au vivant, à la mémoire commune, à l’être, à la transmission d’individu à individu, dans l’instant de la rencontre.
C. T. : Mais s’il y a oubli, il existe aussi une mémoire de l’oubli, qui n’est pas forcément une mémoire consciente et rationnelle : comme il y a une mémoire de l’eau…
D. J. : Précisément : il y a une mémoire de l’oubli, une mémoire dans l’oubli. Et même : une mémoire par l’oubli. C’est peut-être celle qui m’intéresse le plus : celle qui se transforme en substance de vie. Il me semble qu’en général la part de la mémoire de, dans et par l’oubli est plus importante que celle de la mémoire consciente, et quotidiennement nous vivons à travers une masse de choses que d’autres ont vécues, dont nous n’avons pas idée, qui nous ont été transmises à notre insu.
C. T. : Te donnes-tu comme objectif, dans le choix et la conception des projets, de créer les conditions particulières pour que l’expérience vous déplace, vous ébranle, vous modifie ?