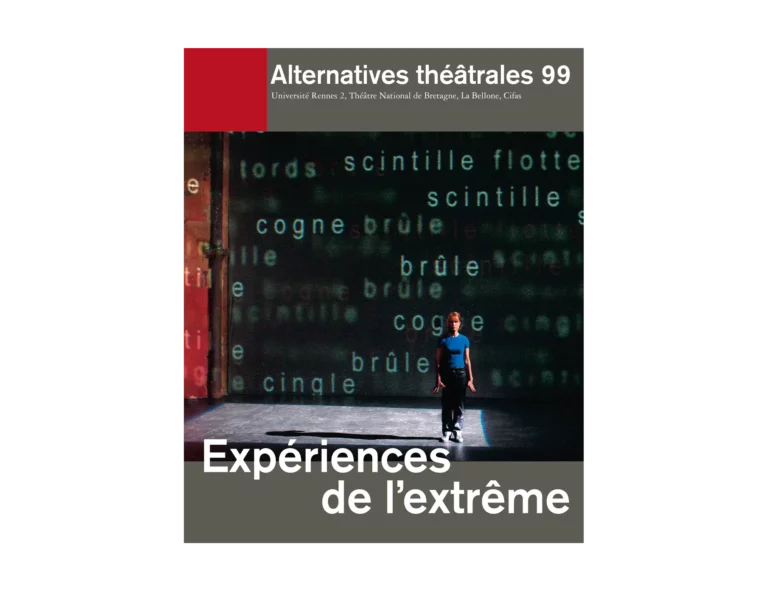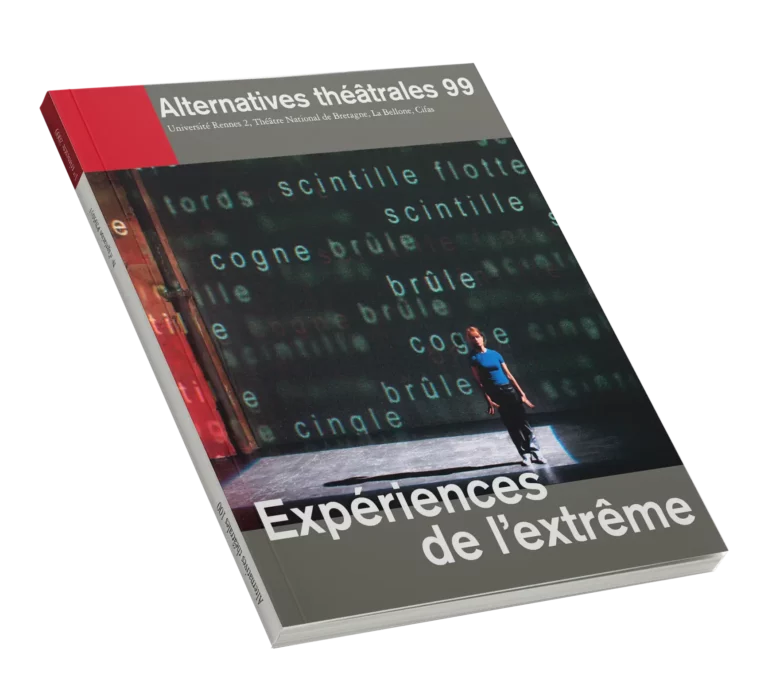I stumbled to my feet. I rode past destruction in the ditches, with the stitches still mending ‘neath a heart-shaped tattoo. Renegade priests and treacherous young witches were handing out the flowers that I’d given to you. The palace of mirrors, where dog soldiers are reflected, the endless road and the wailing of chimes, the empty rooms where her memory is protected, where the angels’ voices whisper to the souls of previous times.
Bob Dylan, “Changing of the Guards”
Les textes rassemblés dans ce dossier sont pour la plupart issus d’une journée d’études, « La place du mort sur la scène théâtrale contemporaine », organisée par Carole Guidicelli au Théâtre National de Bretagne, le 12 juin 2008, dans le cadre d’un programme de recherche du laboratoire La présence et l’image de l’université Rennes 2.
L’intitulé de ce programme, La scène comme lieu de mémoire ?, en raison du large spectre des questionnements qu’il suggère, appelle quelques éclaircissements. Pour le définir schématiquement, disons qu’il part en premier lieu de cette hypothèse : loin de se limiter au « pur présent » auquel on tend à la réduire aujourd’hui1, la représentation théâtrale peut se définir comme un agencement symbolique dont l’une des fonctions possibles, parmi les plus anciennes et les plus souvent investies, est d’articuler ce présent au passé. De constituer, donc, ce que je serais tenté d’appeler un dispositif mémoriel, car la rencontre qui s’effectue, grâce à cet agencement, entre le visible et l’invisible, entre le réel et l’imaginaire, entre le matériel et l’immatériel, est à bien des égards et sous bien des aspects une rencontre entre ceux qui sont là et ceux qui n’y sont plus, ou plus exactement ceux qui témoignent (fût-ce par le détour de la fiction) de ce qui fut un jour et qui n’existe plus.
Je dis bien « l’une des fonctions possibles », et sans doute celle-ci est-elle devenue aujourd’hui minoritaire, car nous ne devons pas oublier pour autant que, dans la très grande variété des pratiques et des esthétiques qui se partagent le champ de la production théâtrale contemporaine, d’autres forces – celles du divertissement et de la spectacularité, par exemple, mais aussi les influences de la danse et de la performance – poussent au contraire à replier le temps de l’événement scénique sur la seule mise en jeu d’un présent en quelque sorte intensifié, d’un « instant habité », pour reprendre la belle formule de Georges Banu. Pourtant, dans les creux et les plis de cet instant, continue de venir se loger le souvenir de ce qui a disparu, de ceux qui sont disparus : souvenir discret souvent, lancinant toujours, mais qui peut aussi se précipiter en images puissantes et dérangeantes, comme les articles réunis dans ce dossier le rappellent avec force. Car ce ne sont plus, alors, des figures du passé qui viennent répéter sous nos yeux ce que furent leurs vies : ce sont des êtres morts, ou demi-morts, que nous voyons se mêler aux vivants, pesant de tout leur poids sur ces existences, en une forme de redoublement (voire de mise en abyme), à l’intérieur de l’espace de la représentation, de cette ancienne fonction de la scène théâtrale : donner une place parmi nous à ceux qui nous ont précédés.
Retour et différance
La diversité des écritures et des œuvres évoquées dans ce dossier, et dont le rassemblement ne constitue qu’un premier repérage à l’intérieur d’un champ d’investigation beaucoup plus étendu, n’empêche pas que se dessinent nettement deux caractéristiques majeures du phénomène dont nous tentons de dessiner les contours. D’une part, la « place du mort sur la scène théâtrale contemporaine », si elle se nourrit à l’occasion des souvenirs d’Eschyle, de Sénèque, de Shakespeare, de Maeterlinck ou du nô, fait irruption dans une histoire du théâtre moderne qui l’avait depuis longtemps exclue ou marginalisée, réservant les prestiges de la scène aux seules prérogatives des vivants : la transmission, si transmission il y a, ne s’effectue donc pas sous le signe de la continuation ininterrompue mais sous celui du retour, du réinvestissement de modèles préalablement écartés. D’autre part, ce retour, loin de s’effectuer à l’identique, pose et impose comme une différance – au sens derridien du terme2 – la marque des mutations et des événements collectifs qui ont affecté les sociétés occidentales au cours des dernières décennies : génocides et déportations de masses, guerres civiles et conflits internationaux, modernisation technique et bouleversement radical des modes de vie, flux migratoires. Ajoutons, enfin, ces évolutions discrètes, mais non moins profondes, de nos pratiques sociales, de nos mentalités et de nos représentations que les travaux des historiens et des sociologues mettent en lumière, au premier rang desquelles la forclusion de la mort, sa médicalisation et sa relégation hors de notre vue, qui rendent plus difficile encore, car désocialisé et déritualisé, le travail du deuil. Ce n’est pas sans raison que Philippe Ariès intitulait « La mort ensauvagée » le second volume de son Homme devant la mort3, consacré à l’époque contemporaine.
De ces traumatismes, de ces évolutions et de ces bouleversements, la scène contemporaine fait mémoire, en ce sens qu’elle les ramène à nos consciences, qu’elle les représente au sens le plus littéral de ce mot, non par un geste objectif et documentaire, mais en donnant à voir et à entendre, par la fiction du théâtre et par le simulacre des acteurs, les corps et les voix souffrants, la présence paradoxale de ceux qui sont partis, les consciences inapaisées, les négociations qui s’imposent entre morts et vivants. C’est pourquoi auteurs et metteurs en scène ne recourent plus guère à l’attirail symbolique des figures de la Mort, gisants, danses macabres et autres porteurs de faux, qu’un Michel de Ghelderode pouvait encore à l’occasion mobiliser ; ou bien, lorsqu’ils le font encore, est-ce dans un geste citationnel, très éloigné des protocoles et des enjeux de la « place du mort » tels qu’ils sont développés dans ce dossier. Sans doute le retour des morts sur les plateaux, aujourd’hui, peut-il d’ailleurs être considéré comme partie prenante du même phénomène d’« ensauvagement » qui a vu se réduire, avec le délitement des croyances religieuses, l’efficacité cathartique et le pouvoir de consolation des figurations traditionnelles du trépas ou de l’au-delà, nous laissant entièrement démunis face à cette « anomalie impensable » (Jean Baudrillard) qu’est devenu l’arrêt de la vie chez ceux qui furent vivants comme nous.
Trois modes de fonctionnement
Je voudrais à présent, pour élargir le champ de la réflexion, tenter de préciser quelque peu la notion de dispositif mémoriel, telle qu’elle se manifeste à mon sens au théâtre, en distinguant trois modalités de son fonctionnement.
La représentation théâtrale peut être chargée par la collectivité de maintenir vivant un mythe ou un épisode fondateur, de nature politique ou religieuse, lequel constitue le ciment même de son identité, le grand récit destiné à fédérer les consciences : c’est l’origine même du théâtre, vers quelque direction qu’on se tourne. Mais c’est aussi une fonction que toutes les formes de spectacle d’inspiration religieuse, toutes les fêtes révolutionnaires, actions de masses soviétiques ou Thingspiele des premiers temps du nazisme, ont remplie. Il existe un usage commémoratif du théâtre : célébration des héros ou des dieux, de la naissance d’une nation ou de l’histoire d’un peuple, celui-là même qui le lie le plus fortement à une communauté, et dont on pourrait dire qu’il sert prioritairement à entretenir cette fiction de l’identité collective que démonte, après d’autres, Paul Ricœur. Croire qu’un groupe humain peut « rester le même à travers le temps », confondre ce qui a fait sa spécificité, ce qui a pu le réunir à un moment donné de son histoire, avec l’illusion que celle-ci peut se maintenir à l’identique malgré le passage des années, voire le changement des générations4. Dans ce premier régime, de type idéologique, le dispositif mémoriel que constitue la représentation théâtrale contribue, en lui offrant périodiquement ou exceptionnellement la possibilité de revivre un instant qui lui appartient en propre, à donner au groupe le sentiment de sa propre permanence ; il est un outil qui peut être mis au service de ce que Ricœur appelle une « manipulation de la mémoire ».
À côté de ces usages communautaires, à vocation politique ou religieuse, le théâtre peut fonctionner aussi comme un dispositif mémoriel à usage plus restreint, d’ordre artistique et culturel, lorsque c’est le spectacle même de ses manifestations qui se conserve à l’identique. Ce n’est plus alors la résurrection d’Osiris, la Passion de Jésus, la bataille de Kerballah ou la Prise du Palais d’hiver qui se rejouent devant la foule assemblée, mais simplement une histoire, souvent très ancienne, dont les codes littéraires et/ou scéniques, préservés à travers les siècles, donnent encore aux spectateurs le sentiment d’une permanence, fût-elle limitée au seul domaine de la jouissance esthétique. Les théâtres traditionnels orientaux sont naturellement les exemples les plus achevés de ce fonctionnement, ceux auxquels on pense en premier lieu ; mais bien des formes de spectacle amateur en Europe, en milieu rural principalement – telles les représentations du Maggio toscan décrites par Marco Consolini5 – peuvent leur être comparées sur ce point. En revanche, les grandes institutions culturelles occidentales supposées être les gardiennes d’une tradition spectaculaire, telles que la Comédie-Française, me semblent s’être écartées de ce régime depuis longtemps, c’est-à-dire au moins depuis l’arrivée des metteurs en scène. Les traces d’un dispositif mémoriel de type culturel qu’on peut aujourd’hui trouver dans la Maison de Molière s’arrêtent le plus souvent, serais-je tenté de dire, à l’instant où se lève le rideau6.
Les œuvres, les expériences et les réflexions dont il est question dans le présent dossier me paraissent, pour leur part, inaugurer un troisième type de dispositif mémoriel, puisqu’il ne rassemble le public ni autour d’un récit fondateur de la collectivité, ni autour d’une forme artistique ou littéraire maintenue à travers les âges, mais simplement autour du phénomène même de la mémoire, dans la multiplicité des résonances et des prolongements que provoque la douleur de la disparition. Il peut paraître étrange, et à bien des égards discutable, d’avoir à cette étape de la réflexion convoqué deux ordres de souvenirs si étrangement disproportionnés : celui des destinées individuelles, telles qu’elles nous confrontent immanquablement à la perte des êtres aimés, et celui des traumatismes collectifs majeurs du XXᵉ siècle, tels que le récit, direct ou indirect, nous en a été rapporté, en démultipliant la souffrance de la perte par l’horreur que suscitent les violences et les humiliations exercées. Mais il me semble que, dans le champ de la production artistique contemporaine, ces deux niveaux d’expérience si disproportionnés entrent toujours plus en dialogue et en interaction – pour le dire autrement, que la scène théâtrale, l’écran de cinéma ou l’installation plastique nous montrent de plus en plus fréquemment, à travers le prisme d’une conscience individuelle (le témoignage, la recherche d’une filiation cachée ou silencieuse), comment l’un et l’autre s’éclairent mutuellement : comment l’identité de la personne se reconstruit dans la découverte du destin d’une communauté ; comment, aussi, nous ne pouvons nous représenter en pensée ce que furent un génocide ou un meurtre de masse qu’en prenant la mesure des souffrances de victimes individualisées.
Dans ce dispositif mémoriel de troisième type, la scène théâtrale produit une forme d’anamnèse, ramenant à nos consciences non pas le souvenir d’une appartenance, d’une histoire ou d’une culture partagées, mais celui de ce que nous nous efforçons d’oublier : les disparitions proches ou lointaines, aux ondes de choc intimes ou collectives, le passé aboli de nos enfances, les mondes que nous avons vus s’engloutir, c’est-à-dire le travail même de la mort au cœur de nos vies. En cela, ce troisième régime ne s’écarte pas tant des deux précédents par le contenu de ce qui est représenté (le récit de la Passion du Christ ou celui du massacre de l’imam Hossein, de sa famille et de ses compagnons, éveillent eux aussi la mémoire douloureuse de leurs spectateurs) que par les modalités de sa réception.
Les dispositifs mémoriels que j’appelais idéologiques ou culturels s’adressent à une communauté déjà constituée, qui préexiste à la représentation et qui se maintient après elle. Ils fonctionnent, en ce sens, à la façon des lieux de mémoire que décrivent les historiens, ces agencements symboliques à fonction identitaire que se forge une collectivité pour maintenir un sentiment d’appartenance, de lien entre ses différents membres. Le dispositif que met en jeu la place du mort sur les scènes contemporaines, en revanche, ne s’adresse à aucune collectivité préexistante, ni nationale, ni sociale, ni religieuse, mais à un public minoritaire, hétérogène, réuni par le hasard d’un soir entre d’autres, et qui se dissociera sitôt la représentation achevée. Si ce dispositif crée un sentiment d’appartenance, ce ne peut être que celui d’une commune humanité, du partage des mêmes émotions devant la souffrance et la disparition, des mêmes inquiétudes face à ce qui s’en va ou qui s’en est déjà allé. Par là, il contribue plutôt à défaire les identités préexistantes, à nous faire oublier nos appartenances locales, nationales, sociales ou confessionnelles, pour nous ramener à notre seule condition d’êtres humains : il fonctionne, en ce sens, comme un anti-lieu de mémoire, au sens restreint dans lequel les historiens ont repris cette expression à la tradition rhétorique.
Enfin, et je terminerai par cette dernière considération, les dispositifs mémoriels évoqués aujourd’hui ne peuvent se penser en dehors du régime d’existence des œuvres d’art contemporaines, c’est-à-dire qu’ils s’adressent à chacun de nous individuellement. Pour emprunter le vocabulaire de Bernard Stiegler, ils œuvrent non pas à une synchronisation des consciences (ce que font les lieux de mémoire recensés par Pierre Nora), mais à leur « singularisation7 ». Parce que, devant la souffrance et la perte, nous sommes de plus en plus seuls, ils touchent en chacun de nous des ressorts intimes, faits d’expériences vécues et de résonances imaginaires, et qui ne peuvent que très difficilement s’accorder. Ces dispositifs mémoriels ne sont donc pas les lieux où se célèbre en commun un événement fondateur ou un symbole collectif, mais ce sont les lieux du travail de la mémoire, ceux où le deuil se transforme peu à peu en souvenir, contribuant à cet effort de réhumanisation du monde8 qui est l’enjeu majeur, aujourd’hui, de toute œuvre d’art.
- Christian Biet et Christophe Triau résument ainsi la position qu’ils défendent : « il est clair qu’on ne représente au théâtre que du présent au présent par une énonciation énoncée au présent » (Qu’est-ce que le théâtre ?, Folio essais, Gallimard, 2006, p. 414). ↩︎
- Jacques Derrida, Théorie d’ensemble, Seuil, 1968.
Différance que Derrida entourait déjà de connotations funèbres :
« Le a de la différence, donc, ne s’entend pas, il demeure silencieux, secret et discret comme un tombeau : oikesis. Marquons ainsi, par anticipation, ce lieu, résidence familiale et tombeau du propre où se produit en différance l’économie de la mort. » ↩︎ - Philippe Ariès, L’Homme devant la mort, vol. 2, La mort ensauvagée, Points Histoire, Éditions du Seuil, Paris, 1977. ↩︎
- Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, Paris, 2000, p. 82 – 111. ↩︎
- Marco Consolini, « Apologie du Maggio », Théâtres en Bretagne, n° 13 – 14, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 1ᵉʳ trimestre 2002, p. 23 – 26. ↩︎
- Didier Plassard, « La scène peut-elle être un lieu de mémoire ? », in Vincent Amiel et Gérard-Denis Farcy (dir.), Mémoire en éveil, archives en création, L’Entretemps, Vic-la-Gardiole, 2006, p. 15 – 27. ↩︎
- Bernard Stiegler, De la misère symbolique I, Galilée, Paris, 2004, p. 182. ↩︎
- Didier Plassard, « Un théâtre pour réhumaniser le monde », in Mises en scène du monde, Les Solitaires intempestifs, Besançon, 2005, p. 434 – 439. ↩︎