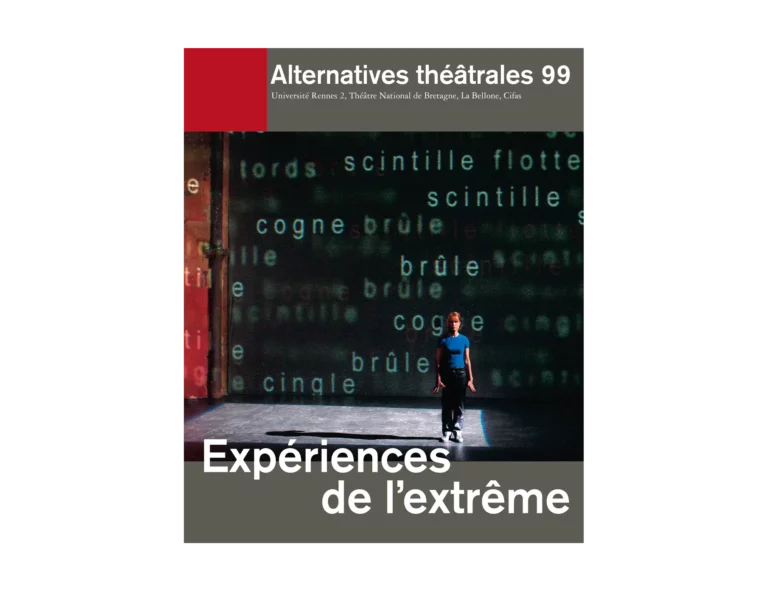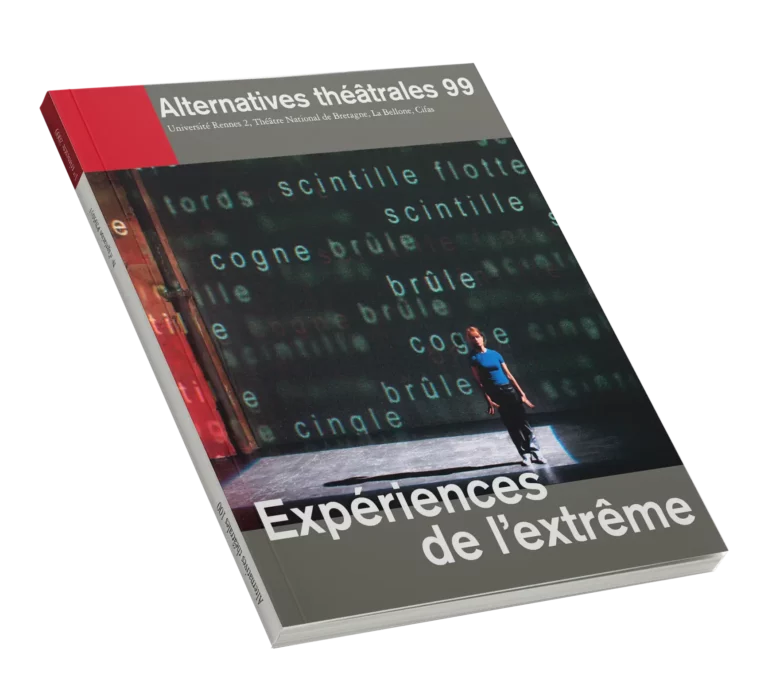– À quel moment un cadavre devient-il un cadavre historique ?
Peter Brook, L’Espace vide.
– Combien d’années faut-il pour qu’un carnage appartienne à la littérature ?
« Laissez donc un sursis à la terre. Qu’elle dise la vérité, toute la vérité. […] Il y a des morts qui sommeillent dans les chambres que vous bâtirez. Des morts qui visitent leur passé dans les lieux que vous démolissez. Des morts qui passent sur les ponts que vous construirez. Il y a des morts qui éclairent la nuit des papillons, qui arrivent à l’aube pour prendre le thé avec vous, calmes tels que vos fusils les abandonnèrent. Laissez donc, ô invités du lieu, quelques sièges libres pour les hôtes, qu’ils vous donnent lecture des conditions de paix avec les vivants… »1
Telle est l’injonction que nous adresse le poète palestinien Mahmoud Darwich dans Le discours de l’homme rouge : inviter les morts parmi nous, leur faire place dans nos vies, leur permettre d’être des passeurs pour l’avenir. Une injonction à laquelle auteurs et metteurs en scène de théâtre aujourd’hui paraissent avoir répondu positivement, même si c’est par des voies très différentes. Didier-Georges Gabily, dans une lettre adressée à Mahmoud Darwich, lui a même explicitement répondu : « J’ai fait place aux morts depuis longtemps à ma table. »2
De fait, comme l’analyse Monique Borie dans Le Fantôme ou le théâtre qui doute3, la scène de théâtre a pu être, dès l’Antiquité, le lieu des morts, de leur souvenir ou même de leur retour. On pense à l’ombre du roi Darius dans Les Perses d’Eschyle ; à l’Alceste d’Euripide, où Héraclès réussit à arracher à Thanatos la vertueuse épouse du roi Admète qui a accepté de donner sa vie pour sauver celle de son mari ; aux spectres de Tantale et de Thyeste qui, encore souillés de crimes abominables, surgissent des Enfers au commencement des tragédies de Sénèque.
Après l’Antiquité, il faut attendre la Renaissance et l’âge baroque pour voir de nouveau se lever spectres et cadavres sur la scène. L’œuvre de Shakespeare en fournit un modèle dramaturgique essentiel, avec la figure spectaculaire du mal-mort venu réclamer vengeance (Hamlet) ou bien hanter la conscience et peupler le sommeil de son meurtrier (Macbeth, Richard III). Toutefois, la fortune du modèle shakespearien ne doit pas éclipser la présence de revenants sur les scènes européennes du XVIIᵉ siècle. S’il est peu courant de trouver une pièce française qui en recèle – à l’exception de « L’Ombre », qui ouvre la Tragédie mahométiste anonyme de 16124 –, il ne faut pas oublier, par exemple, que les tragédies baroques d’Andreas Gryphius regorgent d’apparitions spectaculaires de fantômes qui dialoguent, maudissent ou prophétisent (Carolus Stuardus, 1649), voire de cadavres brusquement ranimés : dans Cardenio et Celinde (1657), un mort exhumé clandestinement se redresse, lançant des imprécations contre les violeurs de sépulture avant de regagner son tombeau.
Il est difficile d’expliquer la place si importante alors accordée aux morts sur la scène théâtrale : influence des tragédies de Sénèque ? Contrecoup des conflits religieux et des débats théologiques du temps ? Reflet d’une époque hantée par les massacres des guerres civiles et les épidémies meurtrières ? La question est trop complexe pour être ici débattue. Cependant, force est de constater que le statut de ces ombres et spectres change progressivement.
Ils ne se contentent plus d’exposer l’action (à la manière de Thyeste au début de l’Agamemnon de Sénèque) ou de l’expliquer (ce que fait Darius dans Les Perses), de lancer une imprécation liminaire (comme au début des Euménides d’Eschyle, où Clytemnestre réveille les Erinyes pour qu’elles ne laissent pas s’échapper son meurtrier). Ils tendent à envahir le cœur de l’œuvre et à se mêler réellement aux vivants, devenant le déclencheur de l’action dramatique (tel le spectre du père d’Hamlet), voire l’élément qui précipite le dénouement (l’intervention du mort, dans Cardenio et Celinde, provoque immédiatement le repentir et la conversion des deux profanateurs de tombe).
Mais les spectres baroques se sont éclipsés de la scène théâtrale, chassés par les règles de bienséance et de vraisemblance, puis par l’esthétique réaliste. À quelques exceptions près – celles, par exemple, des fantasmagories de Robertson, dont les spectacles macabres remportèrent un vif succès sous la Révolution française, ou, un siècle plus tard, des premiers drames de Maeterlinck et des derniers d’Ibsen – il faut attendre la seconde partie du XXᵉ siècle pour assister à la résurgence des morts, non plus vraiment sous la forme des spectres qu’affectionnaient le théâtre élisabéthain et jacobéen ou le théâtre baroque allemand, mais sous des aspects plus variés et bien plus problématiques. Différente de ce qu’elle fut dans les spectacles baroques, la présence du mort sur la scène théâtrale contemporaine l’est d’abord en ce qu’elle n’affecte pas seulement les textes dramatiques, mais se décline dans la mise en scène, et plus largement dans la pensée du théâtre. S’enracinant, entre autres, dans les conceptions de Maeterlinck – qui voudrait que le théâtre soit un lieu où « ce sont des morts qui viennent nous parler »5 – et de Craig, qui aspire à saisir « cette vie mystérieuse, joyeuse et superbement aboutie que l’on appelle la Mort »6, opérant fréquemment par une relecture de la question du spectre shakespearien, mais dans une attention de plus en plus grande aux événements du monde contemporain, cette pensée connaît des développements multiples, de Régy à Novarina, de Mesguich à Bond, et tant d’autres pistes que ce dossier tente de dessiner.
La principale différence qui surgit entre ces usages contemporains et ceux qui les ont précédés réside vraisemblablement dans leurs motivations : si la figure du mort, quelle que soit la forme qu’elle prend, fait aujourd’hui retour avec une telle acuité et une telle fréquence sous la plume des dramaturges, mais aussi dans le discours et la pratique des hommes de théâtre, les processus de massification ou d’industrialisation de la mort (camps d’extermination, massacres génocidaires, bombe atomique ou bien catastrophe nucléaire) qui ont marqué l’histoire du XXᵉ siècle n’y sont sans doute pas étrangers.
Par ailleurs, ce phénomène se trouve aussi probablement renforcé par le processus d’éviction des morts qu’on observe dans la société occidentale au fur et à mesure de son évolution. Les travaux de Philippe Ariès7 ont en effet montré combien la société d’aujourd’hui s’efforçait de cantonner les morts à des espaces spécialisés et soigneusement délimités (l’hôpital, la morgue, le funérarium) et d’en réserver la prise en charge à des professionnels (personnel médical, service des pompes funèbres). Peut-être le théâtre devient-il dès lors l’un des rares lieux du monde où le souvenir et le souci des morts peuvent se replier pour mieux se déployer ? Terre d’accueil pour ceux qui ne sont plus, la scène contribuerait à leur rendre une écoute et une visibilité publiques, réaffirmant par là même son propre lien consubstantiel à la mort.
Le théâtre, cet art funéraire
Puisque le théâtre semble être au moins en partie redevenu le lieu des morts, qu’est-ce que le texte dramatique sinon une parole de mort(s), et que sont les personnages sinon ces morts auxquels on fait une place ? Jouant à désigner, semble-t-il, cette fonction essentielle du théâtre, des dramaturgies aussi différentes que celles de Daniel Danis ou de Valère Novarina font intervenir leurs personnages au « présent de réapparition »8 pour produire le récit de leur vie depuis l’outre-tombe. Par un processus d’anamnèse (« Au début de l’histoire, le drame a déjà eu lieu »9, précise la didascalie initiale de Cendres de cailloux), par l’imbrication de plusieurs temporalités brouillant notamment le partage entre vie et mort (Celle-là), et par des espaces chargés de mystère (la présence-absence des chiens dans Le Langue à langue des chiens de roche), les effets de présence des personnages-narrateurs de Danis deviennent d’autant plus vacillants que ceux-ci relatent leur propre mort à la fin de la pièce, de la même façon qu’ils ont auparavant raconté leur vie.
Puisque le personnage est un revenant, une présence spectrale, l’acteur qui doit s’en ressaisir a donc à « faire revivre et remourir le mort »10, pour reprendre les termes de Genet, et l’auteur dramatique peut jouer de cette fonction, la mettre en abyme, comme Novarina s’y emploie avec humour dans L’Opérette imaginaire en annonçant l’« Entrée de deux acteurs dont l’un devient plus vite que l’autre un cadavre aux yeux d’autrui »11, ou bien en faisant dire au Mortel (!) : « Je suis le mort qui ne s’exprime qu’en chansons. »12 Le travail de l’acteur consiste à faire le mort (« l’acteur toujours comme un mort qui m’apparaît »13, écrit Novarina), ce qui implique, bien plus que de faire le vide en soi, de passer en imagination par le néant.
Que la représentation se change en danse macabre, en opérette des morts-vivants ou qu’elle se prête à des expérimentations potentiellement plus angoissantes, dans certains spectacles de Romeo Castellucci par exemple, l’espace théâtral apparaît comme dévolu aux morts et assigne donc à l’acteur (ou plus généralement à l’artiste) un rôle de passeur. En ouverture d’Inferno, présenté en juillet 2008 dans la cour d’honneur du Palais des Papes d’Avignon, Romeo Castellucci s’avançait vers le public, déclinait son identité avant de s’entourer des protections nécessaires à l’attaque de plusieurs bergers allemands lancés sur lui dans une mise à mort symbolique. Cette performance liminaire accomplie, la porte du monde des morts pouvait s’ouvrir, avec son fleuve de corps agglutinés et ondoyant en un même mouvement, sa longue file de damnés aux couleurs bigarrées ou ses essaims de morts aux mouvements coordonnés et répétitifs.
Si l’artiste est un passeur, le spectacle est un passage : les rangées de spectateurs d’Inferno devaient aider de leurs bras à étendre un immense tissu de soie blanc juste au-dessus de leurs têtes, de façon à recouvrir pendant un moment l’ensemble des gradins. Sous les grandes vagues blanches de ce drap, le public se trouvait pour ainsi dire de l’autre côté, peut-être pris dans ce lac de glace que décrit Dante arrivé au fond du puits de l’Enfer, peut-être tout simplement comme des corps sous leur linceul, en tout cas dans un rapport de continuité avec le lieu des morts, comme pour rappeler aux vivants qu’ils sont des morts en devenir ou pour rassembler malgré tout les morts et les vivants.
Cette place des morts parmi les vivants, enfin, Romeo Castellucci a tenu à la ménager de manière plus explicite encore en intégrant dans son spectacle, grâce à un jeu de projections colorées sur la façade du Palais des papes, les noms des comédiens défunts de la Socìetas Raffaello Sanzio, transformant la représentation théâtrale en lecture d’une gigantesque épitaphe.
Un an plus tôt, également dans la cour d’honneur, L’Acte inconnu de Novarina avait rendu lui aussi un dernier hommage à un acteur décédé peu de temps avant, Daniel Znyk, changeant la scène en un « tombeau d’où la parole appel[ait] les morts »14, selon la formule de Marion Chénetier-Alev. Celle-ci donne la mesure de cette très belle cérémonie funèbre :
« Alors que s’achève la troisième partie de L’Acte inconnu […] et que la nuit atteint enfin sa pleine nocturnité (Novarina) dans la cour du Palais des Papes, le spectateur a une vision : deux comédiens s’emparent de l’immense pantin qui gît sur un brancard à l’avant-scène et le dressent tel un mât face au public. À hauteur des plus hautes fenêtres de la façade fantôme, dans un linceul blanc qui claque au vent, ils brandissent l’effigie de Daniel Znyk dont le masque pâle reproduit, immédiatement reconnaissables, les traits. Christian Paccoud déplie son accordéon et fait entendre la chanson que le comédien interprétait dans L’Origine rouge. Vingt-deux accordéonistes en demi-cercle, de blanc vêtus, lui font suite pour entonner en chœur un chant d’adieu sans précédent dans les annales du théâtre. »15
Se met ainsi en place, au cœur de la représentation théâtrale, une forme de devoir de mémoire qui se manifesterait publiquement, de la part des acteurs vivants envers les acteurs morts, ravivant d’un même élan la mémoire des spectateurs, de manière joyeuse et émouvante à la fois. Inoubliable « Infini romancier » dans L’Opérette imaginaire créée par Claude Buchvald, ou bien « Sosie » dans L’Espace furieux mis en scène par Novarina à la Comédie-Française, Daniel Znyk est désormais l’icône de l’acteur novarinien au croisement du texte et de la représentation.
Si le rappel du mort (ne serait-ce qu’à travers une effigie ou un simple nom) ravive la mémoire intime des vivants, il peut aussi parfois assumer un tout autre rôle lorsqu’il fait remonter à la surface le souvenir d’événements de portée collective : il devient alors la trace d’un passé innommable, d’une expérience ultime (dont Auschwitz constitue une forme de paradigme), qui rongent le présent et menacent le futur.
Représenter l’irréprésentable, témoigner de l’innommable
La « catastrophe historique » ou bien « l’histoire comme catastrophe inaugurale »16, comme l’écrit Hélène Kuntz, qu’elle se nomme Auschwitz ou Hiroshima, pourrait bien se situer au fondement du phénomène de présence de morts ou de leur retour sur la scène. C’est en particulier ce que peuvent nous donner à penser les œuvres d’Edward Bond ou de Heiner Müller. Ce dernier nous présente un monde en ruines au début de plusieurs de ses pièces, et nous y assistons à la résurrection des morts. De manière significative, le temps, dans Paysage sous surveillance, semble « hors de ses gonds », comme l’écrit Shakespeare dans Hamlet ; le monde des vivants y apparaît menacé, au point que son évolution historique s’en trouve figée. De son côté, Edward Bond se définit lui-même comme « citoyen d’Auschwitz » et « d’Hiroshima »17, posant le principe suivant : « Si j’écris sur un holocauste, les morts d’Hiroshima, d’Auschwitz ou de Dresde se servent de moi. »18
Fausse évidence de la réponse de Bond, qui se présente ici comme le porte-parole transparent des victimes. S’ériger en traumaturge ne va pas de soi, et la démarche, loin de n’engager que l’auteur, invite à s’interroger sur le personnage et sur l’acteur. En effet, cette question oblige à composer avec la spécificité de l’énonciation théâtrale. Qui parle, de l’acteur ou du personnage ? La difficulté est parfois accrue par les jeux de masques énonciatifs que permet l’écriture théâtrale. Ainsi, dans Hamlet-Machine de Müller, Ophélie s’identifie-t-elle dans la dernière scène à une figure vengeresse modelée (entre autres) sur Électre :
« C’est Électre qui parle. Au cœur de l’obscurité. Sous le soleil de la torture. Aux métropoles du monde. Au nom des victimes. »19
« Parler au nom des victimes » : tel est l’enjeu parfois posé par et pour le personnage, être de fiction. Mais l’acteur, lui, de quel droit peut-il parler en lieu et place des morts, tout particulièrement de ceux d’Auschwitz, d’Hiroshima – ou, plus près de nous, du Rwanda ou d’ex-Yougoslavie, par exemple ?