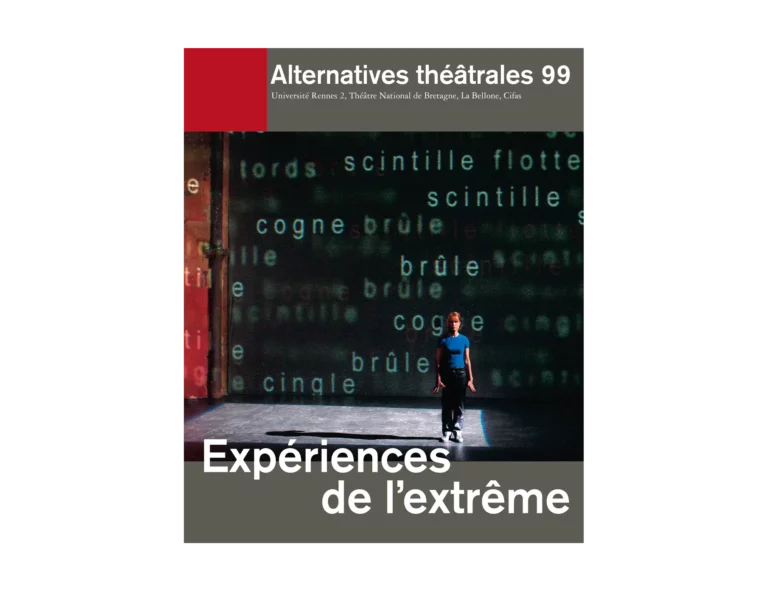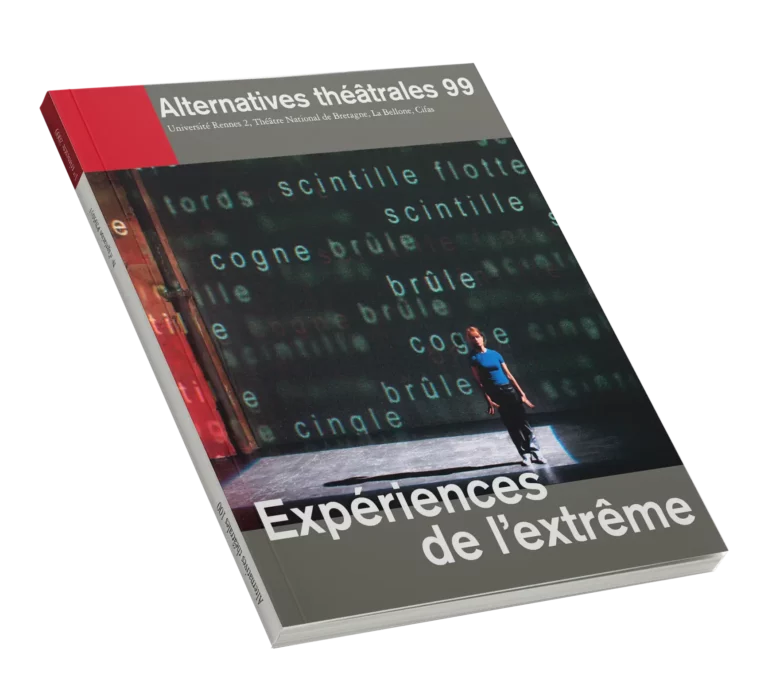La glace est une métaphore qui opère à une multiplicité d’endroits : en soi, entre deux personnes quelles qu’elles soient, entre deux amants ou bien à travers une micro ou macro-société dans la perte d’empathie et la duplicité des comportements interindividuels. La glaciation est tangible en politique, en économie et dans bien d’autres domaines jusque dans les régions les plus intimes de nos vies. Elle correspond aujourd’hui à cette course absurde et effrénée vers le rien. C’est un geste compulsif de vouloir échapper à un temps de gratuité, de doute, de surprise, un temps non programmé.
Notre travail ne consiste pas à figurer quoi que ce soit, mais à nous interroger en actes, devant l’imminence d’une catastrophe :
Ice… so what ? Que faisons-nous de notre temps présent ? À quoi peut-on croire ? Pourquoi et comment traverser un plateau aujourd’hui ? Comment conjurer ne serait-ce qu’un peu la sensation de glaciation mentale que nous éprouvons dans le monde où nous vivons… »
François Verret, note de travail du 15 mai 2007.
À la fin du premier volet de La Divine Comédie, lorsque Dante, guidé par Virgile, pénètre dans le neuvième et dernier cercle de l’Enfer (celui des traîtres), il y découvre un paysage de glace battu par des vents perpétuels et à jamais déserté par le soleil de l’amour divin. La première image qui s’impose au poète est celle d’un lac gelé où les damnés, saisis dans la glace, ont l’âme brûlée par le froid : leurs larmes mêmes, figées immédiatement en cristaux, tantôt leur sont un poids supplémentaire sous lequel ils ploient, tantôt forment un rempart qui les enferme et les aveugle. Au fond de cet entonnoir de cristal, Lucifer, prisonnier des glaces, bat rageusement l’air de sa triple paire d’ailes, mais en vain : plus il déploie d’énergie dans la lutte, plus il accroît les vents froids qui renforcent l’emprise de la glace sur lui. C’est sous le signe de ces images dantesques que j’aimerais d’abord placer le roman Ice d’Anna Kavan, et la dernière création du même titre de François Verret qui en dérive.
Écrit en 1967, Ice (traduit par Neige en français) relève à la fois de la science-fiction, du roman d’aventures ou d’espionnage et du récit halluciné d’un narrateur anonyme pris dans un état de fébrilité quasi permanent. Sur fond de catastrophe imminente (celle d’une glaciation progressive et inexpliquée du monde), ce narrateur poursuit obsessionnellement une toute jeune femme, elle aussi anonyme (a girl), qui apparaît et disparaît d’un pays à l’autre, d’une époque à l’autre, se soustrayant régulièrement à sa présence et se dérobant sans cesse à son désir. Objet érotique de fantasmes souvent sado-masochistes, parfois voyeuristes, elle est tantôt la compagne consentante, tantôt la proie, tantôt l’otage d’un autre personnage masculin qui se présente sous des rôles différents (gouverneur, chef d’armée, de police ou de guérilla), mais toujours comme l’incarnation d’un pouvoir absolu, violent et irrésistible. De plus, cette jeune femme quasi albinos est dotée de toutes les caractéristiques de la glace ou de la neige : transparente et froide, blanche et insaisissable, tranchante et fragile à la fois.
Du mythe de l’apocalypse, le roman reprend le motif de la fin du monde sans toutefois y joindre la dimension de la révélation : le voile n’y est jamais levé sur les fins ultimes de cette destruction (même si nombre de termes du roman l’assimilent à une malédiction), pas plus que des explications d’ordre scientifique ou surnaturel n’y apparaissent. Le mystère de ce processus de glaciation reste donc entier. La dimension visionnaire, en revanche, est bien présente dans le roman d’Anna Kavan, en un lointain écho des récits apocalyptiques dont celui de Jean constitue la version la plus connue. De manière déroutante, le narrateur du livre (« une imagination sous acide », selon Verret) échoue souvent à organiser clairement et logiquement le récit, mêlant perceptions et images rêvées :
« […] je songeais à la glace envahissant le monde, projetant son ombre de mort lente. Des falaises de glace grondaient dans mes rêves, des déflagrations hallucinantes tonnaient, des icebergs se fracassaient, projetant d’énormes blocs dans le ciel comme des fusées. D’aveuglantes étoiles de glace bombardaient le monde de rayons qui fissuraient et pénétraient le sol, remplissant le noyau de la terre de leur froid mortel, renforçant le froid de la glace qui avançait. Et toujours à la surface, l’indestructible masse de glace allait de l’avant, détruisant implacablement toute vie sur son chemin. J’avais un terrible sentiment de hâte et d’urgence, il n’y avait pas de temps à perdre et je perdais du temps. C’était une course entre la glace et moi. »1
Le récit, riche de métaphores, présente régulièrement des visions et des songes à l’interprétation problématique, multiplie les symboles et joue des énigmes posées sans indices de résolution, même si, contrairement aux visions et songes rapportés dans L’Apocalypse de Jean ou le Livre de Daniel, aucune transcendance divine ne vient le fonder en vérité. Seul un épisode énigmatique, présenté par le narrateur plutôt comme un rêve ou une hallucination, pourrait comporter cette dimension. Parce qu’il a l’habitude d’écouter, pour trouver l’apaisement, le chant étrange et presque surnaturel des lémuriens, le narrateur reçoit un jour la vision d’un monde peuplé d’êtres dotés d’une connaissance supérieure. L’un de ces êtres s’adresse à lui dans la langue des lémuriens, prophétise la fin de la planète et l’extinction de la race humaine tout en lui offrant la possibilité d’être sauvé en se joignant à eux — choix que le narrateur refuse.
Du texte à la scène
Du roman apocalyptique d’Anna Kavan, qui ne conservait déjà plus du discours millénariste que les éléments d’une vision fascinante et glacée, hantée par une quête amoureuse toujours déçue et toujours recommencée, François Verret procède (comme il le fait généralement des textes qui servent de supports à ses créations) à une déconstruction et une réécriture violemment subjectives, prêtant au phénomène de glaciation de nouvelles connotations symboliques, sinon allégoriques, pour appréhender les rapports humains dans la société d’aujourd’hui. Tandis qu’Anna Kavan entrecroise et superpose les deux catastrophes — celle de la glaciation de la planète et celle de la perte réitérée de la jeune fille par le narrateur-personnage, les deux motifs déclinant deux modalités de la destruction (collective et intime) — Verret, lui, en privilégiant la catastrophe intime provoquée par la quête éperdue et destructrice de la jeune fille, opère par « opacification du référent »2 et suggère dès lors une apocalypse aux contours beaucoup plus indéterminés.
De fait, ce n’est pas l’idée d’apocalypse qui frappe immédiatement le spectateur d’ICE, et moins encore l’image de la glace, tant paraît grand le chemin opéré de la lecture du roman à l’écriture scénique. Si François Verret s’inspire régulièrement d’œuvres littéraires3, il ne procède jamais à une véritable adaptation et limite la place du texte à quelques séries de phrases emblématiques et répétitives. Même s’il conserve quelques séquences-clés du récit, toutes en anglais non surtitrées en français, le chorégraphe choisit d’en bouleverser l’ordre logique et chronologique (déjà bien malmené dans le roman d’Anna Kavan), laissant libre cours aux glissements et associations qui s’opèrent entre les différentes composantes de la représentation (danses, musique, voix, texte). Tandis que la structure narrative d’Ice reposait pour l’essentiel sur la répétition-variation infinie des schémas de la poursuite, de la rencontre et de la perte de l’objet fuyant du désir, Verret élabore un spectacle qui déconstruit encore plus les quelques lignes de force du récit, opérant par fragmentation et collage. Refusant d’être prisonnier de sa source littéraire, il « refabrique un texte » qu’il distribue entre deux interprètes puissamment singuliers : la cantatrice d’origine rwandaise Dorothée Munyaneza et le comédien-chanteur et ventriloque Graham Valentine. Le rapport au récit matriciel est celui d’un jeu de dérivations ou de renversements d’images, de reprises de mots, de variations à partir de noyaux textuels, voire de balbutiements sur des phonèmes, tous ces éléments fournissant la matière sonore, gestuelle ou imaginaire que les artistes s’approprient et interprètent librement. Le roman d’Anna Kavan fournit donc ici, comme à l’accoutumée, la matière à une expérimentation complexe à laquelle se livrent, d’abord chacun de son côté, puis dans une mise en commun et une confrontation stimulante, chaque artiste (danseurs, chanteurs, musicien) réuni par le chorégraphe metteur en scène4.
Pourtant, même si, à bien des égards, la création scénique se construit dans un écart radical par rapport au roman d’Anna Kavan, il me semble intéressant d’examiner comment, malgré tout, Verret réécrit Ice, et ceci précisément dans sa dimension de récit apocalyptique. Je partirai de l’hypothèse suivante : le spectacle Ice s’écrit, s’élabore comme un chant d’apocalypse. Par-delà le motif de la catastrophe, thématisé notamment par l’état d’urgence qui constitue l’une des lignes de force (ou l’un des fils directeurs) de ce spectacle, celui-ci conserve à mon sens deux caractéristiques essentielles du genre littéraire de l’apocalypse : la poéticité et l’énigme.
Comme un trou noir
Si François Verret ne matérialise pas, sur le plateau du Théâtre National de Bretagne, la neige qui tombe quasi continûment dans le roman, pas plus qu’il ne concrétise littéralement les innombrables variations lexicales ou métaphoriques liées à l’expansion du froid, l’image de la glace qui menace de saisir, de figer le vivant est traitée rythmiquement dans le spectacle par la danse des corps (masculins surtout) lorsque, avec frénésie, ils semblent lutter, se débattre, comme saisis par l’urgence avant de disparaître dans le noir. Mais surtout, de manière répétitive et obsessionnelle, sur tous les tons, jusqu’à saturation sonore et épuisement de l’image, le chorégraphe extirpe du texte l’expression black hole (trou noir), qu’il met de manière récurrente et insistante dans la bouche de son comédien chanteur Graham Valentine : « A black hole in a white face. » « Where did you see a black hole ? » « A black hole ? »
L’imaginaire du trou noir tel que le ressaisit François Verret se charge de toute une série de valeurs, de tout un ensemble de fonctions. Alors que le roman est hanté par la blancheur (de la fille, de la glace), le spectacle, lui, se déroule la plupart du temps dans la nuit du plateau. Tout se passe comme si la création chorégraphique était un passage au noir, nous présentant le négatif photographique des images du roman. De longs rideaux noirs, tels de grandes vagues ondulantes, traversent le plateau de cour à jardin, puis de jardin à cour, rappelant pour les lecteurs du livre l’avancée inexorable des barrières de glace ou des montagnes de neige qui envahissent les différents continents de la Terre. L’ombre projetée de ces rideaux sur le grand écran de tulle plastifié, tendu entre le public et la scène, leur confère un aspect encore plus inquiétant.