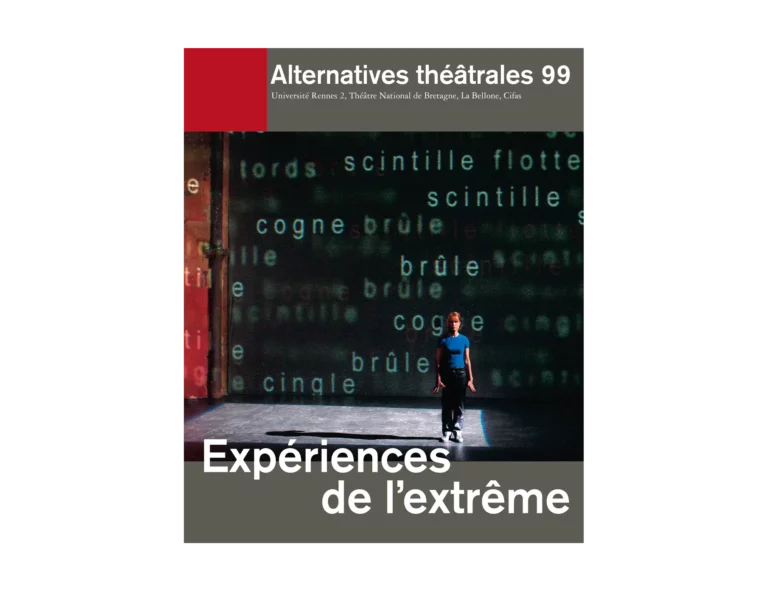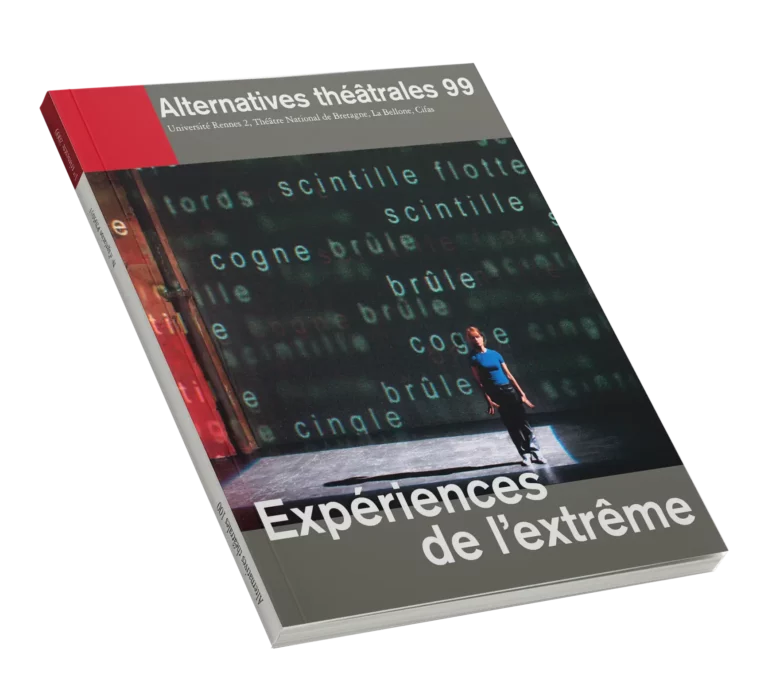« Il y avait là, à même la pierre chauve… là, au milieu de la putréfaction des chiens, un visage d’homme, le regard dans le soleil… »1
Koffi Kwahulé
L’impossible deuil face au corps absent est un enjeu majeur des dramaturgies contemporaines des diasporas. Celles-ci convoquent les pouvoirs funéraires du théâtre pour dire l’absence, et abordent la scène comme un lieu du travail de deuil. Que ce soit chez le Congolais Faustin Linyekula (The Dialogue Series : III Dinozord), le Libanais Wajdi Mouawad (Incendies), l’Ivoirien Koffi Kwahulé (P’tite Souillure, Misterioso-119), les Togolais Kossi Efoui (Le Petit Frère du Rameur) ou Rodrigue Norman (Trans’ahéliennes), ces expressions dramatiques se veulent des espaces de sépulture mémorielle où les cadavres reprennent corps pour que le deuil puisse avoir lieu.
Le monde occidental contemporain ne fait plus de place à la mort, elle disparaît de notre quotidien, elle est loin de nous, mise à distance, soustraite aux regards. Prise en charge par le corps médical, aseptisée, décorporéisée, elle n’est plus tangible. Pourtant, et c’est un paradoxe, le monde médiatique exploite sa dimension spectatorielle. Plus elle disparaît de notre quotidien et plus elle envahit les écrans, plus elle se fait fiction et fascination. Chaque soir, le journal télévisé a son lot de cadavres à montrer… On retransmet en direct des exécutions publiques. Les médias exposent sans réserve les victimes de catastrophes naturelles ou d’attentats, les morts dans les conflits armés, et des mises à mort (Ceaucescu, Saddam Hussein) sont passées en boucle sur les écrans. On multiplie les documentaires sur les grandes affaires criminelles, sur les serial killers, et les séries télévisées sur l’anthropologie judiciaire (Les Experts, RIS, Esprits Criminels, Bones, NCIS…) exploitent le rapport au cadavre virtualisé et fictionnel. La médiatisation et le développement du virtuel contribuent à mettre la mort à distance, à jouer avec l’épouvantail tout en en fuyant la réalité, en la déniant du même coup. Cadavre et dépouille deviennent des objets fantasmatiques, tandis que nous perdons toutes les pratiques rituelles qui aident à la resocialisation autour du défunt. Grâce aux rites funéraires, la perte ne désocialise pas, mais permet au contraire de recréer du social, de fédérer une communauté, de retrouver des liens, d’accepter rupture et passage en s’appuyant sur le groupe.
Notre rapport à la mort est intimement lié aux origines et à la question du retour à la terre, du retour en terre. C’est sans doute pourquoi les auteurs en exil, dont l’écriture parle d’errance et de pérégrination, donnent au mort une place déterminante. Leur théâtre travaille à convoquer l’Absent. Ce n’est pas un théâtre de commémoration ou de souvenir, mais un théâtre qui redonne place au mort et lui offre la possibilité d’agir sur les vivants, le temps de la représentation.
Le voyage de retour
Le mort n’est pas mort, comme s’il avait un autre voyage à accomplir avant celui vers sa dernière demeure, et ce voyage implique les vivants qu’il a quittés. Le mort déplace les vivants. Au lieu de tirer sa révérence et de fausser compagnie, le mort se retrouve présent au cœur de la pièce, en creux. On pourrait dire au creux de l’action.
Son absence même agit d’outre-tombe. Nawal dans Incendies orchestre par ses volontés post-mortem toute l’action et le voyage des jumeaux. Le père d’Ikédia, le masque, dans P’tite Souillure de Koffi Kwahulé, « agit » Ikédia, comme par une espèce de transe. Ikédia est venu chercher les restes de l’étranger dans cette si jolie petite ville où il a été tué d’une balle perdue. Kari, dans Le Petit Frère du Rameur de Kossi Efoui, empêche les personnages de dormir, de trouver du repos ; le voyage qu’elle doit accomplir les obsède. Ils sont réunis dans un studio de cinéma désaffecté, à côté du lieu où repose Kari dont le Rameur va venir chercher la dépouille, et tous guettent son départ : « Parce que c’est là-bas chez elle. Ça a toujours été comme ça depuis vingt-cinq ans. Le Rameur le dit à tous ceux qui vivent ici, ceux qu’il a aidés à venir, ceux qui continuent à se regrouper dans son arrière-boutique. Il dit qu’il n’est pas bon de mourir loin de chez soi, que partir c’est entrer en guerre, et que s’il est un lieu où l’on enterre les guerriers morts, c’est toujours au pays. »2
Dans Trans’ahéliennes de Rodrigue Norman, la vraie fausse veillée autour de Coolio rassemble la famille, alors que Coolio est mort depuis sept ans en Europe. Dans The Dialogue Series : III Dinozord de Faustin Linyekula, Kabako, son ami mort en terre étrangère (d’une maladie d’un autre âge : la peste !), jeté à la fosse commune en Ouganda, sans funérailles, est au centre du projet chorégraphique. La dramaturgie donne une efficience à l’âme du mort. On peut même dire que la relation au mort définit la dramaturgie. Comme si la mort en terre étrangère donnait au défunt la force d’agir sur les vivants pour un retour aux origines et une conquête du repos, autrement dit mettre fin à l’errance.
Ces expressions scéniques de la diaspora explorent théâtralement les dramaturgies des rites funéraires. On peut ainsi identifier une dramaturgie du requiem avec The Dialogue Series : III Dinozord de Linyekula, tandis que Le Petit Frère du Rameur d’Efoui fonctionne plutôt comme une oraison funèbre. Incendies de Mouawad relève en revanche d’une dramaturgie de l’exécution testamentaire, alors que l’on repère une dramaturgie de la veillée funèbre dans Trans’ahéliennes de Norman. Quant à Kwahulé, son théâtre est tout entier travaillé par la mise en bière et la nécessaire reconstitution du corps qui s’y rattache.
Résonance de la tombe
Le mort devient le cœur battant de la pièce, parce que la pièce se construit autour de son absence dans un espace et un temps qui dépassent les contingences. L’œuvre porte le mort en creux, comme si le spectacle se construisait au-dessus de la tombe. Une impression qui caractérise tout à fait Bintou de Kwahulé. On comprend à la fin de la pièce que la jeune adolescente de treize ans dont la famille a caché la mort à toute la cité, faisant croire qu’elle est rentrée au pays, est en fait enterrée dans la cave de la maison et que toute l’histoire qui vient de se jouer est comme une émanation ectoplasmique de la tombe. C’est ainsi que Rosa Gasquet l’a monté au Théâtre Océan Nord de Bruxelles, faisant de Bintou une vision fantômatique de Poltergeist dans le parking souterrain d’un immeuble.
Ikédia, dans P’tite Souillure, porte les ossements de son père dans sa sacoche et les jumeaux d’Incendies ont des lettres d’outre-tombe à lire après avoir retrouvé leur frère et leur père. Dans Trans’ahéliennes, la famille se réunit autour du récit de la mort de Coolio et la disparition de celui-ci est au centre de la parole de Boutros.
La prison de Misterioso-119 est aussi comme construite sur un cimetière, celui des fœtus avortés dans le secret au temps où le centre de détention était un couvent. Les confidences, qui peu à peu s’épanchent des bouches des détenues, témoignent de combien elles sont traversées, hantées par les meurtres qu’elles ont commis. La mort suinte des murs, comme le son obsédant du violoncelle, et l’intervenante artistique est venue se donner en sacrifice :
« Regardez-moi, je ne suis pas d’ici dedans, je suis de dehors. Regardez-moi, je suis comédienne, intervenante artistique, je suis dedans pour un remplacement, au pied levé. […] L’intervenante précédente est tombée du septième étage. On dit un suicide. On dit aussi : elle n’est pas tombée toute seule. On dit encore : on l’a poussée. Mais un accident, on a conclu. Avant elle, deux autres avaient disparu. Sans laisser de corps. Regardez-moi, dans quelques jeudis j’aurai terminé mon contrat, les portes de dedans se seront refermées derrière moi, définitivement. Et ce jour-là, ce jeudi-là, je prie le ciel qu’il ne voie jamais le jour. Car ma seule fenêtre est ici, dedans. Regardez-moi, d’ici quelques jours je serai morte. Cette fille le dit à qui veut l’entendre, le raconte partout […]. Regardez-moi, d’ici quelques jours cette fille m’aura tuée. »3
Les traces de la disparition de Kari obsèdent Maguy qui, au début du Petit Frère du Rameur, lit des piles de journaux et y cherche vainement la mention de Kari : pas le moindre signe, le moindre entrefilet sur sa mort. Cette négation de l’existence de son amie, cet effacement dans la masse de l’anonymat oppresse Maguy et crée toute la tension dramatique de la pièce.
Levée de corps et levée du secret
Ce théâtre interroge justement l’occultation de la mort et du corps dans notre quotidien, dans notre réalité. Efoui traite de la disparition dans l’anonymat, dans l’abstraction des statistiques, des chiffres. La banalisation dans un monde surmédiatisé, où la mort du coin de la rue ne peut pas concurrencer le flux d’événements. C’est ainsi que Maguy finit par comprendre que la mort de Kari en vaut une autre, prise dans la masse du décompte journalier :
« Et j’ai appris, Kari, tu n’es pas seule. Vous êtes nombreux. Par classement, tu fais partie de toutes les cases. Et vous êtes nombreux par case. Tous les cas te ressemblent et tu n’y es pour rien.
Jour par jour, on a compté des morts et je n’ai rien su ni du pourquoi ni du comment ni du où c’est. On compte des corps. Suffit de regarder. Des chiffres à longueur de page. Et ça fait des courbes grossières. Un mort qui pique du nez et le voilà, pris dans une courbe longue comme une liste. » (p. 19)
Face à l’éparpillement médiatique, à l’inflation statistique, le théâtre reconstruit du corps. Il ramène la matérialité de l’être dans le cercle et travaille à cette levée de corps nécessaire pour que commencent les adieux, le travail de deuil.
C’est même la situation dramatique du Petit Frère du Rameur : Maguy, le Kid et Marcus attendent dans un ancien studio de cinéma désaffecté la levée du corps de Kari. Tous observent par la fenêtre l’autre fenêtre, de l’autre côté de la rue, où a lieu la veillée en attendant le fourgon mortuaire. Chacun convoque Kari à sa manière : Maguy fait entendre des bribes de conversation, Marcus rêve au film qu’il voudrait faire, le Kid entre et sort. Leur mise à distance de la morte semble représenter spatialement cette mise à distance sociale. La perte du rituel.
La pièce construit autour de Kari ce que Laurence Barbolosi définit comme un monumentum, autrement dit « ce qui perpétue le souvenir du mort, qui inscrit sa mémoire dans la réalité matérielle, tangible, et qui évite qu’il sombre définitivement dans l’oubli ».4 La pièce devient le vrai accompagnement de la morte, et joue en somme le rôle des funérailles. C’est pourquoi Maguy suggère à Marcus d’inhumer Kari dans son film. Mais, pour qu’il y ait inhumation, il faut un corps, et la pièce qui se joue participe de cette matérialisation qui permettra de coucher Kari dans un linceul, fût-il un simple carré de percale : « Enterre-la dans ton film. Il ne faut pas tout laisser au Rameur. Prends ta part de cimetière. Les jardins sont déjà partagés. Les événements sont partout. Bang ! Kari… C’est très proche, Marcus. Épouse-la et couche-la dans une petite image. » (p. 27)
Pour Kwahulé, la dématérialisation de la mort et la vaporisation des corps représentent une tragédie qui a pris une dimension emblématique avec l’attentat du 11 septembre. Pas de corps, pas de mort, pas de deuil possible. « La chair brisée éparpillée dispersée on la met bout à bout et ça fait un corps. On retrouve le corps. Même une tête même un bras même un orteil ça fait un corps. Le deuil peut avoir lieu. Parce que ceux qui sont restés à New York dans les immeubles, ceux qui n’ont pas eu d’autres choix que de rester, eh bien ils ont été vaporisés. Vaporisés. Pas de corps à honorer. Et là impossible de faire le deuil. On fait semblant pour faire bonne figure, mais ça ne fait pas un deuil. Et c’est à ce moment-là, dans le corps absent, que commence la vraie tragédie. »5