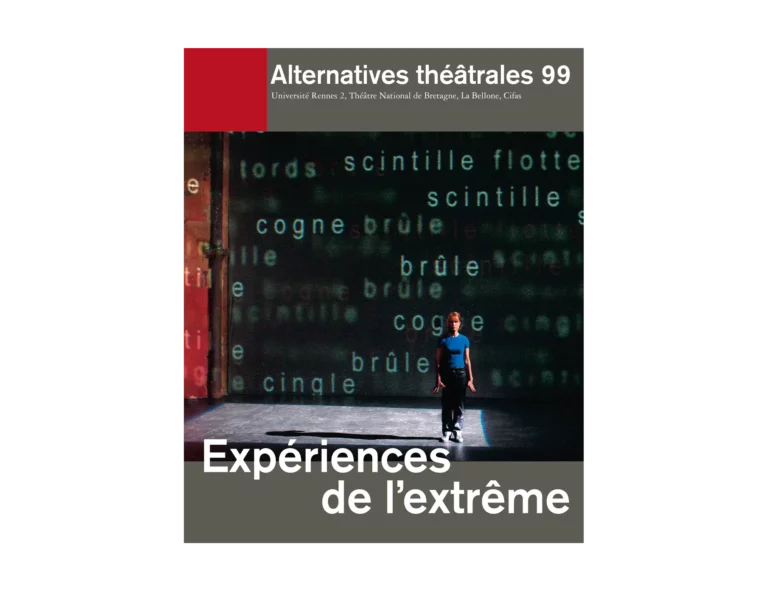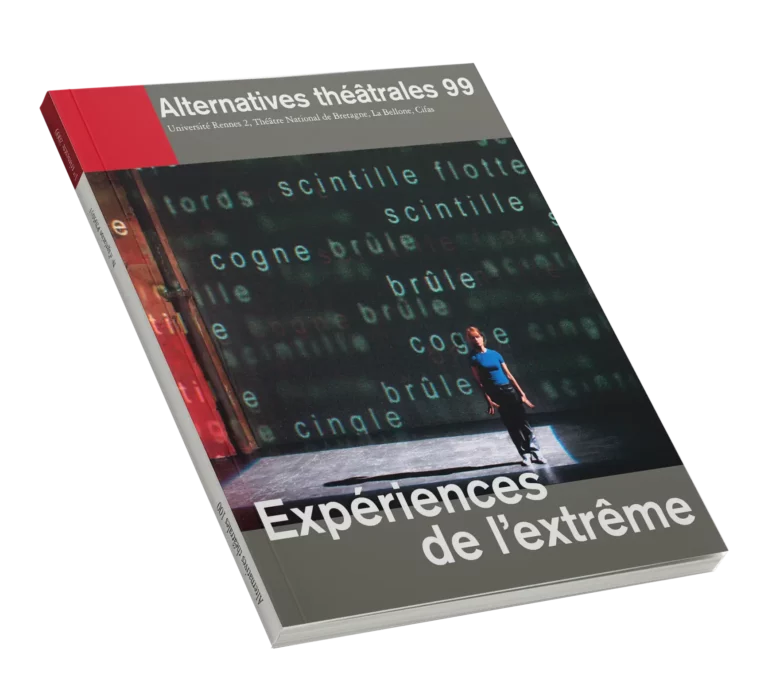Bernard Debroux : Le Théâtre National de Bretagne (Rennes) occupe une place assez singulière dans le paysage du théâtre en France. C’est un théâtre de création, mais il ne renie pas pour autant une dimension d’action culturelle.
François Le Pillouër : J’ai en effet toujours revendiqué une politique du grand écart : je souhaite que le Théâtre National de Bretagne soit présent au niveau local, dans les quartiers défavorisés, auprès des publics qui ont des handicaps, à la prison des femmes de Rennes. Il doit être présent aussi dans le département, en milieu rural, dans la région Bretagne comme au niveau national et international. Pour moi, un théâtre doit se nourrir des ressources artistiques et culturelles du territoire pour l’irriguer à son tour. Au centre de détention, par exemple, nous donnons, mais nous recevons aussi, beaucoup. C’est ce que j’appelle la qualité de la conversation entre un théâtre et son public. Nous sommes responsables d’une éducation commune du jugement critique. Cet aller-retour est indispensable entre nous qui donnons, nous qui recevons, et le public qui reçoit et qui donne.
B.D. : Le soutien à la jeune création te tient à cœur. Cette démarche était déjà présente à Dijon dans le festival que tu y avais créé en 1990 : Théâtre en mai. Les grandes institutions paraissent souvent ne présenter que des artistes importants, reconnus. C’est la critique que leur font les jeunes créateurs ; ils n’y trouvent pas leur place…
F.L.P. : Quand nous avons fondé Théâtre en mai avec Marie-Odile Wald à Dijon, nous avions entendu que des grands metteurs en scène affirmaient que les jeunes n’avaient pas de courage, que la relève n’existait pas. Du coup, de manière assez frondeuse, nous écrivions sur tous nos documents : « Rencontre internationale de jeunes metteurs en scène ». Très vite, à partir de 1990, nous avons eu la chance de recevoir aussi bien Stéphane Braunschweig que François Tanguy, Dominique Pitoiset, Yann-Joël Collin, Didier-Georges Gabily, Marc François, François Rancillac, Chantal Morel, Xavier Durringer, Jean-Luc Lagarce, Hubert Colas. Toute une jeunesse théâtrale a compris que ce territoire lui était destiné, et nous avons entamé, de manière un peu rebelle, la lutte contre les institutions.
Mais ce qui nous intéressait surtout, c’était de rendre des utopies vivantes et de participer à des combats politiques. Nous nous sommes engagés, en 1994, dans le soutien à la Bosnie autour de François Tanguy et d’autres metteurs en scène ou chorégraphes qui nous avaient rejoints. L’actualité artistique était intense : Stéphane Braunschweig, par exemple, a ainsi pu créer Dom Juan revient de guerre d’Horváth et présenter Tambours dans la nuit. Nous invitions aussi de jeunes metteurs en scène étrangers. Théâtre en mai fut l’occasion de la première venue en France de Romeo Castellucci ou de Thomas Ostermeier. Il s’est vraiment créé un lien entre eux : ils avaient des rêves de théâtre, des rêves politiques.
Ensuite, nous avons organisé une importante rencontre internationale de metteurs en scène de toutes les générations en mai 1994 : une étape pour la réconciliation. En étant nommé ici, à Rennes, en septembre 1994, j’ai gardé cette volonté de rester auprès des jeunes, artistes ou spectateurs, à qui nous nous devons de transmettre, mais qui nous apportent à leur tour énergie, contestation, déstabilisation. Je reste attentif à ce que le Théâtre National de Bretagne continue de présenter des premières mises en scène, d’assurer un véritable accompagnement pour les jeunes créateurs. Mais l’intérêt de cette institution est qu’elle permet de travailler dans de bonnes conditions, avec des metteurs en scène expérimentés, de les suivre dans l’accomplissement de leurs œuvres. Grâce à son statut de centre de création, son équipe, ses infrastructures, les soutiens de ses partenaires publics, c’est un des plus beaux théâtres d’Europe.
B.D. : La présence de l’école et l’engagement de jeunes metteurs en scène permettent aussi à l’institution de renouveler son public ?
F.L.P. : C’est vrai. Au départ, quand j’ai créé Mettre en scène en 1994, il est apparu étonnant à certains qu’une institution organise des rencontres de ce type et que le public réponde. C’est peut-être parce qu’en fait la jeunesse se rend compte que notre institution, d’une nouvelle génération, relève le défi, qu’elle remet son titre en jeu, qu’elle accepte de prendre des risques, de heurter les conservateurs qui, à certains moments, nous trouvent trop audacieux. Du coup la jeunesse nous en donne acte, et elle est là…
B.D. : Pour toi, la dimension politique du travail d’action culturelle est importante, surtout dans un moment où, un peu partout en Europe, les pouvoirs publics ne semblent plus considérer la défense de l’art et de la culture comme une priorité…
F.L.P. : Nous avons la chance d’être soutenus par la Ville, le Ministère de la Culture, le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine. Les responsables politiques en Bretagne pensent que l’art et la culture sont non seulement un ciment mais aussi une source d’énergie pour la population. J’ai toujours pensé que si certaines couches sociales défavorisées ne vont pas au théâtre, ce n’est pas pour des raisons obscures. C’est à la fois parce qu’elles n’ont pas eu accès dans leur jeunesse à une éducation artistique, et en même temps parce qu’elles sont dans une situation économique difficile. Nous essayons de contrer ces difficultés sur les deux tableaux : en pratiquant des prix d’entrée aux spectacles abaissés au maximum grâce aux dispositifs spécifiques des Collectivités Locales, et en menant des actions de sensibilisation. Nous associons les artistes à ce travail de sensibilisation : par exemple, nous créons de petits spectacles, légers, des « jeeps théâtrales ou chorégraphiques », qui sont présentés dans les quartiers, en milieu rural, allant à la rencontre des gens là où ils vivent, et, du coup, cela crée une force d’attraction très grande pour le lieu où nous sommes. C’est ce que j’appelle la politique d’aller-retour, fondée sur ce contact multi-permanent, où nous allons au-devant de ces populations, pour expliquer ce que nous faisons, pour les écouter aussi. Ainsi, nous avons le plaisir de recevoir dix mille abonnés par an, plus de quatre-vingt-dix mille spectateurs pour le théâtre et la danse.
Alors que certains théâtres renonçaient au secteur des relations publiques, nous l’avons maintenu, puis développé. Ce n’est pas un service qui existe juste pour vendre du billet ! Si la relation avec le spectateur ne se réduisait qu’à un échange bancaire, cela ne m’intéresserait pas. Ce que nous mettons en place, c’est un échange plus profond. Une étude est en train d’être réalisée qui montre qu’une relation particulière s’instaure entre la population et le TNB. Au-delà de l’échange artistique et esthétique, demeure un sentiment de partage de valeurs. Nous l’avons vérifié en particulier lorsque nous nous sommes mobilisés ensemble pour l’intermittence et le sauvetage de la culture ou des causes humanitaires.
B.D. : Quelle est la place de l’école au sein du Théâtre National de Bretagne ?
F.L.P. : Elle a été fondée en 1991 par Emmanuel de Vévicourt et Christian Colin, trois ans avant que je n’arrive. J’ai souhaité diriger le TNB aussi pour la présence de cette école. Il m’a semblé que c’était un élément fondamental, à développer. Elle avait, au départ, ses locaux en dehors du théâtre. Grâce aux transformations, j’ai fait en sorte qu’elle puisse être intégrée dans le bâtiment. Elle est devenue l’un des fleurons du centre européen.
Après Christian Colin, l’école a été dirigée par Dominique Pitoiset, Jean-Paul Wenzel, et à présent, depuis trois promotions, par Stanislas Nordey. Je souhaitais, pour la diriger, des artistes en activité, des metteurs en scène issus d’une certaine tradition de théâtre. Dominique Pitoiset et Jean-Paul Wenzel étaient issus de l’école du TNS (Théâtre National de Strasbourg) et Stanislas Nordey du Conservatoire de Paris. Ce sont des artistes qui viennent d’une tradition théâtrale et qui défendent un théâtre poétique et politique.
Stanislas Nordey avait imaginé, en discutant avec Didier-Georges Gabily, un « innovatoire » par opposition au conservatoire. Il a réussi à créer ici une synergie forte entre l’école et le théâtre, en mettant l’écriture au centre de l’enseignement de l’école, en faisant en sorte que les élèves se préoccupent d’aller dans les quartiers défavorisés, à la prison… Nous leur donnons rendez-vous sur le front de scène, le front social, le front politique…
Que les élèves acteurs rencontrent au centre de détention des femmes qui sont condamnées à de longues peines, ce n’est pas rien ! Stanislas Nordey recrute des élèves qui s’impliquent vraiment, qui sont « au service de », qui ne sont pas des « voyeurs » de la réalité sociale. Quand nous avons fait aux élèves la proposition de participer aux ateliers de théâtre de la prison, les détenues ont demandé à les rencontrer, à parler avec eux pour que la relation ne débute pas sur de mauvais principes. Alors, seulement après, elles ont accepté ! Les élèves jouent donc avec elles, ils ont leur pratique et leur savoir-faire artistique, mais les détenues ont une profondeur humaine qui enrichit aussi les élèves et réciproquement. Un jour, l’une d’entre elles a déclaré devant une communauté de détenues qui venait d’assister à l’une des présentations que « le théâtre est tout de même un art qui vous prend et qui vous embrasse ». Ce type de travail demande aux élèves acteurs de l’humilité, du respect, ce qui n’empêche pas la contestation et la critique, qualités qui doivent être développées parallèlement.