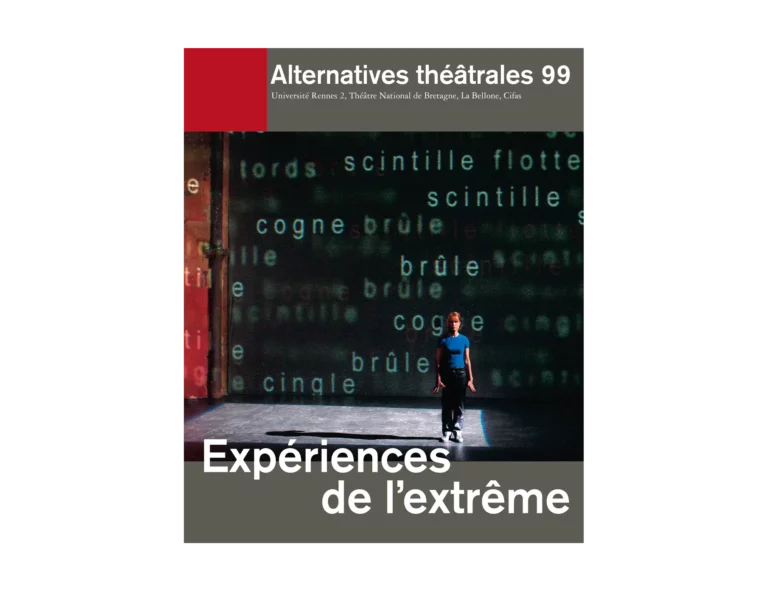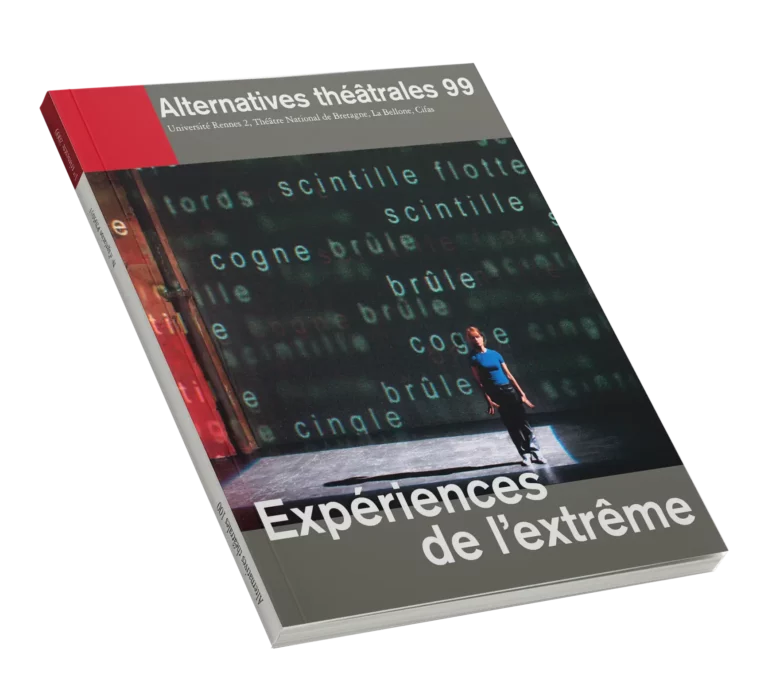Macbeth a été qualifiée de tragédie du Mal, ou encore d’apocalypse du Mal. Ce texte où Macbeth — à la fois bourreau et victime, déchiré entre son ambition et sa conscience — oscille entre sauvagerie et sacré, continue à révéler le chaos de la destruction aveugle à travers des images puissantes.
Ainsi Heiner Müller présente sa vision d’un « monde comme abattoir » dans sa mise en scène historique de Macbeth en 1982. Vingt-cinq ans plus tard, en 2007, le public français découvre à la MC93 de Bobigny la vision du metteur en scène allemand Jürgen Gosch qui, dans une radicalité absolue, fait basculer le monde et sa représentation en une suite effrénée de scènes faites de sang, de nudité, de masculinité et de confusion des sexes.
Heiner Müller
Tout en traduisant Macbeth, Heiner Müller voulait retravailler le texte, transformer ligne après ligne cette pièce qu’il prétendait ne pas apprécier.
Müller évacue la psychologie, élimine les états d’âme, et raconte, de façon extrêmement ramassée, l’histoire d’une lutte de pouvoir féodale aussi brutale que sanglante. En fin de compte, Müller écrit une nouvelle œuvre : là où, chez Shakespeare, Macbeth est encadré de deux figures positives — Duncan et Malcolm —, Müller ne présente que des personnages brutaux, assoiffés de sang et de pouvoir, cyniques et opportunistes. Ici, le bon Macduff et l’honnête Banquo sont des copies conformes du sombre Macbeth — qui n’apparaît dès lors que comme un obstacle à l’aboutissement de leurs propres ambitions. Shakespeare place son action dans une époque située entre féodalité du Moyen Âge et avènement d’un monde bourgeois et capitaliste — chez Müller, pas de référence à un passé peut-être meilleur ou d’espoir quant à un avenir plus prometteur : c’est un monde de lutte intemporelle où seuls comptent pouvoir et survie.
Le texte de Müller est concentré et sans transcendance. Contrairement à Shakespeare, il montre une histoire en état d’immobilité. Et la brutalité n’habite pas seulement les personnages du pouvoir, elle détermine également le peuple. L’un et l’autre des dramaturges évoquent la misère des humbles, mais quand elle inspire à Shakespeare des images poétiques, bien que sombres, chez Müller elle provoque des scènes de réalité crue ; ainsi, un paysan a été pendu — « squelette habillé de haillons de chair » — parce qu’il n’a pu payer son loyer. Sa femme entame une complainte pathétique, à laquelle se mêle une révolte primaire dans son insensibilité, forgée par la pauvreté :
Rendez-moi mon mari. Qu’avez-vous fait de mon mari.
Je ne suis pas mariée à un tas d’os.
Pourquoi, tu n’as pas payé le loyer, idiot.
Elle frappe le cadavre.
Chez Müller, il n’y a aucun espoir pour les pauvres, seules des masses oppressées et vidées de leur substance sont données à voir.
Macbeth de Shakespeare apparaît comme une méditation dramatique sur le temps — sur la présence de l’avenir dans le présent. Le cours du temps réel ne sert que d’avant-plan à une autre dimension temporelle qui se met à vaciller ; ainsi l’ordre entre ciel et enfer, jour et nuit, ombre et lumière explose en des images apocalyptiques… Müller, lui, dédouble également la temporalité de la fable : mais il s’agit plutôt d’un temps de la répétition mécanique et de meurtres en série. Il écrit : « L’effroi qui s’exprime dans les images de Shakespeare est la répétition du même. […] Shakespeare est un miroir à travers les temps, notre espoir est un monde qu’il ne reflète plus. »
Créé en mars 1972 dans une mise en scène de l’auteur au Théâtre de Brandebourg, le Macbeth de Müller n’avait plus été représenté depuis.
Dix ans plus tard, en 1982, Müller est invité à remonter sa pièce à la Volksbühne, alors sous la direction de Benno Besson. « Macbeth était, dans la mise en scène, un jeu de confusions », explique Müller, « d’où l’opulence des moyens théâtraux. La situation ne permettait pas de ligne, trop de choses y étaient en mouvement. »
Un jeu de confusions : c’est-à-dire une fragmentation, une « mise en pièces » de la structure linéaire de la représentation. Dans son adaptation de la tragédie de Shakespeare, Müller avait transformé les cinq actes en vingt-trois scènes. Sa mise en scène intensifie encore cette segmentation. Le travail scénique se présente tel un kaléidoscope qui explose littéralement le temps, multiplie les lieux et les personnages…
La scène se divise en trois niveaux différents : au fond et latéralement, la façade du château qui ressemble à une maison d’habitation berlinoise, délabrée et trouée de balles, avec sa cour intérieure. Dans cette cour, un mannequin et une cabine téléphonique qui émerge au besoin des scènes. En dessous, la fosse d’orchestre, la seule région mouvante d’où surgissent des sorcières, des lords et des paysans. Une structuration toute horizontale : en haut l’étage du pouvoir, au milieu la scène de jeu et en dessous une zone où l’on fait disparaître ce qui dérange… et qui en ressurgit.
Le temps se voit également explosé : la mise en scène commence par la fin, telle Fin de partie de Beckett. En position surélevée et dans le dos du public, assis sur un trône en bois qui s’apparente à une chaise électrique, un personnage — vêtu comme Hamm dans la pièce de Beckett — dit les fameux vers sur la vie qui ne serait qu’« un récit conté par un idiot, plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien ».
La répartition dramatique entre bien et mal est éclatée, elle aussi : il n’y a plus de polarité entre bon (Duncan) et mauvais (Macbeth) rois, ni l’utopie d’un brave peuple opprimé en révolte. Par contre, la mise en scène aligne des objets du pouvoir aussi usés qu’impuissants, défile des jeux de pouvoir clownesques entre assassins, sorcières, lords, soldats et paysans. Mais avant tout, ce sont les personnages mêmes qui sont explosés : au lieu d’un seul Macbeth, il y en a trois — Macbeth (se) montre donc le sujet du pouvoir, sous trois aspects différents mais symptomatiques. Le discours va à l’encontre de l’unité du personnage, ainsi se découvrent des angles différents d’un discours du pouvoir.
Müller s’explique : « L’argument le plus important en faveur de la répartition du rôle-titre en trois comédiens était le suivant : de cette façon, on pouvait montrer distinctement et parallèlement trois expressions du pouvoir : Gwisdek joue le mannequin du pouvoir, le dictateur sur le podium. Montag était l’interprète de la peur, car le besoin de pouvoir cache toujours un manque d’assurance. Enfin, Beyer était le cerveau, le malfaisant […] le cerveau de Macbeth au sein du public. »
La pièce de Shakespeare — qui met en scène une soif de pouvoir individuelle — se transforme sous le regard de Müller en un examen des structures et fonctionnements du pouvoir absolu : une étude des trois corps du pouvoir.
- Le sujet du pouvoir qui se construit à travers la cruauté
- Le souverain du désespoir et de la peur
- Le despote cynique et désillusionné
L’une des scènes les plus frappantes de ce Macbeth est la scène 17 — le meurtre de Lady Macduff et de son enfant. Une scène presque silencieuse, muette — seules cinq phrases y sont prononcées. La mise en scène donne un caractère irréel, fantastique à la scène : Lady Macduff est assise devant sa coiffeuse et se peigne les cheveux. (Le changement et l’installation des éléments scéniques viennent de se passer à vue. Sur le trône / chaise électrique est déjà installé le lord — la prochaine victime, qui suivra dans la scène 18. Du haut-parleur proviennent des cris d’oiseaux.) Elle porte une robe argentée, sous un long manteau de plastique transparent. Tandis que Macbeth / Montag se positionne face aux spectateurs sur le plateau, les deux autres Macbeth, tout de noir habillés, s’approchent de Lady Macduff par les côtés, saisissent l’enfant — une poupée abîmée — la renversent au-dessus du vide de la fosse d’orchestre et la transpercent de plusieurs coups d’épée. Du sang sort de la poupée. (L’endroit ainsi marqué par le sang n’est jamais nettoyé, ainsi la tache rouge s’agrandit à chaque représentation.) Lady Macduff assiste à la scène dans un cri muet, elle tente de se sauver dans la cabine téléphonique. Prise au piège par les deux Macbeth qui exécutent le meurtre au ralenti, tel un rituel. Ils transpercent Lady Macduff jusqu’à ce qu’elle se pétrifie littéralement. Pendant toute la scène, une violoncelliste joue, en contrepoint, une mélodie classique et harmonieuse…
Lorsque les deux Macbeth ont fini leur travail, ils s’assoient tous les deux, décontractés, sur la coiffeuse, prêts pour une autre mission, tandis que le Macbeth / Montag continue à toiser et à scruter le public : à qui le prochain tour ?

Müller offre là une conception de Macbeth qui dérange et perturbe le public autant que la critique — celle-ci lance un débat sur la « perspective nihiliste » de Müller, sur son « pessimisme historique » ainsi que des discussions sur un théâtre radicalement anti-didactique qui, selon elle, « barre l’accès du spectateur à la pièce par un abus d’utilisation de signes et de métaphores »…
Vue a posteriori, cette mise en scène déstabilisante aura ouvert une brèche dans le paysage théâtral est-allemand — de jeunes metteurs en scène comme Castorf y ont trouvé des impulsions nouvelles…

Jürgen Gosch