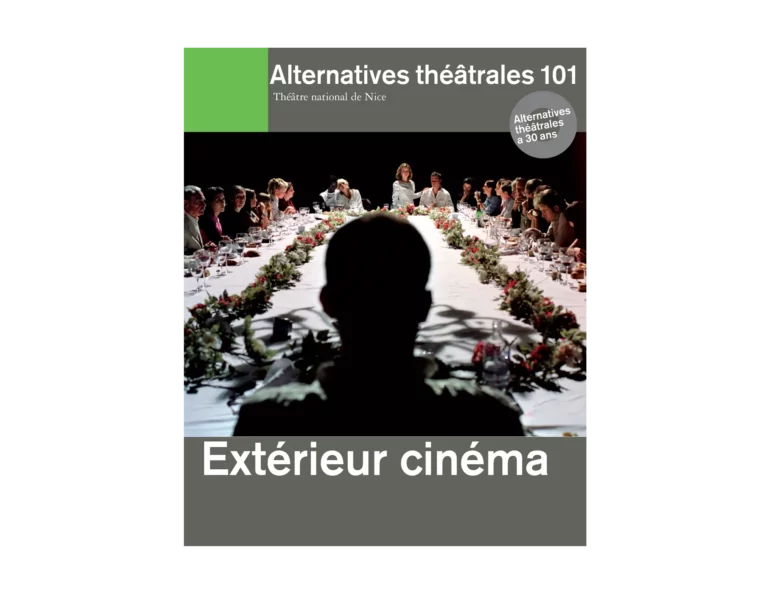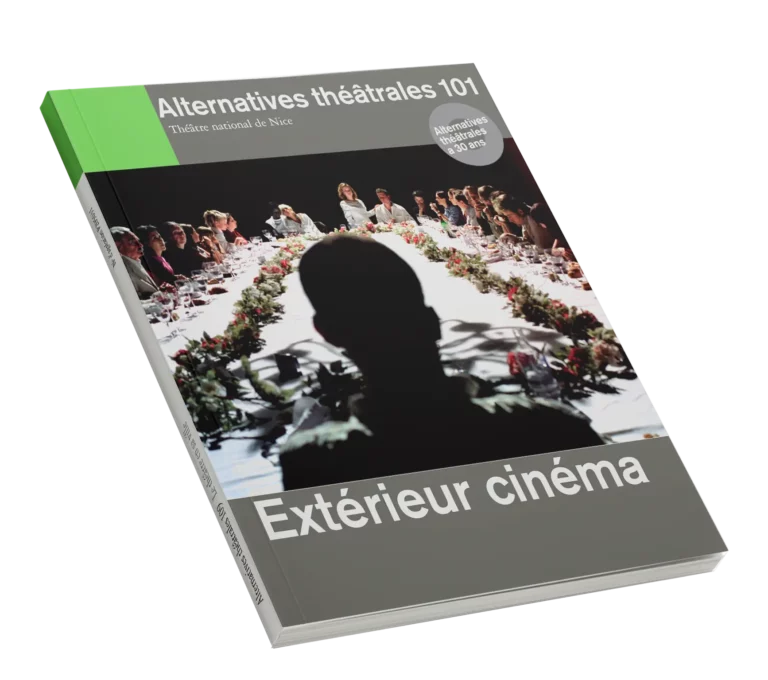« Après la répétition est devenu un film de télévision par hasard, tout comme fut présenté, par hasard, sur scène Un dernier cri. Mon intention c’est aussi que S’agite et se pavane soit joué au théâtre. (…) Le cinquième acte évoque mes infatigables compagnons : le théâtre, la scène, les comédiens et le cinéma, les cinémas, l’art, la technique du cinéma. Ils m’accompagnent depuis que j’ai construit mon premier théâtre de poupées, sous la table peinte en blanc de notre chambre d’enfants et depuis que, quelques années plus tard, je me suis retiré dans l’immense penderie avec ma petite machine en tôle et sa manivelle reliée à une roue dentée et une croix de Malte, sa lentille, sa lampe à pétrole et son bout de film sépia. »
Bergman
Bergman entre : théâtre et cinéma, hasard et plaisir…
Tout ou beaucoup des thèmes récurrents dans l’œuvre de Bergman sont contenus dans ces quelques lignes du prologue – en forme de monologue –, du Cinquième acte, publié en 1994 : l’amour, la mort et l’art, la fiction et la réalité, la folie et la création , la punition et la peur de la punition, la liberté, et son insatiable fascination pour les acteurs.
Le Cinquième Acte est un recueil de pièces écrites par Bergman sans visée spécifique, dit-il. S’il a lui-même d’abord tourné Après la répétition pour la télévision suédoise, si Un dernier cri a été monté au théâtre avant d’être tourné pour la télévision, et si S’agite et se pavane a connu une version filmée pour la télévision, c’est, selon Bergman, par pur hasard… « Mes textes sont écrits sans être destinés à tel ou tel médium, à peu près comme les sonates pour violoncelle de Bach (sans aller plus loin dans la comparaison) : elles peuvent être jouées par un quatuor à cordes ou à vent, à la guitare, à l’orgue ou au piano. (…) J’ai écrit comme j’ai eu l’habitude d’écrire depuis plus de cinquante ans – cela ressemble à du théâtre mais peut aussi bien être du cinéma, de la télévision ou simplement de la lecture. » Ce n’est évidemment pas seulement le hasard qui guidait les productions de Bergman. Dans un entretien pour les Cahiers du cinéma, datant de 1998, l’auteur-réalisateur-metteur en scène déjà fort connu, âgé de 80 ans, reconnaissait : « Seul me guide le principe de plaisir » : celui d’écrire des histoires sans souci du médium, pour le bonheur de les voir incarnées par des acteurs, pour celui de travailler avec les extraordinaires hypocrites extravertis qu’il affectionnait tant.
Bergman abordait souvent cette question de l’hésitation – ou plutôt du balancement volontaire‑, entre les différents formes susceptibles de présenter son art, disant volontiers que le théâtre est comme une épouse et le cinéma comme une maîtresse. S’agite et se pavane offre une preuve étonnante de ce louvoiement amoureux. Et comme Bergman aime passionnément les deux (le théâtre et le cinéma, la femme et la maîtresse), il ne choisit pas : il prend tout. S’agite… est l’histoire de l’inventeur d’une nouvelle forme de cinéma révolutionnaire, le cinéma parlant et vivant. C’est à vrai dire une idée géniale : tandis que défile le film muet, des comédiens placés derrière l’écran prononcent au micro les répliques des acteurs.
L’ingénieur génial qui a eu cette idée, Carl Akerblom, (en référence au véritable oncle Carl que Bergman aimait tant, l’inventeur fou, son préféré)… parvient à la réaliser avec l’aide de sa jeune fiancée Pauline, et du professeur rencontré à l’asile, Vogler. Cette pièce en trois actes commence à l’hôpital psychiatrique (où naît la géniale idée), et se clôt sur la scène de théâtre du local de la Ligue de la Tempérance à Granas (où ont lieu les projections du premier film vivant et parlant, intitulé La Joie de la fille de la joie). Un soir, un début d’incendie se déclare, les plombs sautent, et il faut arrêter la projection. Nous, spectateurs réels, voyons cette scène comme si nous étions derrière l’écran : en fond de scène, l’écran de projection derrière lequel on imagine les spectateurs de ce film ; de la salle, nous voyons le film à l’envers. Après l’incident technique qui a plongé tout le plateau dans le noir, les spectateurs du film sont rapatriés derrière l’écran (donc, à notre vue maintenant) et invités à voir la suite de la représentation en direct… The show must go on, sans électricité. A la lumière des bougies, le petit groupe des spectateurs assiste à La Joie de la fille de joie dans une mise en scène d’une grande simplicité, dans une version archaïque et épurée. Très loin de la technique cinématographique, tout près des origines du théâtre. Cette pièce-là a l’air d’une cérémonie, d’un rituel laïc et partagé. Les spectateurs participent, commentent, boivent un verre à l’entracte. La confusion a régné dans le passage du cinéma au théâtre, et règne encore chaleureusement sur ce plateau de théâtre : nous, spectateurs réels, assistons à la représentation de S’agite et se pavane, qui contient en son sein la représentation de La Joie de la fille de joie – elle même passée du cinéma au théâtre.