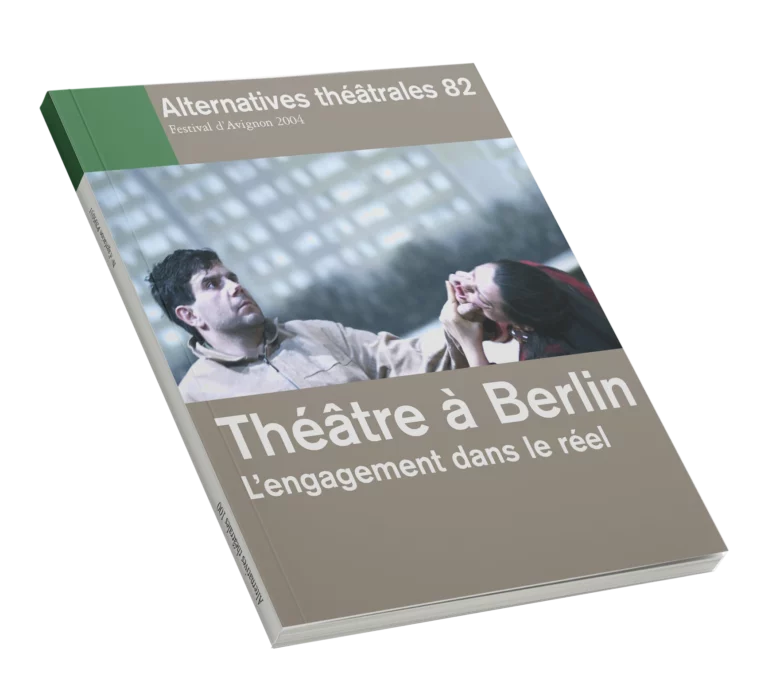NORA : environ 40 ans, à peu près 1m70, deux enfants, de longs cheveux bruns, collant déchiré, de hautes bottes à lacets, minijupe, tee-shirt, bracelets en cuir aux bras, dégoulinante de sang…; il est question de la Nora d’Ibsen, le premier cas connu d’émancipation féminine dans la littérature moderne ; déguisée en la femme la plus connue de notre temps présent envahi d’ordinateurs : Lara Croft.
Thomas Ostermeier aborde sa NORA ( MAISON DE POUPÉE ) en 2002 au théâtre de la Schaubühne sous l’angle de l’émancipation du corps féminin. Habillée de costumes élégants, Anne Tismer pose dans le rôle de Nora pendant deux heures devant son mari : ouvre sa blouse, lui permet d’embrasser ses pieds, de la suivre à quatre pattes. Un couple en copulation permanente. Le mariage des Helmer ne semble animé que par cette sexualité luisante exhibée d’une façon esthétisante sans aucun sentiment. Et bien que la femme soit l’objet du désir, c’est l’homme qui dicte les règles. Et c’est Torwald Helmer qui a choisi le déguisement de sa femme pour la soirée : à savoir Lara Croft, ce fantasme ambulant des hommes, longues jambes et seins fermes. Puissamment moderne, une femme qui tue, mais qui n’est qu’une image créée par les hommes. La danse que Nora essaie d’exécuter, au début, suivant les idées de son mari, se transforme au retour de la soirée en une sorte de chorégraphie incontrôlable, une échappée apparemment interminable du rôle de la charmante épouse, une forme de transe un peu perdue, d’une agressivité incontrôlée, une danse comme acte de libération.
Comme l’oppression de Nora n’avait fonctionné qu’à travers son corps, la révolte ne peut se passer qu’à travers son corps. À la fin, lorsque la Nora d’Ibsen claque la porte, la Nora de Ostermeier tue son mari. La destruction totale de l’autre corps – elle tire et retire sur lui jusqu’à ce que le corps de Helmer, mort depuis longtemps, soit criblé de balles et complètement défiguré. Ce n’est qu’alors que Nora peut quitter sa maison. Elle est accroupie devant la porte d’entrée, toute petite, à la place de ses blouses et costumes qui avaient souligné sa silhouette, elle porte un vieux jean qui cache tout, avec un anorak blanc, avant qu’elle ne s’éloigne lentement de sa maison.
« Le champ de bataille des années quatre-vingt-dix était le corps : le physique, non le psychique. Le côté social était la relation entre différents besoins du corps entre eux. Les rencontres étaient des collisions de chairs, de corps qui jouaient avec leur vie. Mais le plus grand problème du corps, c’est son désir de se réunir avec l’autre : soit par la conquête, soit par la soumission…
Il s’agissait de défendre le corps contre l’abus involontaire, contre l’appropriation, les blessures, la transformation en marchandise. Et il s’agissait de le sentir, de se retrouver en lui, même en le blessant ou en le détruisant. Il s’agissait de le quitter et de le dépasser ( gender crossing – opération génitale – Coca-exstasy-speed). L’idéal, c’était d’avoir autant de vrais corps que possible et ceux-ci devaient être enragés ou sombrer. Le corps était le dernier bastion de l’autonomie et de l’autodétermination. ». Ce sont les paroles d’Ostermeier lors de sa conférence en 1999 intitulée Le théâtre à l’ère de son accélération.
L’approche par le corps nous apprend l’essentiel des mises en scène d’Ostermeier. D’une part, il y a les pièces contemporaines qui ont pour objet la lutte du corps pour prendre la place vacante de l’âme chez les gens modernes. C’est le prostitué Gary dans la pièce de Mark Ravenhill SHOPPEN & FICKEN ( SHOPPING AND FUCKING ), qui ne peut ressentir l’amour et l’amitié qu’à travers la brutalité et l’abaissement du corps. C’est le Kurt en puberté de la pièce FEUERGESICHT ( VISAGE DE FEU ) de Marius von Mayenburg qui, en perdant toute confiance en soi, ne peut sauver son ego en déroute qu’à travers l’immolation par le feu. Ce sont Schweinl et Ferklin dans DISCO PIGS de Enda Walsh qui ne peuvent plus exister qu’à travers l’accélération de leurs corps, dans l’action pour l’action. Mais c’est aussi la pièce MANN IST MANN ( UN HOMME EST UN HOMME ) de Bertolt Brecht, où l’homme en tant qu’individu se dissout dans le soldat anonyme en marche. D’un autre côté, nous trouvons aussi des pièces classiques, comme DANTONS TOD ( LA MORT DE DANTON ) et WOYZECK de Büchner ou bien NORA d’Ibsen, L’OISEAU BLEU de Maeterlinck ou LULU de Wedekind. Ici aussi, Ostermeier accorde une grande importance à l’acte corporel par rapport aux idées et aux paroles. Le dangereux discours sanguinaire de Saint-Just ( LA MORT DE DANTON ) devant la convention est un acte de balance à une hauteur de plusieurs mètres au-dessus d’un tas de tables empilées. L’être aliéné et déchiré dans ses rapports humains qu’est Woyzeck se révèle à travers des chorégraphies d’une bande de jeunes vauriens de la banlieue qui se jettent à plusieurs reprises avec une agressivité aveugle sur leur victime. Ou le corps de Lulu qui reste, même pour elle-même, un instrument impassible et irresponsable. C’est exactement sur cette ligne de démarcation très étroite entre action et psychologie que se décide la réussite des mises en scène d’Ostermeier. Là où la peine du corps est la clé qui donne accès à la compréhension des personnages, Ostermeier produit des travaux impressionnants, donne accès à une autre compréhension des complexités des désirs et des craintes. Dans le pire des cas toutefois, il bloque l’accès à l’histoire d’un texte par des actions aveugles et des courses incohérentes ; il réduit les personnages à des cosses inintéressantes et dépourvues de sens.
Mais revenons d’abord aux principes du style d’Ostermeier dans ses mises en scène. Avant sa formation de metteur en scène à l’École Ernst Busch, il étudia pendant quelques mois le jeu de comédien à l’École supérieure des arts ( HdK) de Berlin. Lorsque Einar Schleef engagea des étudiants de la HdK en 1990/91pour son FAUST, Ostermeier entra en contact avec les chorégraphies rythmiques archaïques de Schleef. Ce fut l’une des premières influences que l’on retrouve dans son travail RECHERCHE FAUST /ARTAUD de 1996 qu’il réalisa encore à l’Institut de mise en scène de l’École Ernst Busch, mais que l’on retrouve aussi dans ses travaux ultérieurs, surtout dans la chorégraphie des mouvements et des paroles des masses, comme dans WOYZECK. RECHERCHE FAUST/ARTAUD fut aussi une tentative de réaliser un collage entre le fragment FAUST de l’expressionniste allemand Georg Heym et les théories de théâtre d’Antonin Artaud. Avec le chœur scandé dont le ton gonfle peu à peu, Ostermeier soulève le texte au-dessus de la signification que Heym lui attribua à l’origine et le confronte ainsi à une autre expérience et perception. À l’aide d’une intonation expressive, décalée et aliénée par les répétitions, il crée une impression de perception corporelle des mots dans l’espace, un niveau de signification transcendée dans la métaphysique, portée par les résonances rythmiques de la langue qui se transmettent à celui qui parle et à l’espace. Ostermeier continue à explorer les confrontations entre les idées esthétiques d’Antonin Artaud et les circonstances réelles de la scène dans L’OISEAU BLEU de Maeterlinck qu’il monte au Deutsches Theater en 1999. Par une utilisation des corps poussés à leur extrême, par des actions qui finirent par ressembler à des séances d’exorcisme, il voulait arriver à des effets au-delà des conventions théâtrales qui devaient toutefois rester encore accessibles et consommables. Cette méthode produisit des tableaux impressionnants, purs, poétiques. La conception d’Artaud semblait en grande partie réussie… mais la pièce de Maeterlinck et la soirée en firent les frais.
Toutefois, le point de référence le plus important qu’Ostermeier utilise en permanence, c’est la théorie de biomécanique de Vsevolod E. Meyerhold. Il s’est senti inspiré par cette méthode lors de sa formation dans un atelier avec le professeur de biomécanique Gennadi Bogdanov et il utilise ce principe depuis lors dans beaucoup de ses mises en scène. La méthode de Meyerhold est basée sur l’idée d’une économie idéale du corps et des mouvements. Meyerhold, en observant des fragments de procédés de fabrication dans l’industrie qui montre que l’efficacité maximale est inhérente à la marchandise main‑d’œuvre, développe quatre critères qui peuvent être adaptés aux arts de la scène :
1. l’absence de mouvements inutiles et non productifs ; 2. le rythme ; 3. le bon centre de gravité du corps et 4. l’endurance. Le corps de l’acteur est considéré comme matériau qui, lorsqu’il est organisé d’une façon optimale, arrive à son expression la plus intense et contrôlée à condition de l’entraîner et de le dominer selon les méthodes de la mécanique. Meyerhold pensait que l’on pouvait provoquer n’importe quel état psychologique grâce à un processus physiologique défini. Les éléments pour arriver à cette pratique de jeu sont l’acrobatique, une corporalité bien rythmée et des mouvements stylisés efficaces que l’on peutobtenir par des gestes extrêmement larges suivant certaines règles d’impulsion.