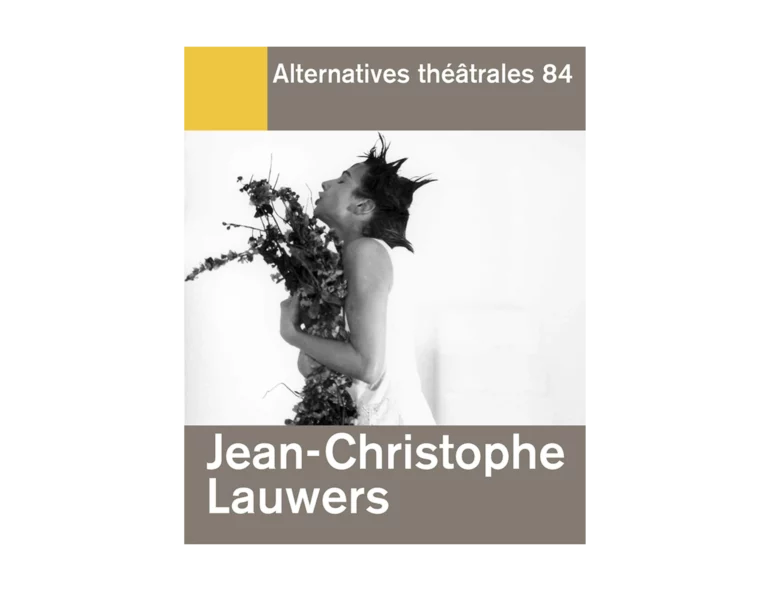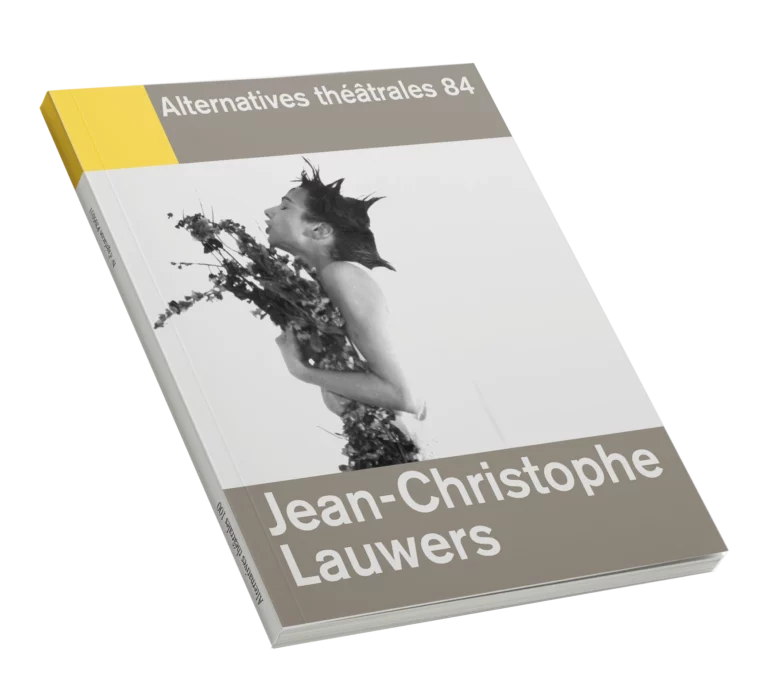Le théâtre s’est vomi, s’est retourné, s’est déchiré : cinquante ans de populisme, d’intellectualisme, d’hermaphrodisme, de corporatisme, d’utilitarisme, d’élitisme, cinquante ans d’investigations, d’horribles remises en question. Depuis cinquante ans, le théâtre s’est masturbé ! On a inventé un théâtre de mouvement dans les années soixante-dix, puis un théâtre de cris, puis de rien, puis de nouveau de texte, le théâtre a été privé de corps, puis de paroles. L’éclatement, l’éparpillement et le déversement des micro-théâtres vers les micro-publics a eu pour seul effet la destruction du spectacle, l’anéantissement de la mise en scène et l’oubli de la fonction primordiale du théâtre : provoquer (une haine, un amour, un spasme, une transe, un orgasme, une petite mort, une grande mort, un moyen suicide, un éternuement, un cancer, la peste, la foi, les foies…). Ni la mise en scène illustrative (naturalisme bourgeois), ni la mise en scène critique (didactisme néo-brechtien), ni la mise en scène dite de « rencontre » (trouvaille du metteur en scène : Britannicus est transformé en homosexuel) n’a réussi à faire naître le théâtre. Toutes ces tentatives ont été des échecs, le théâtre est en train de crever. Que faire dès lors pour rendre au théâtre sa place d’organe vital ?
I. D’un théâtre du questionnement
Pourquoi le théâtre n’est-il plus indispensable à la société ? Il n’est plus à prouver que notre siècle « a‑tomique » a perdu tout sens du sacré (on a abandonné le questionnement sur les origines). On a cru tout comprendre de l’homme et de sa naissance avec l’éclosion des théories évolutionnistes mais aussi avec celle des théories opérationnelles de la naissance de l’univers et on n’a plus voulu remettre en cause ces réponses que notre monde occidental blanc a trouvées non seulement satisfaisantes mais gratifiantes (puisque par ces théories, on découvrait scientifiquement la naissance de l’homme mais surtout la suprématie de l’homme blanc). La situation actuelle est différente, nous sommes en train d’assister à la mort des théories évolutionnistes grâce à la psychanalyse1, mais on assiste également à l’écroulement de la notion de race et de suprématie culturelle grâce entre autres aux travaux de Luigi Luca Cavalli Sforza2, théories qui remettent en cause l’équilibre même de notre civilisation. La question des origines réapparaît. Avec elle l’angoisse. Mais, après ces déceptions, ce qui nous intéresse n’est plus de formuler des mauvaises réponses mais de reposer convenablement les questions indispensables à notre survie.
Dans ce contexte de recherche, de remise en question, le théâtre ne dit plus rien, ne pense plus rien. Et c’est pour cela qu’il est devenu un divertissement. Un divertissement qui demande un investissement en temps, en énergie et en argent bien supérieur à celui que demande la télévision. Rajoutez à cela l’ennui causé par un « spectacle » statique dominé par un discours élimé et vous saurez pourquoi même le cinéma (qui demande également plus d’énergie et d’argent que la télévision) a également pris le dessus. C’est donc parce que le théâtre n’est plus qu’un divertissement parmi d’autres beaucoup plus agréables et moins chers, qu’il n’est plus du tout indispensable, et est même devenu presque inutile à notre société.
Voici donc pourquoi il faut qu’on en revienne à un théâtre de questionnement, le théâtre doit questionner les origines, la naissance, l’apparition, le théâtre doit dire le sacré. Et pour dire le sacré, il faut que le théâtre devienne un théâtre parlant, et non plus simplement un théâtre parlé. Exactement comme l’être humain, il est primordial que le théâtre fasse l’expérience de son corps, qu’il fasse l’expérience du langage.
II. L’acteur en tant que théâtre du corps
L’important, c’est de reprendre l’acteur — l’élément capital du théâtre, sa condition sine qua non — pour ce qu’il est : c’est-à-dire le corps humanisé du théâtre. Affirmer cela ne revient bien entendu pas à dire que le théâtre doit être une vitrine à corps en mouvement privés de langage oral. On a vu ce que la gestuelle pure pouvait produire comme débilités profondes. L’acteur est le corps humanisé du théâtre, c’est par lui que le théâtre vit et c’est par lui que le théâtre parle.
Un corps ne peut parler que totalement, avec tous ses membres (on imaginerait mal un homme qui ne communiquerait qu’avec son cerveau et ses cordes vocales). Et lui, l’acteur, corps du théâtre, a également besoin pour parler d’un Autre parlant (scénographie, bande sonore, lumière : toutes ces représentations fictives de la Nature). Car dans le dit du sacré, il va sans dire que la Nature a la place d’honneur, la Nature doit inévitablement parler, être l’Autre parlant de l’homme, et l’inverse. L’erreur jusqu’à présent était de croire que l’Autre parlant de l’homme-théâtre face à la Nature était le public. Mais pour l’homme-théâtre, le public ne doit être rien d’autre que l’environnement.
Voici donc en quoi le théâtre est imaginaire : pour une fois l’homme parlant a en face de lui un autre homme, sans que celui-ci soit l’Autre. L’homme devient environnement des parlants, c’est ce qui en fait un spectateur. On m’a objecté l’autre jour que l’Autre parlant dans la situation d’un théâtre du questionnement des origines pourrait fort bien être le texte dit par l’acteur. Mais comment imaginer un instant un acteur capable de se battre (et il ne s’agit pas ici d’une vision romantique-utopique du théâtre où on pourrait me rétorquer, larmoyant : « Mais à chaque seconde l’acteur se bat avec le texte ») contre le texte qu’il dit ? C’est-à-dire que le texte serait dans ce cas-là la Nature (puisque nous avons vu que l’Autre parlant devait être la Nature), et que l’homme serait toujours le corps humanisé du théâtre. Il est bien évident qu’une telle démarche est totalement irréalisable sur un plateau.