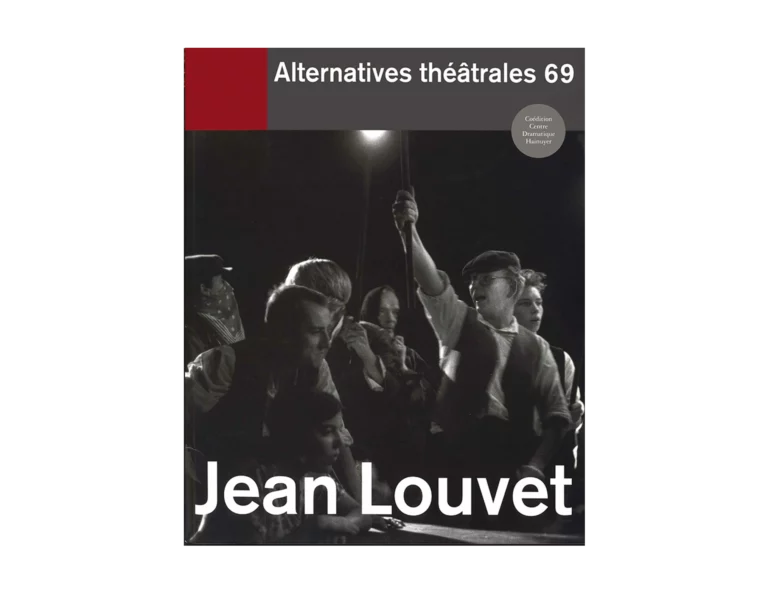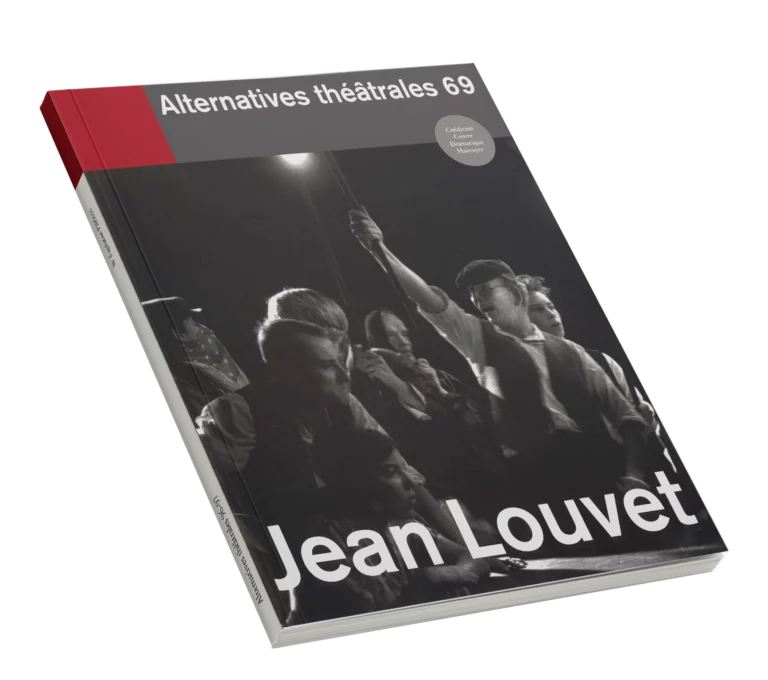« POURQUOI L’AVENIR devrait-1l être un problème ? N’avons nous pas enfin assuré nos moyens d’existence ? Le problème est notre « humanité ». On ne peut jamais dire d’un chien que son comportement n’est pas celui d’un chien. Mais nous disons souvent d’un comportement bumain qu’il est inhumain. Ce n’est pas rhétorique, mais analytique. Nous créons notre bumanité on notre inbumanité. La raison ne fait pas de nous des êtres humains. La limite de la philosophie des lumières est que la raison peut servir la corruption. Nous sommes humains parce que nous sommes conscients de nous-mêmes. Sans imagination on ne peut être conscient de soi. Les deux sont un. Sans l’imagination, nous serions enfermés dans le présent, incapables de réfléchir. L’imagination est l’origine de l’humanité. »
Edward Bond1
Dans cet article publié dans Le Monde Diplomatique du mois de janvier 2001, Edward Bond disait en substance que nous n’avons aucune raison pratique d’exister et qu’en conséquence il nous revient de nous inventer nous-mêmes une finalité, et de créer ainsi notre humanité dans ce qu’il appelle la cinquième dimension. Les dix-neuvième et vingtième siècles ont démontré les limites de la philosophie des lumières. Auschwitz, Hiroshima en sont l’illustration éloquente : la raison peut servir la corruption. Elle n’est donc pas une finalité possible pour l’humanité. Au-delà de la mort irrévocable de Dieu et de l’échec de l’entreprise rationaliste, subsiste en nous un désir de justice — dont Bond nous dit qu’il est hérité de l’enfance — qui refuse l’acceptation fataliste de la loi de la jungle. Mais notre rapport au réel est faussé. L’horreur économique et politique se dissimule derrière un grand show virtuel qui isole l’individu des réalités collectives et qui finit par générer une scandaleuse indifférence face aux tragédies les plus inacceptables. Pour paraphraser Zola en inversant sa proposition à propos de Dreyfus :l’injustice n’a plus de corps. Nous avons perdu le chemin qui conduit vers l’autre.
Benoît et Arthur se rencontrent, au rayon de nourriture pour chien d’un grand magasin. L’annonce fausse d’Arthur — « Mon fils est mort. » — va ébranler Benoît. Il consent à un prêt dont la somme est assez modeste : 1 000 francs. Les deux hommes conviennent même du délai de remboursement. Mais, le troisième jour, Arthur ne se présente pas au rendez-vous. Le fait de ne pas revoir son débiteur va bouleverser le créancier. L’émotion réelle suscitée par cette rencontre vraie autour d’un récit faux va sortir Benoît de son isolement. L’aveu d’une douleur intime et secrète, qui lui a été transmis mystérieusement, le responsabilise concrètement, le « mouille ». Le départ, la fuite, la trahison d’Arthur vont révéler à Benoît la nécessité de s’ouvrir, de s’engager, d’agir. Quand ils se revoient un an après, le jeu de dupe proposé par l’un — et dont il finit d’ailleurs par être luimême victime, bouleversé qu’il est par la violence de l’émotion qu’il a suscitée — a brisé l’isolement de l’autre, lui a ouvert une fenêtre sur le réel, l’a sorti de sa « longue indifférence à l’état du monde ».
Le texte de Louvet rappelle par bien des points celui de DANS LA SOLITUDE SES CHAMPS DE COTON de Koltès. On le sait, dans cette extraordinaire pièce, un homme en aborde un autre dans la rue pour tenter de lui vendre quelque chose, en spéculant sur son désir supposé, mais en refusant absolument de nommer la marchandise qu’il propose. Le « commerce » entre le dealer et le client est, bien sûr, intéressé. Il a un objet. Mais comme celui-ci reste informulé, n’advient jamais, il prend la forme d’un manque. Le désir porte sur un objet qui n’a pas de nom. Ce manque, qui est l’enjeu véritable de la rencontre, est occulté par une série de fausses pistes avec lesquelles les personnages se mentent l’un à l’autre ou à eux-mêmes. Tout est dissimulation, jeu de dupe, langage codé, avec toujours une part de mauvaise foi. L’enjeu du commerce avec l’autre, en fait, c’est l’autre, mais les personnages refusent de l’admettre, le fuient même, systématiquement. Ils se posent mutuellement une question sans réponse.
Ce manque fondamental de l’autre hante le texte de Louvet. C’est lui qui permettra la rencontre. Il est constitutif de la condition humaine. Oublier cette béance conduit à la barbarie. Les nouvelles techniques de communication nous donnent l’illusion de la connaissance universelle, alors que, dans le même temps, la « nouvelle économie » déploie une panoplie de gadgets virtuels pour nous persuader que nous sommes seuls, que nous n’avons aucune prise sur le réel, qu’il nous échappe et que nous devons, en conséquence, renoncer définitivement à le transformer.
Benoît comprend immédiatement la douleur d’Arthur. Il l’entend. À sa voix. Parce qu’il la partage. Ce que raconte cette voix est faux, mais la solitude qu’elle révèle est vraie. En retour, Arthur sera bouleversé par le regard et les larmes de Benoît. Instantanément. Comme le dealer de Koltès avait perçu le froid du client et lui avait proposé son manteau, avant même que le premier mot ait été échangé entre eux. Nous avons encore un corps capable d’éprouver des émotions, et donc d’aller vers l’autre. L’issue de la rencontre diffère radicalement d’un dramaturge à l’autre. Chez Koltès, le sang coule inéluctablement. Chez Louvet, au contraire, cela se termine dans les rires de deux potaches qui célèbrent leurs retrouvailles. Il y a là un refus obstiné du désespoir. Ou la redécouverte d’une solidarité possible ?
Ce qui permet à Arthur et Benoît de trouver une issue à la rencontre, c’est la fiction. Comme le dit très justement Étienne Marest dans l’article qu’il consacre au texte de Louvet2, « La parole de ces êtres parlants n’est plus celle par laquelle la vérité viendra, car la vérité n’est plus à l’ordre du jour ». Il ne s’agit plus, pour Benoît et Arthur, de formuler une vérité consolante, mais bien de revendiquer le droit à la fiction, c’est-à-dire à la réinvention du réel. Dans ce rayon d’aliments pour chiens du grand magasin, Arthur va aider Benoît à redéfinir ce qui constitue leur humanité. Les personnages de Koltès, écrasés par Les années « fric », sont à la recherche d’une certitude immanente qui donnerait un sens à leur existence. Ceux de Louvet revendiquent le droit de rêver leur vie par eux-mêmes, ici et maintenant, par la grâce de la rencontre, avec la liberté de l’enfance et les armes de l’utopie. Parce qu’il y aurait un réel danger à vivre dans une humanité incapable d’être émue par la mort d’un enfant, Arthur met Benoît à l’épreuve. La fiction lui permettra de retrouver ses émotions et sa dignité d’être humain. Ce fils à la peau noire comme celle des cadavres impudiquement outragés, cette année-là, par les images banalisantes des postes de télévision, et qui n’a, au départ, qu’une existence imaginaire, va « naître » réellement de l’émotion partagée des deux hommes.
À l’occasion de la création à Mons de L’ANNONCE FAITE À BENOÎT, nous avons été invités, Jean Louvet et moi, à participer à une émission de la RTBF Hainaut. Face à face, dans le studio, s’est alors entamé un étrange et profond dialogue. Nous appartenons pourtant à des générations différentes, nous sommes issus de milieux sociaux opposés ; nous n’avons pas la même histoire. Quelque chose comme un décloisonnement se produisait. Indice, peut-être, d’un changement d’époque. Louvet a dit à plusieurs reprises qu’il y avait des pièces inavouables et que L’ANNONCE FAITE À BENOÎT était de celles-là. Sans doute le doit-elle à ce risque pris de s’aventurer « ailleurs ».