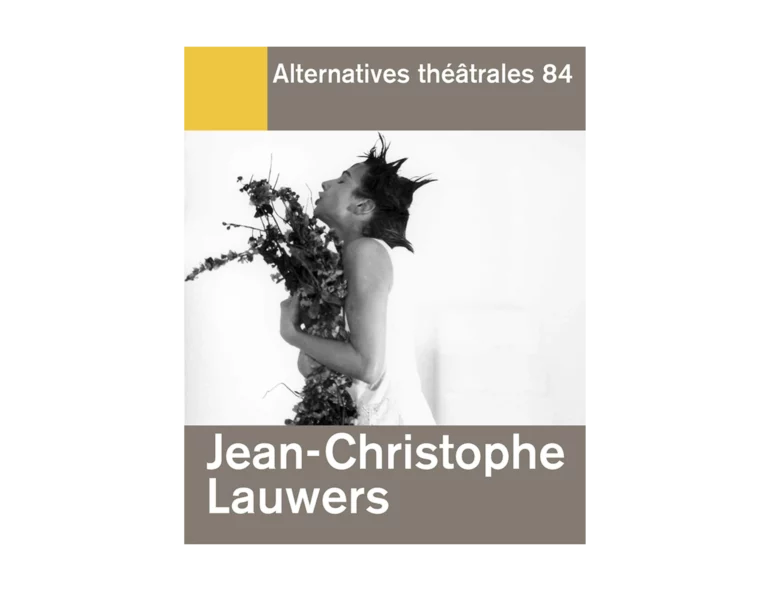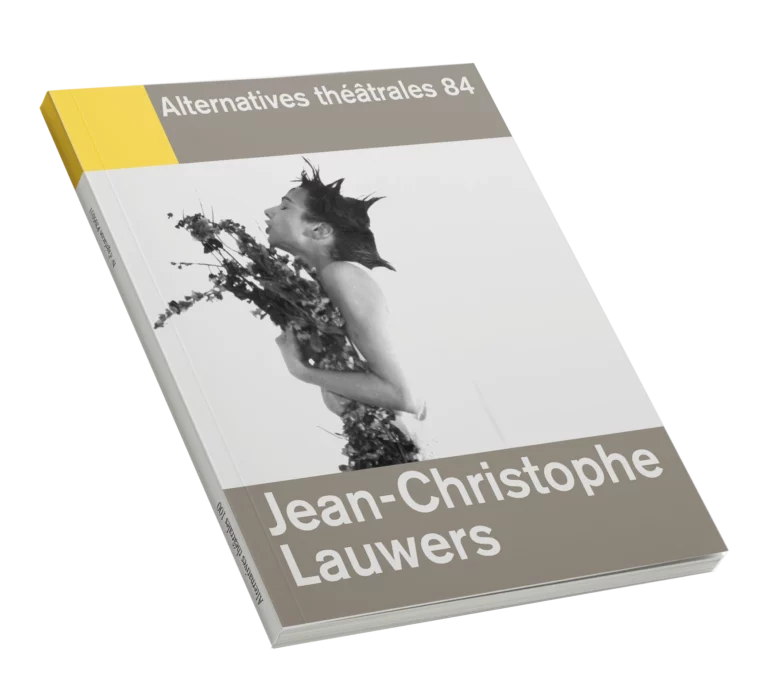Lettre de Jean Christophe Lauwers à Eric Clémens (non daté).
Cher Éric,
J’ai d’autant de plaisir à répondre à ton texte sur la dramaturgie qu’il ne m’était pas directement adressé. Les questions que tu y poses et surtout le style que tu lui imposes, semblent traduire un tournant dans ta pensée théâtrale, qui à force de dénégation s’est finalement éclose.
Ton texte me ravit donc, d’autant qu’il me permet de transmettre un maigre savoir à la personne qui m’a le plus appris, maigre savoir sur la dramaturgie, sur son histoire, et sur la pratique.
La dramaturgie moderne, historiquement parlant, n’a pas toujours été équivoque. Il faut, pour en trouver l’origine réelle, se pencher sur l’histoire de l’art opératique. Il fut un temps, enfanté par Wagner et le gigantisme de ses décors, où les chanteurs d’opéra se devaient d’être le plus obèse possible, question de visibilité : une Valkyrie fondue dans une scénographie grandiose aurait été du plus mauvais genre, les voix auraient perdu leur corps… Les ancêtres de Pavarotti débarquaient donc sur la scène et allaient se livrer à des combats quasi sumotoriques. Cette époque enfanta un opéra bête, abêti, où la performance vocale du chanteur, sa gestuelle redondante et l’anecdotisme d’un décorativisme qui semblait s’apaiser pour finir par s’effacer totalement rivalisaient avec la « sacro-sainte loi de l’expressivité ». Cet opéra-là, celui des caricatures, est bel et bien mort vers les années soixante, soixante-dix.
On a alors voulu réinventer la scénographie, on s’est alors tourné vers les détenteurs d’une compétence indéniable en matière scénique : les gens de théâtre. Des metteurs en scène de théâtre se sont penchés sur l’art opératique, des nouveaux directeurs ont été nommés à la tête des institutions et on a fait appel à une nouvelle race de dramaturges.
Je ne dis pas que l’opéra moderne a inventé la dramaturgie, mais qu’avant lui, la dramaturgie était intrinsèque à l’œuvre, une pièce de Marivaux portait sa théâtralité en elle-même, son style de jeu, sa dramaturgie. Mais l’opéra moderne a engendré la dramaturgie moderne. La question était : « Comment donner vie à des projets poussiéreux, passés, comment insuffler une jeunesse à un art abêti ? » Pour répondre à ces questions, il a fallu inventer une dramaturgie délibérée et systématique en opposition avec la dramaturgie « préexistante ». Cette opposition implique nécessairement que le dramaturge n’est pas le détenteur de « la » dramaturgie, mais qu’il s’y frotte.
Le dramaturge « défriche, déchiffre, balise, repère, restitue l’intertexte pour que renaisse la surprise de l’œuvre » (Jean-Marie Piemme), il s’occupe de la dramaturgie de l’intertexte, tandis que le metteur en scène est dramaturge du spectacle, et l’acteur de la scène.
Le dramaturge avait donc à cette époque une mission précise, celle de régénérer les œuvres par le décryptage de ses intertextes. Mais il s’agissait d’opéra, or à l’opéra on sait bien que la mise en scène arrive en second voire en troisième plan, ce qui n’est pas le cas au théâtre.
Et c’est là qu’intervient l’équivoque, le metteur de théâtre est forcé, consciemment dans le meilleur des cas, inconsciemment dans le pire, de forger une dramaturgie du spectacle beaucoup plus forte qu’à l’opéra, ces idées doivent brûler les planches, il est le porteur du spectacle, l’intervention du dramaturge ne peut être considérée, sauf si une symbiose parfaite mais peu probable lie metteur en scène et dramaturge, que comme frein, contrainte, aventure parallèle. L’impression que le dramaturge met un frein à l’inventivité du metteur en scène, qu’il le « ramène » au sens (comme si on pouvait se permettre d’échapper à une aventure intellectuelle au théâtre !) est devenue courante et caractérise l’inadéquation d’une pratique opératique avec une pratique théâtrale.