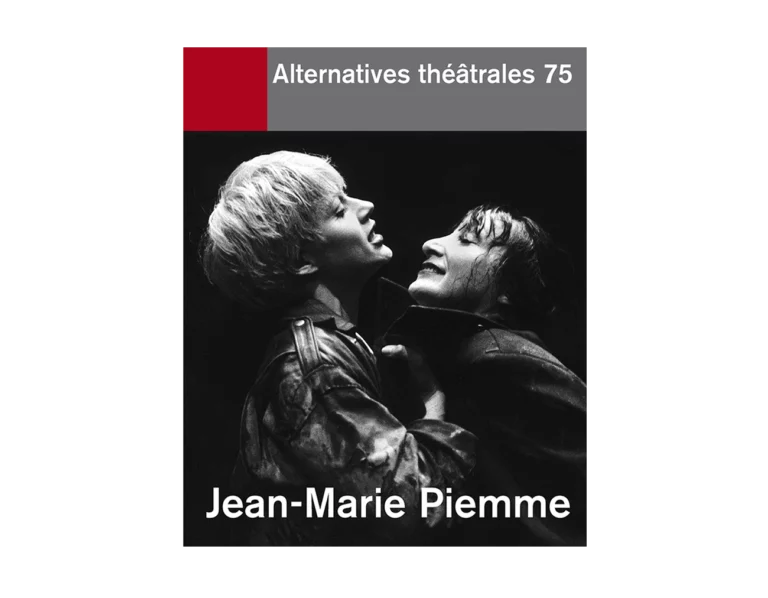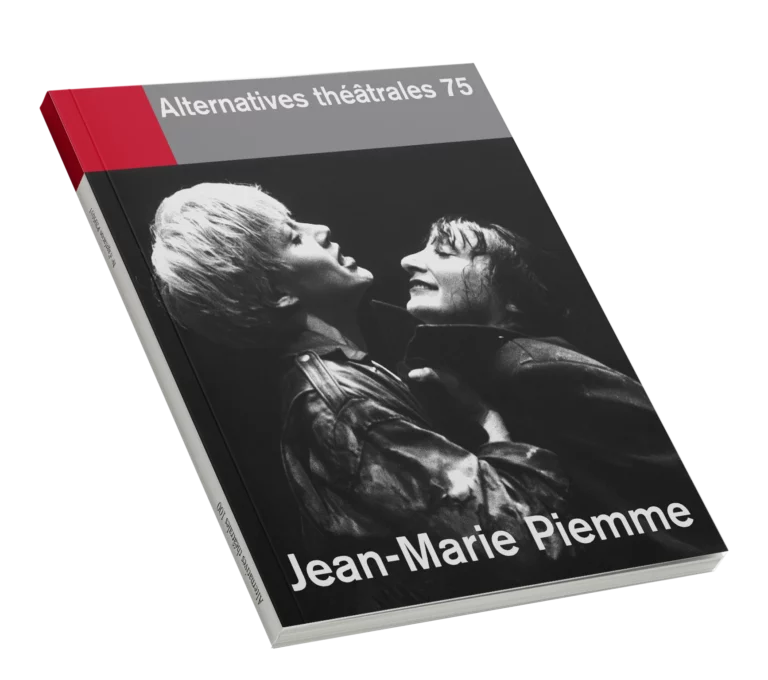Devant le volume qui regroupe en une sorte de trilogie 1953, Les Adieux et Café des Patriotes (« Didascalies », éditeur responsable Marc Liebens, 1998), c’est d’abord le souvenir de Michèle Fabien qui s’impose à moi. Elle m’avait demandé autrefois — c’était hier, à vrai dire, sa voix au téléphone — une contribution pour un cahier de « Didascalies » (déjà !), qui devait accompagner trois mises en scène groupées de l’Ensemble théâtral mobile : projet conséquent, où il s’agissait de revisiter, avec Jean Louvet [L’Homme qui avait LE soleil dans SA poche], Pierre Mertens [Une Paix royale, adaptée par Michèle Fabien elle-même] et enfin Jean-Marie Piemme, un héritage contrasté, celui des années cinquante. J’avais marqué mon intérêt pour cette entreprise ambitieuse, en précisant à mon interlocutrice que la période visée ne représentait pas seulement, selon moi, les années d’enfance ou de jeunesse d’une génération qui nous concernait de près (j’ai eu vingt ans en 1953, si j’ose parler pour ma propre personne), mais encore un moment historique où s’était décidé le sort de la juste après-guerre, une dernière hésitation, peut-être, avant que l’Europe de l’Ouest ne s’engage dans un sens unique. Evoquer cette transition, partagée entre la rémanence du combat antifasciste et l’émergence de la société de consommation (pour ne pas discuter ici cette appellation plus qu’approximative), c’était alors revenir en arrière pour mieux repartir de l’avant, se placer de nouveau à une croisée des chemins en s’interrogeant sur la voie à suivre ou plutôt à percer, d’hier à aujourd’hui.
Les difficultés financières n’ont pas manqué d’entraver le projet groupé de l’Ensemble Théâtral mobile, lequel se trouva obligé (si je ne me trompe) d’espacer ses réalisations, prévues à l’origine pour se faire écho sans tarder. Le cahier de « Didascalies » ne vit pas le jour. L’article qu’on avait sollicité de moi entra par la suite dans le numéro spécial Alternatives théâtrales consacré à Jean Louvet. Il s’agit d’une brève étude à propos de L’Homme QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE. En me saisissant maintenant de 1953, je mesure la parenté entre les deux textes. Ils se construisent par un va-et-vient critique entre présent et passé, visant à déclore une évolution historique au terme de laquelle se refermerait comme un piège un destin paralysant : celui d’une fin de l’histoire, peut-être, sous le signe de l’économie dominante. Ces deux pièces renouent alors avec une mémoire prolétarienne : non pas dea ex machina, mais flamme précaire, venant du froid et nourrie par les luttes. Elle n’aura d’effet salvateur qu’après avoir été sauvée elle-même. Cette mémoire prolétarienne transite en principe par tous les stades et toutes les strates de l’existence, par la relation de l’enfant à la mère et du fils au père, par l’érotique autant que par le politique. Pour se déplacer ainsi dans les temps et les espaces de vie, le théâtre doit s’affranchir des conventions traditionnelles, en particulier de celle qui confond la représentation avec la chose représentée.
Oubli, chemin de mémoire, mouvement : trois mots clés que l’auteur de 1953 conjoint pour dynamiser, dynamiter ou dialectiser le rapport entre l’hier et l’aujourd’hui. La date retenue pour titre fournit non un point d’arrêt, on l’aura compris, mais un point de passage, significatif, certes, puisqu’il marque peu ou prou cette croisée des chemins de la juste après-guerre, et est lui-même marqué, au surplus, par une double mort : celle de Henri de Man — le socialisme technocratique et opportuniste compromis sous l’occupation allemande — et celle, symétrique, de Staline — le communisme pétrifiant parce que pétrifié. Est-ce à dire que la voie serait ouverte à l’invention prolétarienne ? Les sept séquences constitutives du texte portent le nom d’un personnage, à l’exception d’une seule, la dernière. Rodolphe, qui baptise la troisième séquence, « homme de la cinquantaine » âgé de neuf ans en 1953, occuperait-il une place centrale ? Son âge en effet le met de plain-pied avec le public contemporain, qui se trouve interpellé en ces termes par le père du personnage, Pierre, l’ancien résistant : « J’aurais profondément honte de me présenter à vous sous des dehors négligés. Vous, visiblement, ce n’est pas le cas. Vous portez n’importe quoi, vous êtes habillés n’importe comment. » Alors, un public indifférent, indéterminé, ou positivement disponible ?
C’est dans la Résistance que Pierre a connu celle qui allait devenir sa femme, Odette. Quant au grand-père de Rodolphe, il est l’héritier de l’ouvrier de 1905, puis de 1917, puis de 1936, revenants qui apparaîtront un instant pour se présenter à leur tour au public que l’on sait. Les diverses séquences vont s’enchaîner comme un montage de fragments synthétiques (comment ne pas emprunter cette formulation à Heiner Müller ?) faisant interférer les domaines de la vie individuelle, familiale, sociale, nationale : un conglomérat de détails d’une forte intensité, qui se livrent au fil d’une écriture hachée, abrupte, comprimée comme si elle allait éclater.
La compénétration du présent et du passé, faite d’identifications et de distanciations, brise en morceaux le réalisme ordinaire, illusionniste. Les scènes sont livrées comme des citations, les interprètes endossent les personnages tels des costumes aussi vite abandonnés, les dialogues dramatiques coexistent avec des parties monologuées ou adressées sans détour à la salle. Ce qui règle le tout, c’est la démarche de la souvenance. Elle hésite à se fixer en images, comme le soulignent, de manière quasiment programmatique, les premières paroles de Pierre, qui sont aussi les premières paroles de la pièce : « Je nais des images, du dégoût que j’ai des images, du dégoût pour le simulacre de la vérité qu’entrecoupe la litanie de la marchandise, je nais du refus que j’ai de la tyrannie du vu, qui n’est pas autre chose que le visage actuel du mensonge… Aujourd’hui les images comme des insectes s’abattent en grosses nuées et pourtant jamais nous n’avons été plus proches de l’oubli. »
J’ai peur, j’ai terriblement peur de l’oubli. » Cette méfiance à l’égard des images, y compris et surtout dans la lutte contre l’oubli, mène à un type de théâtre où l’évocation prend le pas, en dernière instance, sur la représentation. Ni le passé ni le présent, à vrai dire, ne se laissent appréhender comme des grandeurs données une fois pour toutes, ni à plus forte raison le rapport qu’ils entretiennent entre eux. Le travail de mémoire consiste à remettre en mouvement le temps qui se fige aussi bien dans l’hier que dans l’aujourd’hui. Dans la dernière séquence, un père confie son fils au fleuve en prononçant ces mots : « Jamais l’eau d’un fleuve ne s’arrête, même gelée elle bouge encore. Le mouvement est ta loi, le désir du mouvement est l’héritage que je te laisse. » Et le fils dirait, poursuit le texte, « Adieu père ». Cet adieu n’en est pas vraiment un puisqu’on lit un peu plus loin : « Les lendemains résonnent toujours des échos de la veille », et encore, sur un ton martial, « Nous reviendrons demain ».