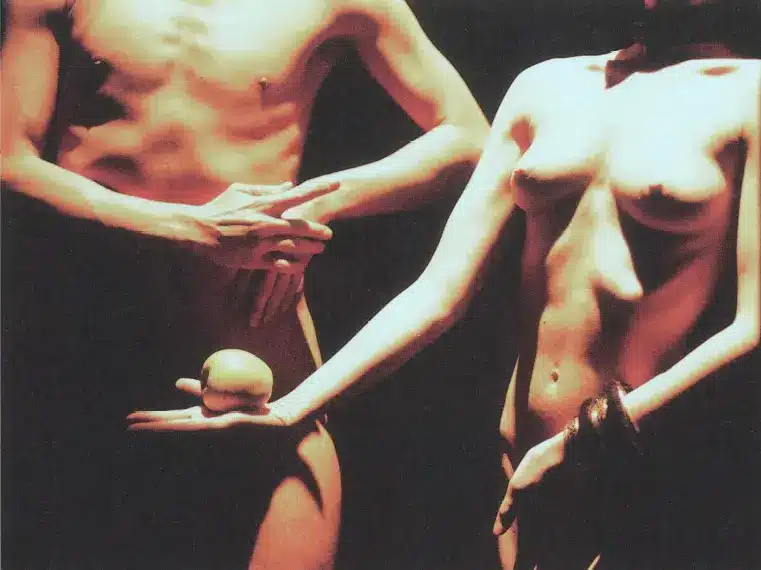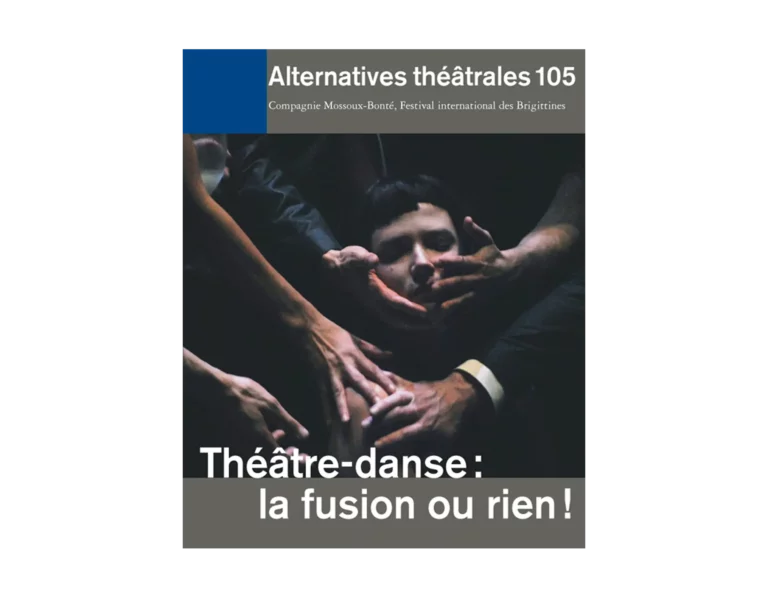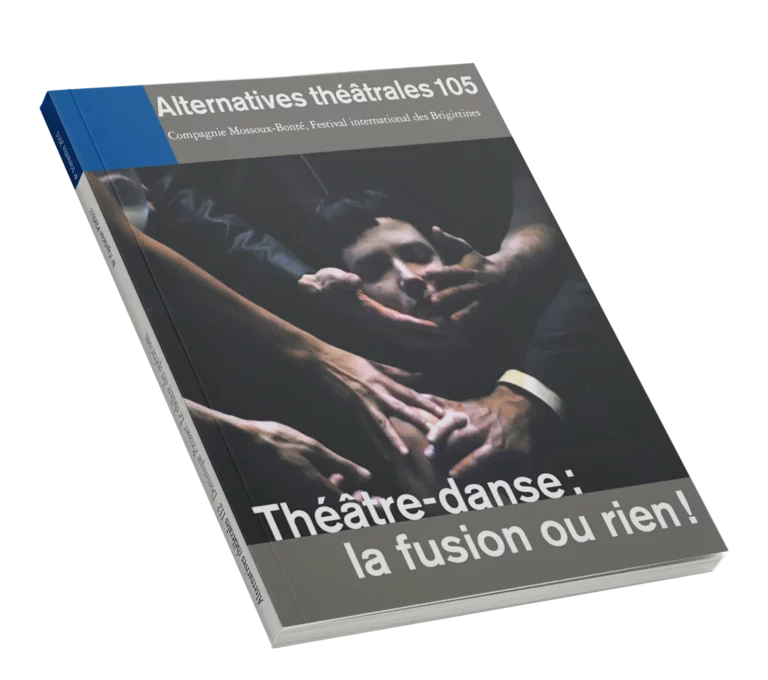PAR DEUX FOIS DÉJÀ1, il m’est arrivé, à titre hypothèse furtive et passagère, de rapprocher voire articuler trois concepts qui tous trois ont vu le jour au cours des trente premières années du xxe siècle, années d’avant-garde s’il en fut qui prolongèrent en créativité et en productivité les turbulences de la charnière de siècle ouvertes à la fin du XIxe par Maeterlinck, Ibsen, Strindberg et l’ensemble du mouvement symboliste européen. Trois concepts nés dans la même « épistémè »2 donc, pour reprendre les analyses de Michel Foucault, et qui tous trois s’enracinent dans les problématiques du regard et du voir autrement, à savoir l’Unheimlich ou « inquiétante étrangeté » inventé par Sigmund Freud et concept-clé de la psychanalyse, le « merveilleux quotidien » cher aux Surréalistes et notamment à Louis Aragon et André Breton, le « Verfremdungseffekt » enfin, effet de distanciation, d’étrangeté ou d’éloignement, conçu par Bertolt Brecht à partir des expérimentations antérieures de Piscator, de Meyerhold et des formalistes russes. Trois concepts enfin dans lesquels Patrick Bonté s’est reconnu, a reconnu une résonance esthétique, un écho philosophique à sa propre démarche — celle de recherche et de création qu’il mène avec Nicole Mossoux dans leur propre compagnie, et celle qu’il poursuit autrement par son travail de programmation aux Brigittines. Qu’il soit ici remercié d’avoir bien voulu m’inviter à approfondir le sujet dans le cadre d’une conférence le 31 août 2009 au Festival des Brigittines, conférence dont le présent article est à la fois la transcription et le condensé.
L’inquiétante étrangeté
C’est en 1919 — il est alors âgé de soixante-trois ans et a encore vingt ans à vivre — que Sigmund Freud élabore ce concept dans un article célèbre publié autrefois en français dans un recueil que les éditions Gallimard intitulèrent ESSAIS DE PSYCHANALYSE APPLIQUÉE et qui depuis 1985, à la faveur d’une nouvelle traduction, a été significativement remanié sous le titre : L’INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ ET AUTRES ESSAIS. C’est dire combien entre temps l’article en question avait gagné en importance et en notoriété.
À sa parution en 1919, cela faisait une dizaine d’années déjà que Freud s’intéressait à l’art, à l’esthétique et à leur histoire au point d’y puiser des métaphores essentielles et de les intégrer au centre même de son dispositif conceptuel : le complexe d’Œdipe emprunté à Sophocle (1910), l’analyse du MOÏSE de Michel Ange (1914), Shakespeare avec LE MARCHAND DE VENISE et le « motif des trois coffrets » (1913), mais aussi avec MACBETH et le cas de « ceux qui échouent du fait du succès » (1916), Ibsen enfin avec ROSMERSHOLM et le personnage de Rebecca West traitésdans le même essai.
L’esthétique — en l’occurrence le théâtre et la littérature — prend d’ailleurs une telle importance dans la pensée créatrice de Freud que le mot est cité quatre fois dans la seule introduction de l’article, comme pour en asseoir l’origine et la teneur. Comment donc rendre compte en français, dans toute l’étendue de son champ sémantique, de ce bel adjectif unheimlich dont nous n’avons aucun équivalent dans notre langue ? Entre le privatif« un-» et le suffixe « ‑lich », « relatif à », le radical est composé de « heim », qui évoque la maison, le chez soi, le familier, qu’on retrouve dans l’anglais « home », le domicile, le lieu où l’on habite, et l’allemand « Heimat », la patrie, la terre des origines, le pays natal. On retrouve d’ailleurs ce suffixe dans les noms des localités allemandes ou alsaciennes (Mannheim, Rüsselheim, Schiltigheim …) comme dans ceux de certaines communes flamandes ou nordistes (Blaringhem, Verlinghem, Teteghem … ).
Freud, lui-même conscient des difficultés de traduc-tion dans les autres langues, suggère des équivalents. Il nous oriente vers le grec « xenos » qui connote l’hôte et l’étranger3, puis vers le latin « intempestis » qui évoque le contretemps ou « suspectus » qui, comme l’espagnol « sospechoso », viserait plutôt le regard et l’action de regarder de bas en haut. On notera que par ses conseils de traduction, Freud nous aiguille insensiblement vers les notions d’espace (le regard, le territoire … ) et de temps, ce qui renforce la proximité de la notion avec le théâtre, la danse, et plus particulièrement encore avec l’univers des Mossoux-Bonté et de tous les autres artistes avec lesquels ils sont en dialogue. Pour ce qui concerne le français, Freud conseille d’envisager l’adjectif « inquiétant », ce qui, on peut le constater, fut respecté et l’est encore. La traduction tiendra donc en une périphrase, l’inquié-tante étrangeté, qui d’une part contredit l’idée de repos ( « quies ») et pourrait se référer au concept d’intranquil-lité tel que le poète portugais Pessoa l’a aujourd’hui universalisé, ou encore s’étendre aux connotations de peur, de crainte, voire d’épouvante ou d’effroi ; et d’autre part s’apparenter aux dérivés du latin « extraneus », étrange et/ou étranger, qui vient d’ailleurs, qui n’est pas du pays, autre, hors coutume ou hors norme.
Autre mot suggéré par Freud lui-même : l’adjectif « insolite », du latin s’habituer ou être habitué (à), qu’on retrouve aussi dans « insolent » — littéralement, ce à quoi on n’est pas habitué, ce qui rompt l’habitude (voir Brecht et les surréalistes), ce qui perturbe, ce qui dérange, ce qui est différent et, partant, suscite la surprise, l’étonnement, le sentiment de la bizarrerie, de l’altérité.
Mais Freud, très embarrassé, sait bien qu’aucune langue autre que l’allemand ne pourrait rendre compte, dans sa très précise complexité, de l’ambivalence du mot « unheimlich » qui, précise-t-il, loin d’être univoque, « appartient à deux ensembles de représentation qui, sans être opposés, n’en sont pas moins fortement étrangers celui du familier, du confortable, et celui du caché, du dissimulé … Serait donc Unheimlich tout ce qui devrait rester un secret, dans l’ombre, et qui en est sorti …
L’Unheimlich n’est en réalité rien de nouveau ou d’étranger, mais quelque chose qui est pour la vie psychique familier de tout temps, et qui ne lui est devenu étranger que par le processus du refoulement » (L’INQUIÉTANTE ÉTRANGETÉ, NRF Gallimard, p. 221 – 222 et 246).
Le concept, on le sait, fut développé par Freud à partir d’un conte d’E.T.A. Hoffmann, L’.HOMME AU SABLE, dans lequel le fondateur de la psychanalyse retient essentiellement deux thématiques. En premier lieu celle de la vue — et du regard ! — et de sa privation — la cécité à travers d’abord le motif du« marchand de sable », de l’aveuglement, de la résistance puis du consentement de l’enfant au sommeil, au rêve enfin, voire au cauchemar, mais aussi, à travers la figure de l’opticien Coppelius-Coppola, fabricant de lunettes et de longues-vues, partant correcteur, voire transformateur du regard … Très vite Freud établit le lien avec Œdipe et son complexe : « C’est une angoisse infantile effroyable que celle d’endommager ou de perdre ses yeux… N’a-t-on pas d’ailleurs l’habitude de dire qu’on tient à quelque chose comme à la prunelle de ses yeux ? L’étude des rêves, des fantasmes et des mythes nous a ensuite appris que l’angoisse de perdre ses yeux, l’angoisse de devenir aveugle est bien souvent un substitut de l’angoisse de castration. Même l’auto-aveuglement du criminel mythique Œdipe n’est qu’une atténuation de la peine de castration qui eut été la seule adéquate selon la loi du talion » (ibid., p. 231).
En second lieu vient le trouble émotionnel et intellectuel provoqué par l’incertitude ou l’indécision identitaire du spectateur face à ce qui se révèle être un automate, en l’occurrence la poupée Olympia. S’appuyant sur un essai antérieur d’Ernst Jentsch consacré à LA PSYCHOLOGIE DE L’UNHEIMLICH (1906), mais dont on pourrait aussi bien rattacher l’origine à l’essai de Kleist tel que l’analysa très finement Bernard Dort4, Freud rapporte le pouvoir de la marionnette et son effet d’étrangeté au motif du double (ibid. p. 236 – 237), à l’angoisse de la mort et au double trouble qu’éprouve l’être humain tant devant l’objet animé que devant le vivant inanimé, comme si la marionnette, l’automate ou le robot en mouvement étaient comme l’envers ou le verso du cadavre, du corps comateux ou du corps assoupi.
De ce double trouble, deux spectacles au moins de Nicole Mossoux et Patrick Bonté sont fortement vecteurs. Dans KEFAR NAHUM, Nicole Mossoux dialogue avec les objets qu’elle anime au point de se fondre en eux ou de se confondre avec eux, objets hétéroclites autant qu’insolites que le mouvement impulsé par la manipulatrice — je devrais dire : la partenaire — métamorphose en automates zoomorphes, voire anthropomorphes, comme en écho à ce que quelques années plus tôt dans TWIN BOUSES elle développait à partir de cet ample costume commun, tout en drapés et plissés siamois, en compagnie de son masque jumeau, partenaire fictif et sosie saisissant dont le crédit de vie l’emportait même parfois sur le modèle.
Parmi les autres procédés d’inquiétante étrangeté inventoriés par Freud dans le conte d’Hoffmann, ajoutons encore la répétition ou le retour du même (ibid. p. 239 – 242) auxquels sacrifièrent diversement mais dans une commune recherche les grands fondateurs des années soixante-dix dont aujourd’hui encore l’héritage irrigue et inspire la scène contemporaine, surtout lorsqu’elle se situe aux confins de la danse et du théâtre : Tadeusz Kantor, Robert Wilson et Philip Glass, Pina Bausch … Et enfin le morcellement du corps, dont le critique soviétique Mikhaïl Bakhtine prolongera l’analyse un demi-siècle plus tard avec le chapitre consacré au « dépeçage du corps grotesque » dans l’étude qu’il proposa de l’œuvre de Rabelais5 : « Des membres séparés, une tête coupée, une main détachée du bras, des pieds qui dansent tout seuls, recèlent un extraordinaire potentiel d’inquiétante étran-geté, avance Freud, surtout lorsqu’il leur est accordé en plus une activité. Nous savons déjà que cette inquiétante étrangeté-là découle de la proximité du complexe de castration » (ibid., p. 250). De ce morcellement du corps, outre TWIN HOUSES déjà cité, témoignent au moins deux autres spectacles de la Compagnie Mossoux-Bonté, deux spectacles dont le titre évoque à la fois la peinture et
le portrait : LES DERNIÈRES HALLUCINATIONS DE LUCAS CRANACH L’ANCIEN (1990) et aussi SIMONETTA VESPUCCI (PORTRAIT, DÉTAILS ET PERSPECTIVES) (1998) qui, à travers un jeu notamment sur le cadre et la notion de cadrage, proposaient toutes sortes de décentrements insolites et intempestifs, substituant parfois au visage ou au buste solennels des portraits de la Renaissance une partie du corps inattendue, moins « noble » : pied, jambe, dos, bras, main …, suivant les rites étranges et inédits d’un dépeçage ou d’un morcellement ludiques.
Le merveilleux quotidien