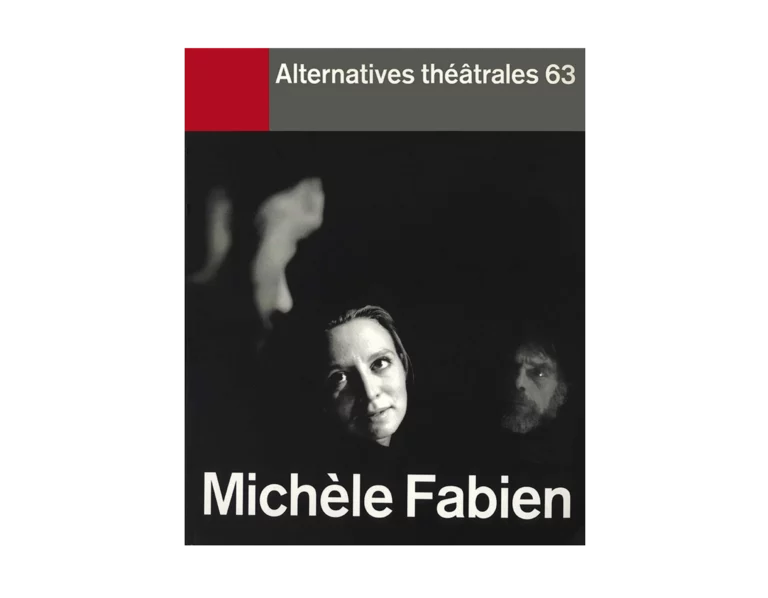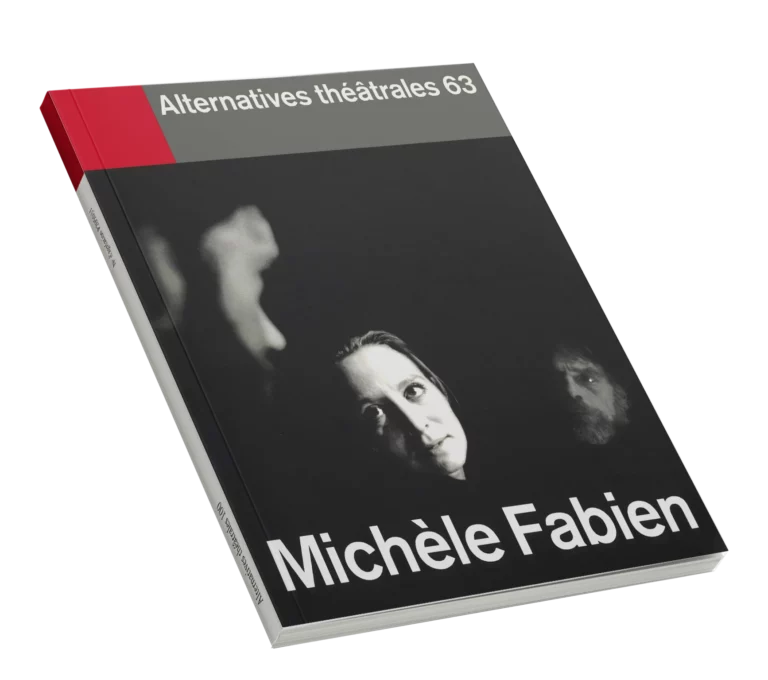TOUT AU LONG des vingt années d’existence d’Alternatives théâtrales, j’ai demandé régulièrement à Michèle Fabien de collaborer à notre publication. Elle répondit chaque fois à mes sollicitations ; cet été encore, elle accepta de rédiger son autoportrait pour le dossier consacré aux écritures contemporaines1. À relire tous ces textes aujourd’hui, on y retrouve son plaisir d’écrire, son exigence et sa confiance dans l’intelligence du lecteur et du spectateur.
C’est elle qui, en juillet 1979, ouvre le premier numéro de notre revue et, à propos de quatre spectacles dont elle rend compte, fait apparaître d’emblée le rôle qu’elle assigne à la mise en scène.
« La démarche dramaturgique qui, implicite ou explicite, sous-tend chaque spectacle, ne produit plus une écriture scénique didactico-totalisante qui tendrait à signaler au spectateur ce qu’il doit penser à propos des personnages, de leurs discours, de leurs comportements. Cela ne signifie pas pour autant que l’on soit dans le mou du non-savoir, du non-point de vue, de la non-prise de position. Au contraire, il semble que les écritures scéniques tissent d’autres fils, d’autres réseaux de signifance, dont les écarts par rapport au texte donnent des brèches par où peut s’installer le regard du spectateur et son travail, non pour savoir ce qu’il convient de penser de X sous peine d’être réactionnaire, non pour comprendre ce qu’a voulu dire Y, sous peine de passer pour un imbécile, mais pour investir lui-même sa propre fantasmatique, son propre désir, sa propre question, son propre plaisir de réflexion, d’imaginaire, voire, s’il en a envie, pourquoi pas ? de jugement. »2
Quinze ans plus tard, dans le numéro consacré au monologue, alors qu’elle est depuis devenue auteure de pièces, d’adaptations et de traductions, le théâtre est toujours pour elle une forme ouverte, interrogative mais où la prise de parole est en elle-même une intervention :
« Le théâtre est une chose contradictoire : la plupart du temps il se veut intervention — je ne parle évidemment pas du théâtre de divertissement, mais de l’autre théâtre, celui qui se veut art civique, un art de la cité et qui, interrogeant soit l’histoire, soit les mythes, se veut intervention, sinon dans la réalité, au moins au niveau de l’imaginaire.
Mais dans sa réalité, sur scène, sur le plateau, la représentation est aussi une manière de vouloir arrêter le temps. Là ou le cinéma le fige automatiquement, parce qu’il est moyen technique et que la pellicule n’est pas une personne, le théâtre, art vivant, se veut de soir en soir toujours pareil (l’intérêt étant, évidemment, qu’il ne le soit pas !): le but à atteindre est de reproduire l’identique, comme d’arrêter le temps. La vie, par contre, la vraie, fait qu’un acteur joue Hamlet d’abord, Lear ensuite, mais Hamlet, lui ne vieillit pas. (…)
Si le monde peut, dans le monologue comme dans le théâtre dit normal, se représenter, il n’est cependant pas là à se dévoiler devant nous, l’image passe par le truchement du rapport qu’entretient avec elle un homme qui parle, ou une femme ; subjectivité avouée et inévitable. Il n’y a pas d’image, pas de mimesis : imite-t-on la parole quand on parle ? Non. On parle. C’est devenu rare, aujourd’hui ; moi j’aime bien. »3
Ce qu’elle attendra des acteurs pour ses textes comme pour ceux des autres, c’est, par le jeu, de lui garder toute la force de ses contradictions, de ses répétitions, de ses questions. Comme elle le dira et l’écrira souvent (c’est d’ailleurs par la même courte phrase « Je m’appelle Jocaste » qu’elle ouvrira et fermera son premier texte de théâtre), il ne s’agit pas de voir sur scène « un personnage qui explique quelque chose » mais d’entendre « une parole qui constitue un personnage »4
Cette parole en forme de question renvoie aussi à notre époque en forme de point d’interrogation. Pour avoir vu à plusieurs reprises la mise en scène que Marc Liebens a réalisée à partir de son AMPHITRYON (la pièce est sous-titrée « d’après Kleist », mais il s’agit bien d’une pièce qui lui appartient en propre), j’ai été à chaque fois frappé par la force du silence ou des rires qui suivaient les deux premières répliques prononcées par Sosie. Elles enveloppaient le public touché d’emblée comme par une connivence d’impuissance bouleversante : « Et quoi faire ?et que dire ? ».
Jamais la frontière entre la scène et le monde, l’acteur et le spectateur ne m’a semblé si ténue. Ce sont de tels moments qui rendent le théâtre nécessaire.
Elle qui sut si bien par son écriture nous plonger dans l’univers de l’histoire et des grands mythes pour nous rappeler que nous en sommes aussi constitués, pouvait avec acuité rendre compte de la filiation invisible qui se trouve au cœur des grands textes de théâtre comme elle Le fit pour DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON de Koltès : « c’est à la fois une vraie rencontre, et une rencontre de théâtre au théâtre, qui vient après toutes celles que nous avons connues sur les planches et dans les Livres, et qui se sont passées sur les champs de bataille, dans les palais des rois, dans les salons bourgeois, sur des prés au petit matin, dans les bars à d’autres aubes, dans la jungle des villes, etc. Une rencontre qui les intègre toutes, les traite toutes et en raconte une autre, cependant, celle-là même de ces deux personnages, qui, malgré /dans la solitude des champs de coton, auraient lu tous les livres, sauraient tout de la tristesse de la chair, sauraient aussi l’inévitable violence de l’homme quand il est en présence de l’autre homme, tenteraient de ruser avec tout cela en réinventant ces rapports et en disant explicitement les stratégies du désir, donc aussi de la haine, douces-amères parfois, meurtrières le plus souvent.
C’est encore un texte de la parole, ça parle, ça ne craint pas de parler, ça a besoin de parler. (…) Ça sait l’ambivalence du désir et de la demande, l’incertaine frontière de l’identité de l’être quand il est face à un autre être et qu’il craint d’être constitué par lui, le trouble de l’offre, la perversité de la demande qui se refuse. (…) Comme dit Le dealer : « Deux hommes qui se croisent n’ont pas d’autre choix que de se frapper avec la violence de l’ennemi ou la douceur de la fraternité. » Alors ils le disent, sans doute, pour éviter de le faire. »5
Dans sa très belle LETTRE AUX ACTEURS6 Michèle Fabien a révélé, ce que nous savions déjà, son admiration et sa reconnaissance pour les acteurs et les actrices. C’est grâce à eux que son théâtre vivra : « c’est sur le bonheur que je voudrais terminer : lorsque l’auteur, qui, comme je l’ai dit — écrit pour l’Autre, devient Autre à lui-même — ou à cette partie de lui-même qu’est le texte qu’il a écrit —, et qu’il découvre dans sa pièce des résonances inconnues, des significations qu’il ignorait. Ainsi dans DÉJANIRE, où je croyais avoir écrit l’impasse totale, dont je pensais que c’était une pièce d’un pessimisme absolu, où le désir, pourtant généreux, se heurtait à un réel opaque, à un impossible rédhibitoire, à une mort totalement inutile, ce qui me désolait un peu, j’ai pu découvrir, grâce au plateau, donc grâce au jeu, au théâtre, qu’il y avait espoir et transmission, que croyant prendre lole par nécessité, Déjanire se donnait à elle, au contraire, et lui rendait en fait, en lui enjoignant de la sculpter dans sa détresse et dans sa douleur, une forme de vie, à laquelle ni l’une ni l’autre de ces deux femmes ne croyaient plus.
Ces moments sont de grands moments mais. il ne peuvent se répéter !»7
Ce ne fut pas difficile de convaincre les amis de Michèle d’écrire dans une certaine urgence : ils ont accepté sans hésiter de parler de l’œuvre qu’elle nous laisse, empreinte comme elle d’une violente beauté.
- Alternatives théâtrales, n° 61, ÉCRIRE LE THÉÂTRE AUJOURD’HUI, juillet 1999, p. 22 et 23. ↩︎
- Alternatives théâtrales, n° 1, ASPECTS DU THÉÂTRE CONTEMPORAIN EN EUROPE, juillet 1979, p.11. ↩︎
- Alternatives théâtrales, n° 45, LE MONOLOGUE, décembre 1994, p.48. ↩︎
- Alternatives théâtrales, n° 2, octobre 1979, p. 51. ↩︎
- Alternatives théâtrales, n° 31 – 32, UNE SCÈNE À FAIRE, mai 1988, p. 29. ↩︎
- Alternatives théâtrales, n° 47, LETTRE AUX ACTEURS, juillet 1994, p. 11 à 13. ↩︎
- Alternatives théâtrales, n° 52 – 53-54, LES RÉPÉTITIONS, janvier 1997, p. 143. ↩︎