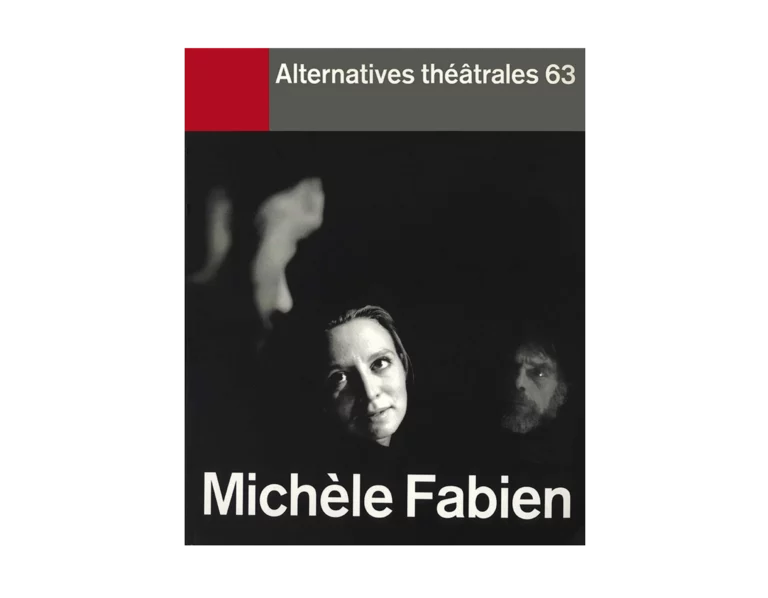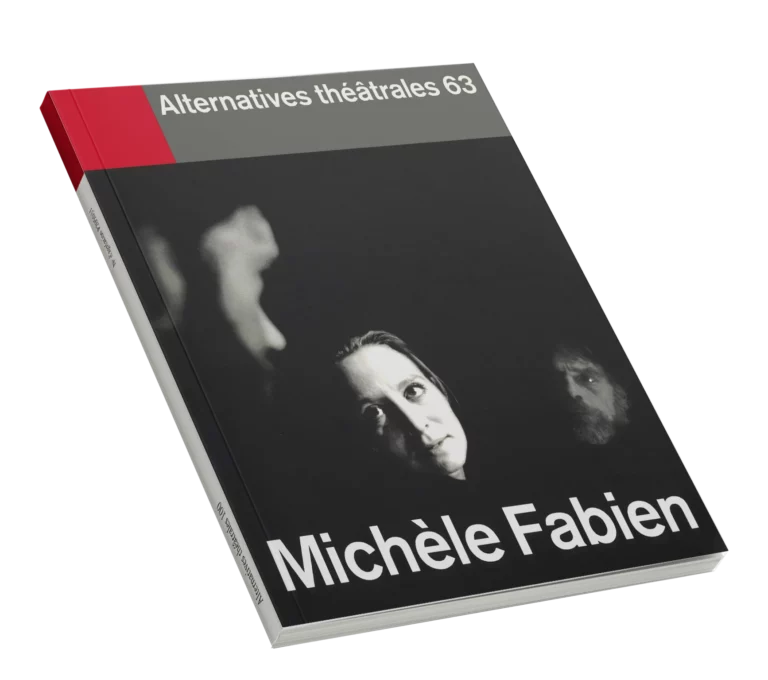CHER MARC,
Il faut bien commencer, n’est-ce pas ? Alors je te propose celle-ci qu’on pourrait appeler « la photo de l’appareil d’Atget dans le décor de la rue de la Roquette ». Elle a entre autres atouts, l’avantage de respecter la chronologie puisque c’est ce spectacle-là qui inaugure ta collaboration avec l’Ensemble Théâtral Mobile.
obile. Et pourtant ce n’est pas une photo de spectacle. Mais il faudra s’y faire ; je crois pouvoir le dire maintenant et une fois pour toutes : selon moi tu ne fais pas de photos de spectacles, jamais. Je veux dire que ce qui s’imprime sur tes photos ne correspond jamais à quelque chose (image, action ou point de vue) que le spectateur aurait pu voir (ou avoir). Autrement dit, si le spectateur a pu, pendant le spectacle, voir l’appareil d’Atget qui se trouve sur la photo, s’il a pu voir également l’espèce de petit autel garni de photos qui se trouve au fond, jamais il n’a vu ses accessoires comme ça. L’appareil, en tout cas, ne s’est jamais trouvé seul sur son pied, au milieu de l’aire de jeu, comme s’il était un personnage. Il a quelque chose d’un personnage, je trouve, cet appareil photo, personnage inquiétant d’ailleurs, avec des jambes de bois, un masque à gaz et un domino noir. Un personnage déguisé. Ce n’est donc pas une photo du spectacle.
C’est cependant une photo de la pièce. Cette rencontre d’Atget et Berenice, je l’ai conçue comme la rencontre de deux personnages qui sont d’abord des photographes avant d’être des personnes. Ces personnages en fait ne m’ont intéressée que parce qu’ils étaient photographes ; comme Berenice Abbott qui cherche à rencontre Atget parce que ses photos la fascinent. Et la pièce raconte un peu cela, les deux personnes sont moins intéressantes que leur art. Donc montrer quelque chose d’Atget en montrant non son image ou celle de son visage, mais celui de son appareil déguisé en personnage, correspond à une des lames de fond qui traverse la pièce et dans laquelle le moteur de la fable est, effectivement, la photographie.
Mais cette image est-elle vraiment, est-elle seulement le portrait d’un appareil ? Ce qui me frappe, dans cette photo, c’est sa lumière. Regarde, il y a trois taches de lumière : la première, la plus vive, au fond, est faite d’une ampoule qui n’éclaire rien qu’elle même, et encore. s’éclaire-t-elle ? Il me semble plutôt que ce qu’elle éclabousse, c’est le mur du fond sur lequel il n’y a « rien à voir », tandis qu’à côté, sur l’espèce d’autel — qui pourrait figurer une cheminée dans un intérieur réaliste —, il y a des objets qui eux, paradoxalement, restent dans l’ombre. La deuxième, un peu moins vive, mais plus étendue semble une lumière tutélaire qui protégerait l’ombre projetée de l’arrière de l’appareil qui se profile sur le mur sans toutefois l’éclairer vraiment : une partie de cette ombre dans. l’ombre du mur, est aussi visible que celle qui se trouve dans la lumière ; cette dernière n’est donc pas là pour éclairer quoique ce soit ; à la limite, c’est peut-être la présence de l’ombre qui nous fait voir cette lumière. Enfin plus discrète, par terre, à l’avant plan, aux pieds de l’appareil, une troisième tache lumineuse s’inscrit entre l’appareil lui-même et une tache sombre qui pourrait (qui doit) être l’ombre portée du photographe, celui de la réalité, toi, Marc Trivier, qui a fait la photo. Encore une fois, si la lumière n’éclaire pas l’appareil, peut-on hasarder que c’est celui-ci qui nous la désigne, la lumière, par contraste ? Et que cette image d’appareil en cache en fait une autre. de lumière ? Dans la pièce, Atget dit, à un moment donné : « C’est la lumière qui fait la photo, toujours. » C’est peut-être une formule un peu rapide, mais moi, j’aurais envie de dire que toi, ici, tu nous as fait le portrait de cet autre photographe-là non humain qu’est aussi la lumière. Comme quoi un accessoire de théâtre peut être aussi un accessoire de la photo !
Mais si tu me dis que cet accessoire, l’appareil d’Atget, traînait là comme cela, un jour après une répétition et que c’est parce qu’il était là, comme cela, tout simplement, que tu l’as immortalisé, je dirai parce qu’il était là, parce que c’était toi.
Amicalement, Michèle Fabien. Septembre 1998.
Première des lettres de la correspondance entre Michèle Fabien et Marc Trivier. Ils avaient le projet de publier un ouvrage reprenant les photos que Marc Trivier avait faites des spectacles écrits ou adaptés par Michèle Fabien.