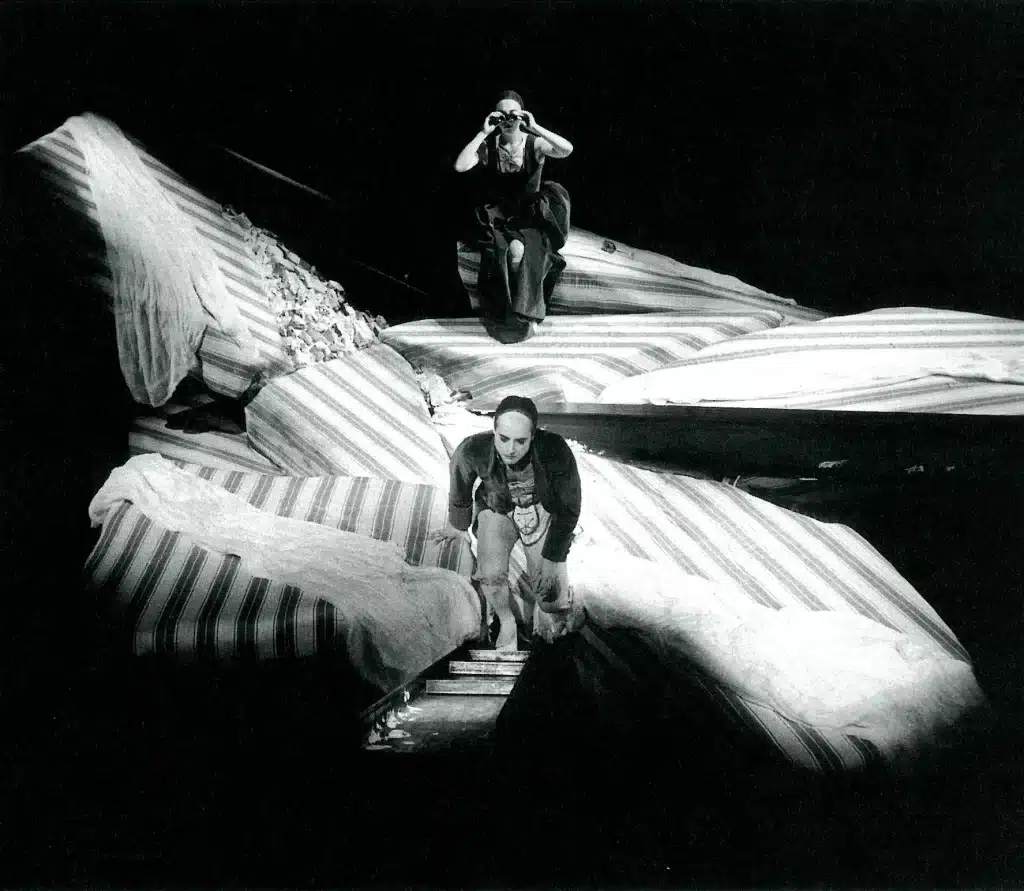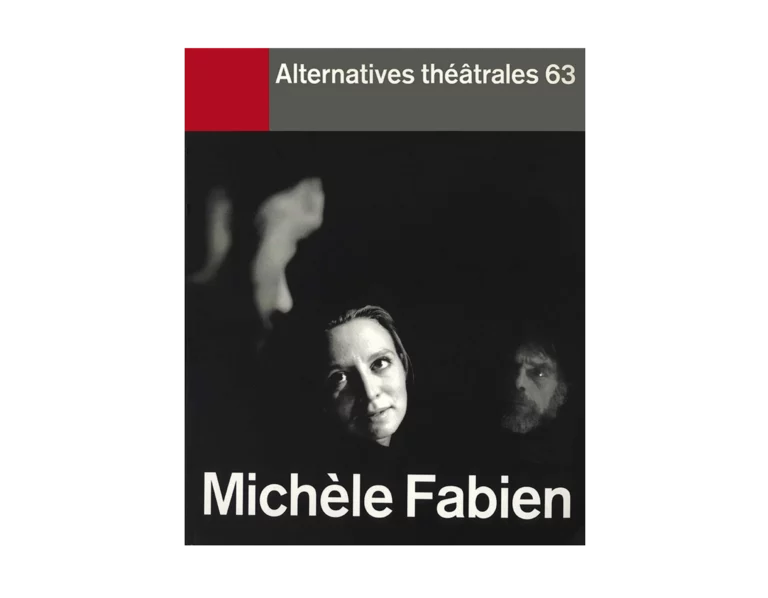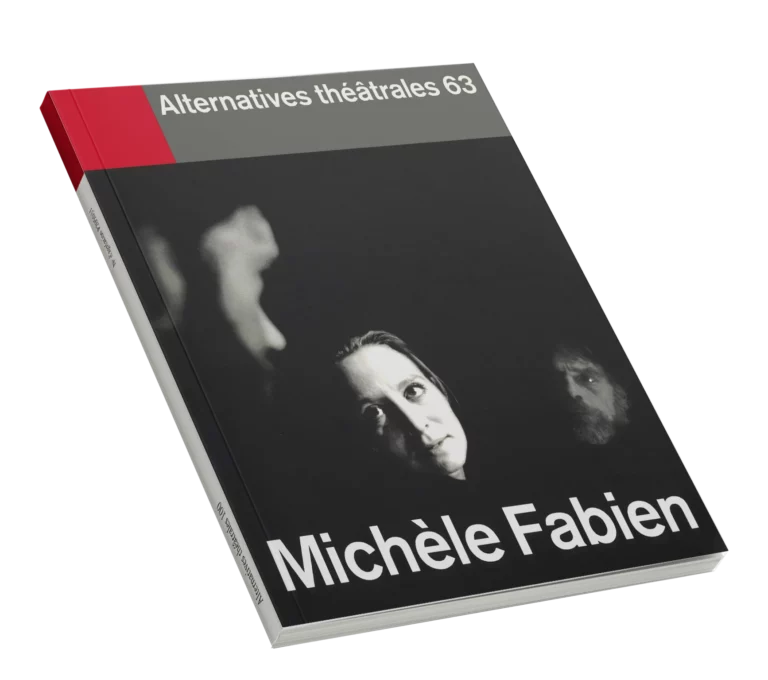TITINA MASELLI : J’ai rencontré Michèle Fabien lorsque Marc Liebens mettait en scène QUARTETT d’Heiner Müller : il m’avait demandé d’en faire la scénographie.
Dès la première fois que j’ai vu Michèle, elle m’a semblé pleine d’intelligence, mais pas seulement ; pleine de choses à dire aussi. Mais je n’ai saisi la complexité du personnage qu’en la revoyant ensuite à Bruxelles, dans son environnement familier. Et puis, à nouveau à Bruxelles, j’ai eu l’occasion de voir une mise en scène de JOCASTE. J’ai beaucoup admiré la pièce.
Elle m’a proposé un jour de revoir sa traduction d’AFFABULAZIONE de Pier Paolo Pasolini. Nous avons ensuite travaillé sur PYLADE. Il s’agissait de rendre en français l’insistance du style de Pasolini. La traduction que Michèle avait faite était parfaite au niveau du sens, mais on ne percevait pas le ton obstiné qui est propre à Pasolini. Il dit la phrase avec une certaine obstination qui est difficile à percevoir pour un lecteur de langue française. C’est là dessus que nous avons travaillé à Bruxelles, puis à Rome. Je garde un excellent souvenir de nos séances de travail. J’avais affaire à une femme qui comprenait aussitôt ce que je voulais dire et acceptait simplement les modifications. Michèle me lisait sa traduction morceau par morceau et moi, je relisais l’original et je proposais des modifications ; nous avancions ainsi. Elle me lisait : « Je veux…» et je la reprenais : « Moi, je veux…» La langue de Pasolini travaille sur la répétition et sur le déplacement de groupes de mots : un complément d’objet vient se placer en tête de phrase quand il est d’habitude à la fin, par exemple. Je me suis rendue compte à quel point le français et l’italien fonctionnaient différemment. Il fallait absolument que je les distancie. Le français est moins incisif que l’italien, lui plus impulsif.
Dans ce travail on ne retrouvait rien de ce qu’était l’homme Pasolini : il avait une voix fluette et discursive quand son écriture grondait comme un volcan. Je n’avais donc pas du tout dans l’oreille la personne Pasolini que j’avais connue à Rome dans les années 1960.
Pasolini était un homme de lettres, raffiné, il a commencé à écrire en dialecte, comme un philologue le ferait, non pas pour satisfaire un penchant au pittoresque. Il n’avait rien du scepticisme, de l’ironie, de la suffisance désabusée des gens de lettres. Il écrivait pour dire les choses. On pourrait presque parler de naïveté à son égard en opposition avec l’attitude blasée qu’affectaient la plupart des gens de lettres à cette époque. Quand Pasolini surgit, au début des années 1960, la grande vogue des thèmes sociaux était déjà révolue. Tout ce qui avait été l’aspiration néoréaliste engagée était épuisée. Le questionnement social alors était abordé avec distance. Or Pasolini, avec une grande naïveté, pleine d’obstination et de force, a réimposé un regard franc et direct, vierge, sur ces thèmes. Sans emphase, avec l’efficacité des choses primitives.
Je voyais quelle attention Michèle portait à ce que j’essayais de souligner de la façon dont écrivait Pasolini. Elle l’entendait comme un écrivain. Je ne faisais qu’essayer de traduire comme un lecteur le ferait la violence et la force du discours, et elle le recevait en écrivain : avec une curiosité avide d’enseignement.
Propos recueillis par Julie Birmant.