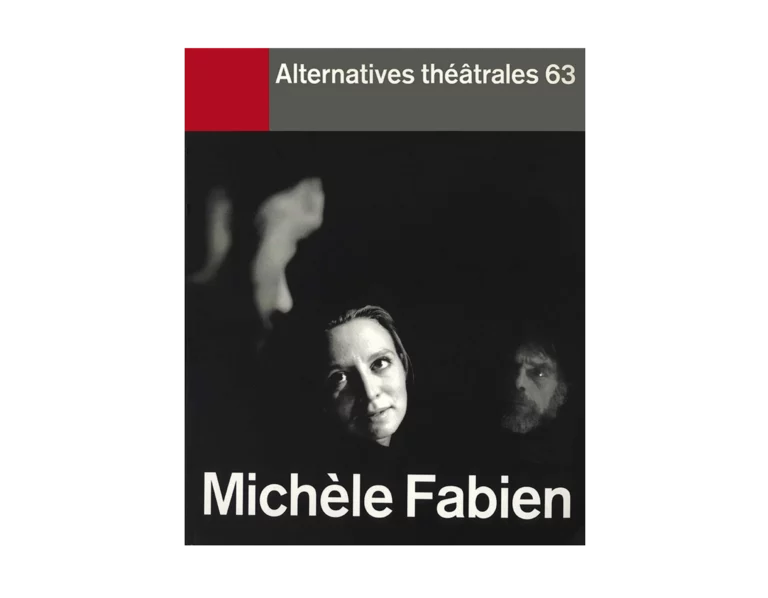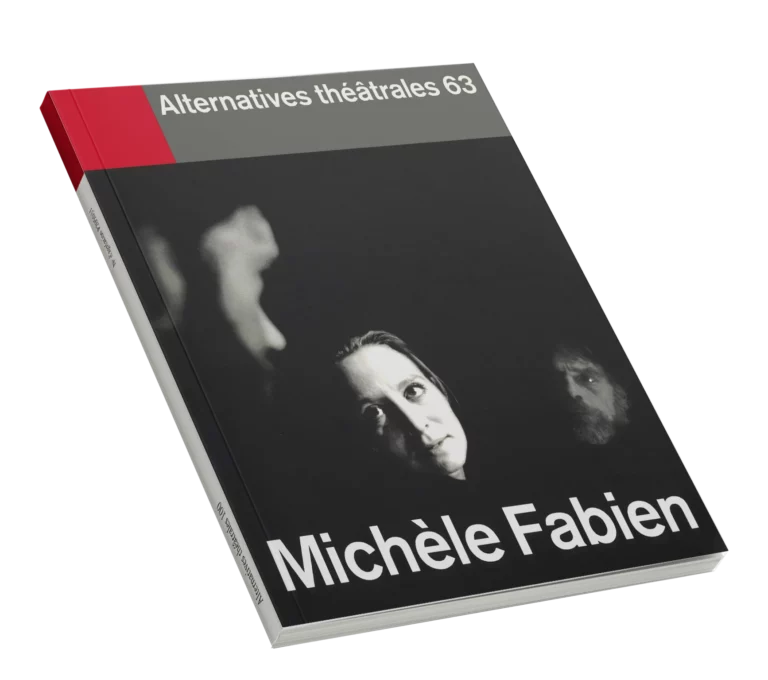STREHLER nous manque. De son théâtre qui, périodiquement, venait exalter la scène de l’‘Odéon, Paris en éprouve la nostalgie. Strehler n’a pas été un visiteur de plus car, entre la ville et l’artiste, une séduction réciproque opérait.
Dans cet automne des deuils où nul spectacle strehlérien, nous en sommes certains, ne viendra plus nous réconforter, j’ai éprouvé l’envie de revisiter la relation passionnelle et contradictoire, comme toute vraie aventure amoureuse, qui a lié le maître du Piccolo à Paris. Substitut d’une célébration privée de la mort survenue avec violence, un soir de Noël pendant qu’il répétait Mozart.
À l’Opéra Bastille, de temps en temps, ressuscitent, comme une copie fantomatique, ses NOCES DE FIGARO. Pâle écho du chef-d’œuvre qui nous éblouissait il y a vingt ans, Les NOCES de Strehler qui furent, comme disait Vitez, « le plus bel opéra du monde », ont réveillé Le palais Garnier. Aujourd’hui elles résonnent encore. mais le théâtre, lui, il s’est tu à jamais. Il y a deux ans seulement des spectateurs en grappe sur des marches et projecteurs ovationnaient un ARLEQUIN depuis orphelin.
Une « machine à gloire »
Paris, pour paraphraser le beau titre d’une nouvelle de Théophile Gautier, a été une cruelle et exaltante « machine à gloire ». Ici, la réception devient événement et prend le sens d’une reconnaissance qui dépasse le simple succès : elle engendre un effet de retour dans Le pays d’origine. Les applaudissements de la « machine à gloire » parisienne résonnent très fort et leur écho qui se fait entendre au-delà de la France et parvient jusqu’à la ville de départ peut modifier un destin. Paolo Grassi l’avait compris parmi les premiers et lorsque Giorgio Strehler met en scène CORIOLAN, à la fin des années 30, il convie à Milan le jeune critique qui s’impose alors, Bernard Dort. Celui-ci disposait d’une tribune et sa position à l’égard du théâtre s’apparentait à celle du Piccolo. L’analyse du stratège Grassi a été correcte : il ne s’est pas trompé d’invité. Il faut rendre hommage à sa pertinence aussi … car le texte écrit tout de suite par Dort dans la revue THÉÂTRE POPULAIRE, en faisant découvrir avec enthousiasme le Piccolo et Strehler, révélait à la France un futur et durable pôle d’attraction. Dort, sous l’impact du choc subi, enclencha « la machine à gloire » et scella les flançailles heureuses du Piccolo avec Paris. Plus tard, les tournées confirmèrent l’intuition première, mais le mariage célébré officiellement au début des années 80 fut moins heureux. Peut-être que les fiancés étaient un peu las de leur liaison qui remontait déjà à plusieurs décennies …
L’intellectuel français, surtout parisien, adore l’évaluation d’un artiste étranger d’exception afin d’élaborer un discours critique et de se poser en conscience intellectuelle de l’œuvre qu’il découvre. À ce titre, exemplaire reste la forte activité critique développée par Barthes ou Dort après la tournée de Brecht à Paris en 1954 ; celle-ci fonda leur démarche d’alors qui, par un effet de « billard », eut des retombées favorables sur le statut de Brecht à Berlin. Sa reconnaissance parisienne, Beno Besson l’affirme, a fortement infléchi les réserves du pouvoir officiel de la République Démocratique Allemande où Strehler se rendra pour rencontrer Brecht. Ainsi d’ailleurs furent posées les bases de ce beau triangle de la mise en scène qui se dessina à partir des années 50 entre Berlin, Milan et Paris.
Aujourd’hui, nous pouvons le rappeler et surtout l’admettre : si la passion barthésienne pour Brecht fut de courte durée, tandis que celle de Dort se prolongea bien au-delà du milieu des années 50, cela sera dû au travail de Strehler sur GALILÉE surtout. Ce malentendu mérite d’être levé : ce n’est pas le Brecht du Berliner qui a entretenu l’engagement du critique français, mais l’autre, le Brecht dans la version du Piccolo. Étant donné la portée d’alors des textes de Dort nous pouvons reconnaître ainsi l’influence indirecte de Strehler sur la scène française.
Un autre exemple qui conforte cette observation selon laquelle le théâtre strehlérien produit, en France, de la pensée théâtrale ou philosophique, c’est Louis Althusser qui le fournit car, à partir d’EL NOST MILAN, il a écrit son célèbre essai sur le théâtre matérialiste introduit dans son texte fondamental, POUR MARX. Le théâtre strehlérien nourrit l’activité théorique de la vie théâtrale parisienne où, à l’époque, le commentaire intervenait plus qu’ailleurs dans les destins de la scène et ses artistes.
Mais, a contrario, Strehler lui-même admet l’influence directe qu’il a subie de la part des maîtres du théâtre français ayant contribué à sa formation. Dans la conférence du Vieux Colombier du 28 novembre 1997 sur le Théâtre d’Art, conférence qui avait pris un ton testamentaire douloureusement confirmé un mois plus tard, il évoquait de nouveau, comme il l’avait déjà fait souvent, Copeau et Jouvet. Le premier lui est apparu comme figure de l’intransigeance artistique, l’autre comme un captif du théâtre : deux modèles de rapport au théâtre que le maître de Milan a mis sous leur signe. Brecht viendra se joindre à cette double influence permettant ainsi à Strehler de se situer au croisement de Paris et Berlin, d’en être même le principal médiateur. De même que Jouvet ou Copeau, il s’est consacré, d’abord, aux pouvoirs de la scène pour être habité ensuite par le modèle de l’engagement brechtien. Cela explique sans doute l’attrait qu’il exerça sur des gens de théâtre français, sur Patrice Chéreau en particulier. N’est-ce pas, lui, l’artiste réservé, qui envoya à la mort de Strehler le message le plus clair, message qui érigeait le maître italien en premier metteur en scène européen de la moitié du siècle qui s’achève. Dans ce qui aurait pu n’être que discours de circonstance, nous pouvions déceler un aveu qui confirmait l’impact jamais démenti de Strehler sut Chéreau lui-même.
De l’alliance entre Paris et Milan, par la médiation du Piccolo, deux autres exemples, moins souvent évoqués, attestent la fécondation réciproque. La pensée sur l’institution théâtrale de Strehler et Grassi porte, à leurs débuts, l’empreinte de Jean Vilar qui passera ensuite dans une position secondaire sous l’effet de la découverte de Brecht (d’ailleurs nous retrouvons la même évolution dans le parcours de la revue THÉÂTRE POPULAIRE qui soutient le Piccolo et que ses deux animateurs lisent attentivement). Si la trace vilarienne reste visible, identifiable, dans le programme du Piccolo, celui-ci, à l’écart de tout épigonisme mimétique, s’emploiera à la remodeler pour la faire sienne. Il va proposer la variante italienne du « théâtre, service public » de Jean Vilar.
Le second exemple concerne la relation, moins visible cette fois-ci, de Jacques Lecoq avec le Piccolo. S’il a découvert le travail sur le masque grâce à la rencontre avec les maîtres italiens, à son tour Lecoq est souvent revenu à Milan en entretenant un dialogue ouvert qui a marqué souterrainement le paysage théâtral français et international. Ce grand pédagogue a exercé au niveau de la formation l’effet que ce chef-d’œuvre, périodiquement revisité par Strehler, que fut l’ARLEQUIN, produisit sur la scène. La gloire publique du spectacle et le sillon secret creusé par l’enseignement ont contribué ensemble à la réhabilitation du masque aussi bien que de la mythologie de la commedia dell’arte comme exaltation d’une théâtralité libérée des oripeaux du réalisme stylisé. Strehler a restitué au théâtre un de ses premiers outils que la scène française, aussi bien qu’européenne, avait partiellement oublié.
Circulation à double sens