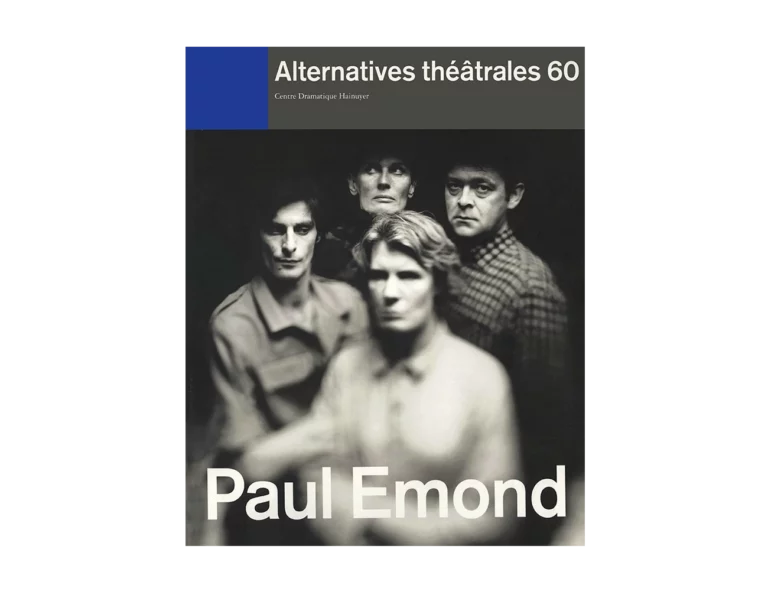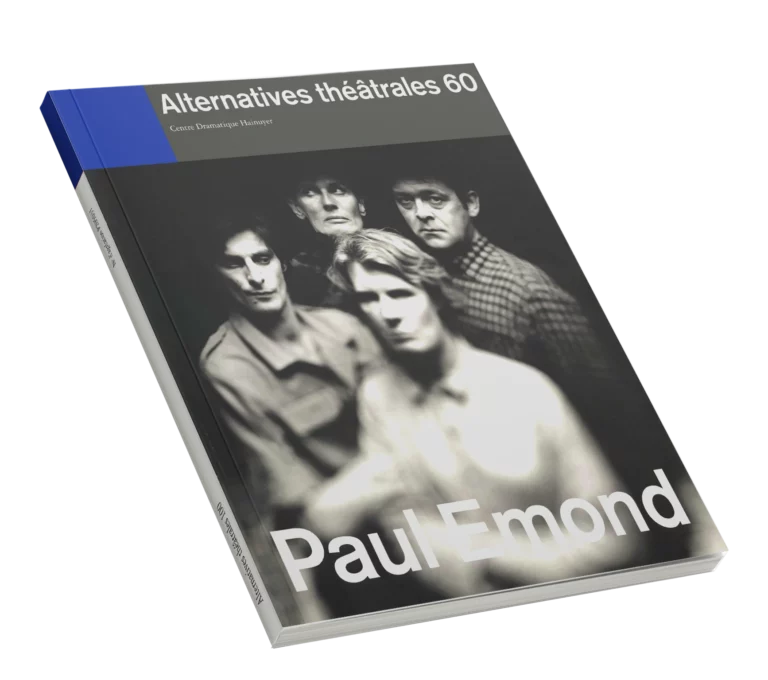DANS le cadre de la Chaire de Poétique créée à l’Université catholique de Louvain par Michel Otten, Paul Emond a récemment été convié à s’interroger sur la genèse de son œuvre, au cours de quatre conférences, aujourd’hui regroupées dans un petit livre intitulé UNE FORME DU BONHEUR. Ce livre s’ouvre sur l’évocation d’une expérience d’enfance jugée capitale, une véritable révélation : la découverte de L’ÎLE MYSTÉRIEUSE. Of, pour mesurer l’influence profonde de ce roman sur sa propre création, Paul Emond imagine un « roman très pirandellien » où les personnages vont rendre visite à leur créateur et il montre que L’ÎLE MYSTÉRIEUSE en est la « parfaite allégorie. Car, entre le capitaine Nemo et les cinq Robinson, le rapport est somme toute le même que celui qui existe entre les personnages d’un récit et l’auteur ou le narrateur qui, dans l’ombre lui aussi, conduit leur destinée, guide leurs pas à travers les pages de la fiction (p. 19).» C’est une image du créateur qui s’imprime dans l’imaginaire du petit Paul : comme Nemo (« à peu de choses près, l’anagramme phonétique de mon propre nom.…..», constate-t-il) veille sur les habitants de l’île, Emon(d) guidera, bien plus tard, ses personnages dans « l’île de la fiction ». L’allégorie vaut, notons-le, pour le narrateur romanesque, mais, mieux encore peut-être, pour le dramaturge, qui, comme Nemo, est personne (il se retire fallacieusement, parle sous le nom d’un autre, dit Platon, qui condamne pour cette raison les genres mimétiques) et tire d’autant mieux les ficelles.
D’entrée de jeu donc, Paul Emond se choisit deux pères spirituels et littéraires : le romancier Jules Verne, le dramaturge Pirandello. (Deux pères parmi bien d’autres : Cervantes, Kafka, Kundera, Willems, etc. — sans compter plusieurs géniteurs : le propriétaire d’un magasin d’articles de cuir de crocodile, l’opticien, le ramoneur, le coiffeur et j’en oublie peut-être.) Ce qu’il affectionne tout particulièrement chez Pirandello, comme chez Cervantes, Borges, Calvino, comme dans les MILLE ET UNE NUITS et le MANUSCRIT TROUVÉ À SARAGOSSE, c’est une expérience esthétique « fascinante » : la « transgression des niveaux de réalité », quels qu’ils soient. Il s’agit de mettre en cause « tous les aspects que peut prendre le paradigme fondamental sur lequel repose le réalisme » — à savoir la « stricte séparation entre le réel et le rêve », « entre l’actuel et le virtuel », entre « le monde qui nous entoure, le monde des vivants, et un hypothétique monde de l’au-delà », « entre l’ordre du vrai et l’ordre du faux » — et de rendre les frontières habituellement reconnues « problématiques » ; on peut alors « toujours faire et refaire la formidable expérience de la liberté. »
Cette conception d’une littérature « libre », « ouverte sur tous les possibles », traverse comme un leitmotiv tous les textes où Paul Emond réfléchit sur sa propre pratique. À preuve ce texte plus ancien1 quasi contemporain de sa première expérience théâtrale, où il évoque longuement une dramatique qu’il a écrite pour la radio, GRAND FROID, considérant qu’elle est « l’émission parfaite d’un noyau thématique originaire », « exactement un œuf comme je les fais ». Or, que nous raconte ce texte ? Une pièce, « une de ces pièces étranges où les acteurs se mêlent au public de façon si intime que chaque spectateur finit par croire qu’il fait partie de la distribution » : pour finir, un spectateur mal luné est emmené sur la scène et sommé de passer une épreuve ; il échoue et est abattu froidement — la question étant alors de savoir si l’homme en question était un excellent acteur ou un véritable spectateur, un faux acteur dans ce cas ! Sans doute touchons-nous là au « noyau originaire » que l’écrivain entend saisir dans ce texte en vue d’éclairer son propre travail : la transgression des frontières (scène-salle, en l’occurrence) est opérée de façon définitive, sans retour possible, si bien que le spectateur demeure dans l’incertitude complète et en vient à jeter le soupçon sur ses propres repères imaginaires.
Ce noyau originaire détermine manifestement LES PUPILLES DU TIGRE, la première pièce (pirandellienne à souhait) du dramaturge. Moins apparent par la suite, il a fait son retour en force dans ses derniers textes : CAPRICES D’IMAGES se déroule, c’est l’évidence même, au seuil du rêve et de la réalité quotidienne, sans compter ce mystérieux enfer final ; À L’OMBRE DU VENT n’est peutêtre qu’un épisode de la chanson d’Yvette ; la première scène du ROYAL situe toute l’action entre le monde des vivants et celui des spectres. Mais ce noyau configure plus généralement l’ensemble du théâtre de Paul Emond, et il donne toute sa signification à l’une de ses caractéristiques les plus manifestes, à savoir la place accordée aux récits. Telle est l’hypothèse que je voudrais développer ici.
« Il faudrait couper, c’est trop bavard : telle est la critique que l’on me jette parfois », rapporte Paul Emond dans UNE FORME DU BONHEUR, avant de rétorquer : « Mais permettez ! Pas du tout ! Absolument pas ! C’est, au contraire, ce bavardage, cette insistance à en mettre et à en remettre encore et jusqu’au malaise, qui constitue l’essence même de certains de mes personnages. Non, il ne faut pas couper. Non, ce n’est pas trop bavard. Laissez-les se raconter, bon Dieu ! Un peu de pitié pour eux, que diable ! » Comment comprendre cette complaisance du dramaturge à se laisser envahir par cette parole caracolante et irrépressible ? Faiblesse d’une âme trop charitable (« un peu de pitié, que diable ! »)? Sentiment d’une nécessité absolue (« causer, ça maintient en vie », disait déjà la fumiste) ? Ou faut-il y voir, comme on le dit souvent, une forme de détour, de divertissement (au sens pascalien), dont la seule fonction serait de mettre en relief le surgissement brutal d’une vérité douloureuse : raconter des histoires serait une façon pour les personnages de masquer l’inavouable, de se parer de paroles pour résister au réel, celui-ci finissant toujours par resurgir, en brisant brusquement le mur des apparences ?
Il y a plus, je crois. Tel qu’il est utilisé par Paul Emond dans son théâtre, Le récit peut être considéré comme un procédé privilégié pour la réalisation de son programme pirandellien, parce qu’il est fondamentalement anti-réaliste : il libère le dramaturge des contraintes qui sont celles de la scène réaliste ou naturaliste. On peut constater en effet que, de façon systématique, le soupçon est peu à peu jeté sur l’origine du récit, la réalité racontée devenant indiscernable de la part fictionnelle inhérente à sa représentation. C’est particulièrement net lorsque les pièces s’énoncent entièrement sur le mode narratif. Dans TÊTE-À-TÊTE, tout le récit est comme suspendu au moment où Lucienne laisse entendre qu’elle a déjà fait le coup à d’autres, qu’elle n’est donc peut-être pas la femme de celui qui devient alors un pauvre amnésique sans histoire. Dans À L’OMBRE DU VENT, pièce qui semble entièrement racontée par Yvette et jouée simultanément par les personnages concernés par son récit, la réplique inaugurale, très curieuse, rend tremblant l’ensemble de la pièce :
« Yvette : Depuis que j’étais toute petite, j’adorais chanter. Je fermais les yeux, j’oubliais mes jambes mortes. C’est si beau, le chant, ça donne des ailes. Un jour, une voix me dirait : « Lève-toi et vole. » Et j’imaginais que je me lèverais et que je volerais. J’imaginais aussi La tête de Christiane.
Christiane : Mais Yvette, tu voles ! »
Tout ce qui suit n’est-il rien d’autre qu’une envolée fantasmatique, une fiction réalisée par le jeu ? Ce qui me surprend, c’est le début de la phrase, qui semble osciller entre deux possibilités grammaticales : « Depuis que je suis toute petite, j’adore chanter » (et j’adore encore) et « Quand j’étais toute petite, j’adorais chanter » (et je n’aime plus). « Depuis que j’étais toute petite » implique une rupture dans le cours du temps ou introduit de la fiction, en instaurant une distance entre la narratrice Yvette et son personnage (exactement comme dans les jeux des enfants : « moi, j’étais le crocodile et toi le…» ): Yvette est-elle morte à présent ou s’est-elle envolée à l’appel de cette voix mystérieuse dans le ciel de la fiction ? Même dans MOI, JEAN-JOSEPH CHARLIER DIT JAMBE DE BOIS, HÉROS DE LA RÉVOLUTION BELGE, pièce pourtant fondée sur un référent stable et vérifiable, la représentation parlée semble dicter sa propre loi à la vérité historique, comme en témoigne ce leitmotiv qui émaille le récit de Charlier : « Je le dis, donc je Le pense ».
La même caractéristique s’observe dans les autres pièces, dès lors qu’elles sont constituées de récits multiples racontés par les différents personnages. Dans UNE FORME DU BONHEUR, Paul Emond place son théâtre sous le signe de cette observation de Kundera : « toute la vie de l’homme parmi ses semblables n’est autre chose qu’un combat pour s’emparer de l’oreille d’autrui. » C’est le côté tchekhovien de ce théâtre (si l’on se réfère du moins à une certaine lecture de Tchekhov), qui relève souvent — Paul Emond l’affirme lui-même — du « pseudo-dialogue », de l’«addition de monologues ». Or, que le récit soit celui d’un narrateur unique ou qu’il se divise entre des personnages différents, toujours la structure du témoignage est progressivement reconnue et même soulignée, par quoi la réalité racontée se voit irréductiblement marquée au sceau de la fiction. Dans MÉMOIRES D’AVEUGLE, Jacques Derrida écrit : « un témoin, en tant que tel, est toujours aveugle. Le témoignage substitue le récit à la perception. Il ne peut voir, montrer et parler en même temps, et l’intérêt de l’attestation, comme du testament, tient à cette dissociation2. Parce que les personnages d’Emond ne jouent pas leur propre fable au présent mais la racontent, parce qu’ils ne sont jamais que les témoins (fiables ou non ? c’est toute la question, laquelle n’admet pas de réponse définitive) de leur propre drame, parce que, surtout, le récit tend à s’enfler infiniment, multipliant les digressions et parfois même les contradictions, la frontière entre la réalité (inventée ou non, peu importe) et la fiction, entre la vie même et sa représentation, entre l’ordre des faits et celui des fantasmes, s’avère toujours incertaine. Qui détient la vérité ? Ne vous avisez pas de la réclamer auprès de Némo-Emond : lui-même se dit devenu un simple spectateur.
Ainsi défini, Le récit peut être considéré comme un procédé central dans le théâtre de Paul Emond, dès lors qu’il actualise concrètement le « noyau originaire » évoqué ci-dessus. D’une part, il ouvre un espace de liberté apparemment sans limites (le récit étant capable de tout accueillir : « le réel et Le rêve », « l’actuel et le virtuel », etc.). D’autre part, il contribue très précisément à instituer cette distance qui, comme Bernard Dort l’a rappelé à juste titre, « est constitutive de la dramaturgie pirandellienne » :
« Remarquons que l’élément essentiel du pirandellisme, ce sont moins les innovations purement techniques mentionnées ci-dessus que l’introduction dans l’œuvre d’une distance entre le drame proprement dit, entendu au sens naturaliste du terme, et la représentation. (…) Ainsi, ce que Pirandello met en scène, c’est non le drame lui-même, mais ce drame réfléchi dans la conscience d’un personnage3 »
La distance en question situant elle-même la scène au seuil des mondes, dans l’entre-deux de la fiction et de la vie (pour reprendre un paradigme pirandellien essentiel). C’est pourquoi, comme celui de Pirandello, le pathétique d’Emond est toujours, pour reprendre le terme de Bernard Dort, « intellectuel » : quand, dans CONVIVES, Lucile pleure, il n’y a pas lieu de pleurer avec elle, d’éprouver intérieurement son drame personnel, mais simplement d’assister au récit de sa « dramolette ». La référence pirandellienne permet par ailleurs de définir aisément le statut particulier du personnage dans le théâtre de Paul Emond : parce qu’il ne fait que (se) raconter, il échappe à toute caractérisation psychologique et se constitue en rôle(s), son être véritable demeurant à jamais dans l’ombre de la fiction.
Si le rapprochement ainsi opéré avec le dramaturge sicilien éclaire incontestablement le théâtre d’Emond (son « noyau originaire », son procédé le plus caractéristique.…), il peut pourtant paraître, par certains aspects, inadéquat. Dans SIX PERSONNAGES EN QUÊTE D’AUTEUR, on s’en souvient, les personnages commencent par raconter leur drame pour essayer de convaincre le Directeur de sa valeur théâtrale : ils remontent dans le passé, évoquent le départ de la Mère et les premières rencontres entre le Père et la Belle-fille (à la sortie de l’école). Le Directeur les interrompt bientôt, rétorquant que « tout cela, c’est du roman ! », « pas du théâtre ! » — ce que le Père admet parfaitement et à quoi il répond : « D’accord, monsieur ! Car tout cela se passe avant. Et je ne prétends pas que cela soit porté à la scène. (…) Le drame se produit à présent, monsieur ! Un drame neuf, complexe. » La scène annonce la suite de la pièce, c’està-dire la répétition théâtrale en tant que telle, et elle témoigne en ce sens fort bien de ce que le mouvement du théâtre de Pirandello est quasi inverse à celui du théâtre de Paul Emond : le premier tend vers la conjonction parfaite (mais strictement impossible) de la vie (« C’est de la vie, monsieur ! De La passion ! », dit le Père) et de la représentation par Le jeu théâtral (non par le récit, qui n’est qu’une étape); le second ne cesse de creuser l’écart qui les sépare, au point que « la vie », l’origine vécue du récit, finit par devenir indiscernable.