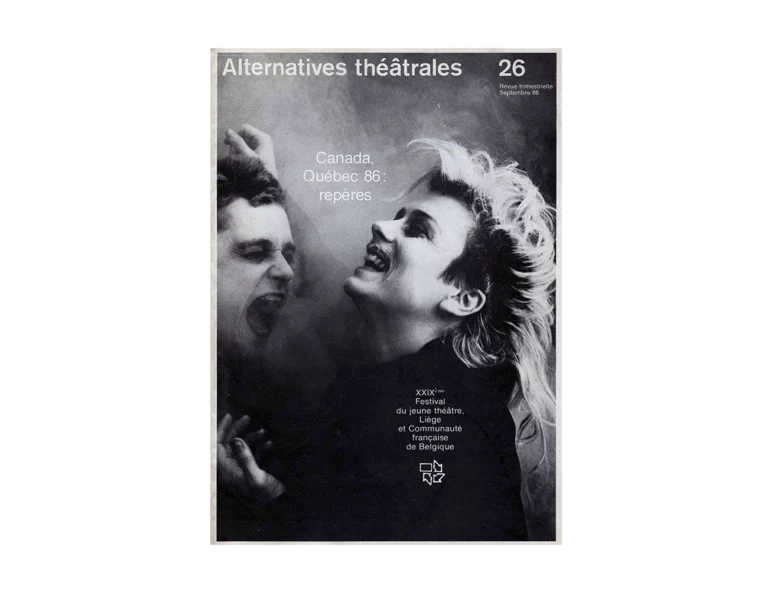D’abord
Rappeler que le Québec est une province du Canada, d’une superficie équivalente à celle de quelques France juxtaposées, d’une population ne représentant pas celle d’un seul Hexagone, très majoritairement francophone, vivant entourée de quarante fois son propre poids d’anglophones et comptant dans ses rangs des représentants d’une soixantaine de communautés culturelles différentes y compris des descendants des premiers habitants du continent américain.

Ensuite
Illustrer de deux exemples choisis arbitrairement, mais à haute teneur poétique, le rapport culturel qu’une partie de cette population entretient avec le monde et l’histoire contemporaine.
A l’automne 1984, dans un café de Montréal, au cours d’une discussion publique portant sur l’opportunité d’«encore » jouer les grands textes classiques, les metteurs en scène invités à prendre la parole se divisaient, grosso modo, en deux groupes. D’une part, on trouvait ceux qui sont à la direction artistique de compagnies institutionnelles — et qui, dans de nombreux cas, ont dû l’envol de leur carrière aux risques du théâtre de création — exprimant leur intérêt pour les nouveaux textes mais prétextant leur statut de commis de l’Etat soumis aux goûts des spectateurs-contribuables (qui en ont ras le bol du « nouveau théâtre »): « C’est dommage, mais c’est comme ça. Ne le prenez pas personnellement, auteurs d’ici et de maintenant, mais vous savez, des Molière et des Shakespeare, c’est rare. En attendant qu’il en sorte un de vos rangs, nous sommes bien obligés de prendre ceux que nous avons déjà sous la main. Il faut bien jouer quelque chose en attendant ». L’autre groupe identifiait les produits de l’écriture au yaourt — dont on connaît bien la mauvaise résistance au temps, lorsqu’il est soumis à la température ambiante — et décrétait que tout ce qui a été écrit avant leur naissance sent le moisi et est, par essence, incapable de rendre compte du vécu contemporain.
Au printemps 1985, se tenait à New York le premier Dialogo de todas Las Americas (Dialogue de toutes les Amériques), rencontre d’artistes de différents pays. Un matin, au cours d’un exposé sur les rapports de force politiques, à l’Université Columbia, le conférencier — se souvenant soudainement qu’il y avait des gens « venus du Nord » dans l’assemblée suspendue à ses paroles — leva tout à coup les yeux de ses feuillets et dit, histoire de n’avoir pas trop l’air dans la lune : « Je m’excuse de ne pas parler davantage du Canada, mais vous devez savoir aussi bien que moi qu’il ne compte pour rien ». Les cinq canadiens présents opinèrent du bonnet.
En deux mots
Mettre en relief, sans trop dramatiser, ni souligner, sans seulement développer vraiment — l’espace manque — le fait que le Québec, achevant sa Révolution Tranquille, revient à son point de départ ; que l’Amérique est plus intransigeante que jamais et réfractaire à tout ce qui n’a pas l’heur d’être évidemment Elle ; et le Canada à vendre, sur le point de l’être, sans figure de style, comme on le dit d’un pavillon de banlieue, à l’Empire voisin, par ses propres dirigeants élus.
Dans ces conditions, que dire ?
Comment faire le point sur une dramaturgie passée — à l’instar de la société dont elle est issue — en quarante ans, par toutes les causes, toutes les morales ?
A l’époque, catholique et prêcheuse à un bout de la gamme et revuiste à l’autre. Populiste tout de suite après. Puis bourgeoise et défaitiste de la fin des années cinquante au milieu des soixante. Nationaliste, réformiste et misérabiliste à partir de là pour finalement se mettre à flotter, à partir de la prise du pouvoir par un certain parti soi-disant Indépendantiste. Par une certaine génération. Quel tableau brosser au sortir de deux générations de combats ? Premier combat : importer ici (exporter là-bas) la Culture.
Disposer de salles où Molière, Shakespeare, voire Genet, lonesco, Beckett pourraient être présentés. Second combat, engagé alors même que le premier prenait à peine son essor : faire reconnaître une réalité d’ici (de là-bas) peut-être différente de celle de l’Europe et ne correspondant pas à l’image courante de l’Amérique protestante et libérale du Boston Tea Party, des lignes d’assemblage de Ford, pas plus qu’à celle des coups d’Etat à répétition de sa moitié sud. Tâter d’autres discours, d’autres canaux, servant à rendre compte de cette différence appréhendée. Ce combat-ci, c’est la création collective. C’est l’auto-gestion (des compagnies qui ne sont pas tenues de se conformer aux règles syndicales à la condition que toutes les décisions soient prises à l’unanimité des membres). Ce sont les tout petits cafés-théâtres (qui n’ont pas la connotation burlesque attachée à ceux d’Europe francophone), seuls lieux où de nouveaux auteurs peuvent trouver accès à la création de leurs textes. C’est le théâtre d’improvisation. Deux combats menés non pas bout à bout mais, par larges pans, simultanément. Par deux générations qui s’affrontent, se nient, s’ignorent ou s’envoient chier. Sans se soucier jamais de ce qu’un jour d’autres hériteront des ruines qu’elles empilent. Deux générations encore jeunes aujourd’hui. Et qu’un gouffre sépare.
Deux combats menés, l’un contre l’autre, souvent, sur un îlot entouré de deux cent et quelques millions d’anglophones pour lesquels tout ce qui n’appartient pas à la culture de New-York, de Californie ou du Middle-West se fond vaguement dans un vague « autre ». Deux combats articulés — quand ils le sont — dans une langue pour laquelle ce qui n’a pas connu la bataille d’Azincourt et le retour de Napoléon est vaguement d’une vague débilité. Un combat qui dit que les racines qui nous unissent à l’Europe, seules, sauront nous sauver. L’autre, que l’Amérique est l’avenir et l’Europe, le colonialisme. Mais, dit-on tout bas et sans trop y croire, l’Amérique serait menaçante. || faudrait savoir ne prendre d’Elle que ce qui, dans son sein, réclame et nie ce qui la fait. Deux combats se déroulant « à l’intérieur des murs ». Comme à l’ombre, entre les remparts d’une vaste forteresse sauvage assiégée.
Alors, que faire ?
Et que fait donc la nouvelle génération, celle d’après ces deux combats-là, maintenant que les murs de la Citadelle sont rasés à fleur de sol et que ces combattants-là se permettent, les soirs de première, attablés, toutes factions confondues, quelques larmes de nostalgie sur les rivalités d’antan, maintenant qu’il n’y a plus de place que pour eux et leur sens de la dérision à l’égard même de leur foi d’hier ?
Pas de carrière à défendre. Ni à espérer, à moins d’aimer beaucoup le goût que laisse la cire à bottes sur la langue. Habitée par un doute immense, elle aussi, à l’égard des causes. Ayant connu la défaite, pourtant. Et, par le regard même que ses maîtres lui ont imposé d’apprendre, témoin de leur trahison. Que faire ?