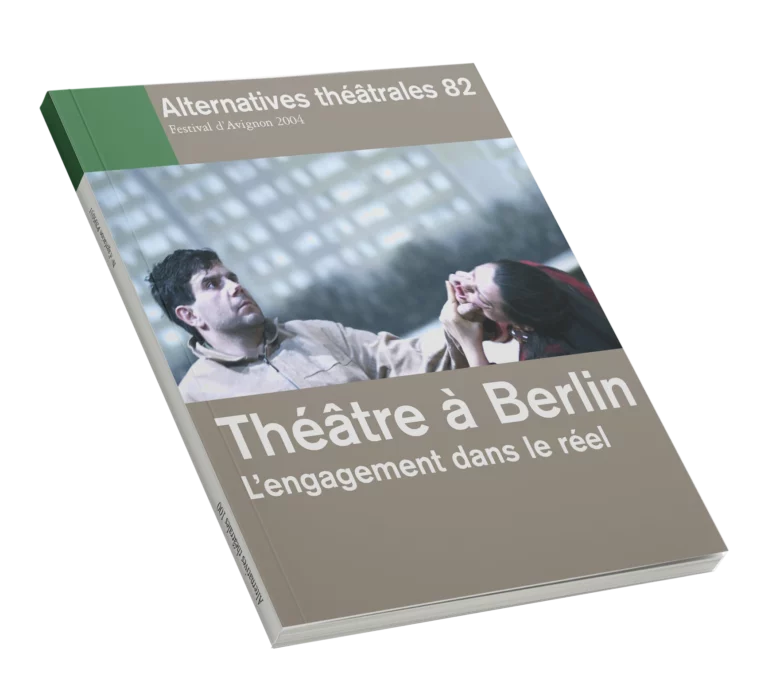En temps de crises, on cherche volontiers des modèles. Et pendant longtemps, les professionnels du théâtre français étaient convaincus que le théâtre allemand était extrêmement riche, aussi bien sur le plan des structures, des institutions que des subventions. Il était devenu un refuge de la diversité théâtrale qui avait de temps en temps rayonné jusque chez le voisin français. Aujourd’hui, les deux paysages théâtraux se trouvent confrontés à une discussion fondamentale sur les structures en bouleversement. Partout, on fustige le cul-de-sac dans lequel la politique culturelle, mais aussi des gens du théâtre eux-mêmes se sont enfoncés après avoir ignoré pendant des décennies les problèmes fondamentaux – et pas seulement ceux de nature économique. Aussi bien en France qu’en Allemagne, les fondements d’une sécurité artistique garantie par l’État sont mis en question. Et la question du rôle artistique du théâtre dans sa signification pour l’art et la société est reposée avec véhémence. S’il existait une réponse, ou mieux encore toute une série de réponses, le théâtre aurait déjà beaucoup gagné. Mais ces réponses ne pourront être trouvées que si les conditions de travail structurelles sont définies d’une façon claire et pour une longue durée, et si chaque subvention accordée au théâtre est considérée comme un investissement dans un avenir artistique et social.
Du théâtre avec une histoire
Celui qui parle d’avenir doit aussi parler de l’histoire, et cela vaut particulièrement pour le théâtre allemand. Parce que le théâtre allemand est resté lié jusqu’à nos jours, d’une façon unique en son genre, à son passé sociopolitique. Les racines du patrimoine théâtral actuel remontent loin au XVIIIe siècle. À l’époque, la Cour française, Louis XIV et Versailles éclairaient toute la culture européenne et avaient donc des épigones ardents en Allemagne. Il faut souligner qu’en ce temps-là, l’Allemagne se composait d’innombrables territoires, la plupart étant de petites principautés. Celles-ci, à l’image de la France, avaient leur propre théâtre pour la société élégante de leur cour, alors que des troupes ambulantes jouaient sur les places des marchés et dans les rues des pièces plutôt improvisées pour le peuple.
Ce ne fut qu’à la fin du XVIIIe siècle que les deux formes de théâtre devaient se croiser lorsque la bourgeoisie naissante des villes voulut se distinguer par rapport à l’aristocratie. Sous le nom de « théâtre national », malgré – ou peut-être justement à cause de – l’absence d’une véritable nation allemande, des entrepreneurs privés dans des villes comme Hambourg, Berlin, Schwerin ou Mannheim fondèrent les premiers bastions de leur nouvelle identité. Le théâtre devint ainsi un élément “identitaire de la culture urbaine bourgeoise qui voulait se profiler face à l’élite aristocratique. On construisit des théâtres d’une façon démonstrative au cœur de la ville, de préférence autour de la place du marché : l’église, l’hôtel de ville et le théâtre, voici le triangle qui se retrouve encore souvent de nos jours au cœur des villes et qui prouve que le théâtre fut un moyen d’expression politique d’une couche de la société, la bourgeoisie, pour se profiler. Les théâtres municipaux et nationaux, qui font partie aujourd’hui de tous les paysages urbains de l’Allemagne, sont ancrés, dès ce moment-là, dans une interaction entre fonction sociale et revendication politique.
À la fin de la Première Guerre mondiale et du système féodal, les théâtres de cour sont nationalisés. Quelques années plus tard, l’État et les communes doivent également prendre en charge les théâtres municipaux qui avaient été financés jusqu’alors par le privé – la crise économique mondiale et l’inflation avaient entraîné la banqueroute des entreprises culturelles. Dès la prise du pouvoir, en 1933, par les nationaux-socialistes, les théâtres sont regroupés dans la « Chambre des théâtres du Reich » et sont donc soumis au contrôle du Ministère de la Propagande. L’expulsion, la fuite, la persécution politique et les meurtres antisémites d’importants penseurs et artistes conduisent à un appauvrissement dans tous les domaines, y compris dans le domaine théâtral. Mais malgré tout, on continue à jouer. Ce n’est que suite aux tensions et aux pertes causées par la guerre que la propagande nazie décide que le film est un moyen plus efficace d’influencer la population. Et pourtant, ce n’est qu’un an avant la fin de la guerre que l’on fermera les théâtres.
Dans l’Allemagne aux deux États, Berlin perd le statut et le rayonnement de métropole culturelle internationale qu’elle fut durant les « folles » années vingt. Mais dès la fin de la guerre, dans toutes les zones d’occupation, on rouvre les théâtres, sur base des fondements juridiques et institutionnels de la République de Weimar. Les Allemands se précipitent littéralement au théâtre : à l’Est et à l’Ouest, l’offre et l’accueil du public explosent. En RDA, avec son organisation centralisatrice, les théâtres sont divisés en trois catégories ( avec des subventions échelonnées), mais il y en aura même dans les plus petites communes qui ne comprennent que 20 000 habitants. Ce réseau très étroit de théâtres nationaux, unique en Europe, démontre quelle importance la RDA attribua au domaine théâtral, aussi dans la conscientisation politique.
Des théâtres privés ou des compagnies indépendantes n’étaient toutefois pas admis, alors que ces théâtres auraient aussi eu leur clientèle dans un pays où le théâtre avait un public large et très attentif. La République fédérale allemande par contre confère, par la Loi fondamentale de 1949, les affaires culturelles aux autorités des Länder. Même les « théâtres nationaux »

(anciennement les théâtres des cours) ne sont plus financés que pour une infime partie par le gouvernement fédéral. Les autorités compétentes pour les trois types de théâtre institutionnels, les théâtres nationaux, municipaux et provinciaux ( Landestheater ) sont les communes qui, elles, sont financées en partie par les Länder respectifs. En Allemagne de l’Ouest aussi, les institutions théâtrales couvrent tout le pays d’une façon décentralisée et, à la suite de la politisation de l’art et de la culture dans les années 70, on voit s’y ajouter toute une série de théâtres indépendants, « alternatifs ». Les deux États allemands ont donc élargi et soigné leur paysage théâtral et là où ils se rencontraient, à savoir à Berlin, naissait une situation très productive de concurrence. La capitale divisée ( de l’Est) et l’îlot ( Berlin-Ouest) étaient les « vitrines » des pays respectifs sur le plan artistique et culturel. La plupart des théâtres importants se trouvent toutefois dans la partie Est de la ville et proposent des stimulations importantes, pour l’Ouest également. Au cours des années, il y aura même un échange important lorsque des artistes de la RDA passent ponctuellement les frontières ( Bertolt Brecht, plus tard Heiner Müller) ou lorsqu’ils émigrent définitivement à l’Ouest et y laissent des marques indélébiles ( Karge/ Langhoff, Einar Schleef, etc.).
L’Allemagne réunifiée ne pourra plus vraiment se réjouir de cette richesse théâtrale : d’abord, comme dans beaucoup d’autres domaines, les théâtres de la RDA doivent s’adapter aux règlements de l’Allemagne de l’Ouest ( y compris pour les conventions collectives extrêmement coûteuses). Mais surtout, on se rend très vite compte que face à la situation économique générale plus difficile et aux caisses vides des communes, on ne peut ou ne veut plus se permettre d’avoir autant de théâtres. Depuis lors, la crise structurelle est évidente et, sous la pression économique, le théâtre allemand dans sa totalité se trouve confronté au « piège de la légitimation ».
Les ensembles sous forme de grandes entreprises ou un théâtre comme collectif de vie
La devise de Frank Castorf à la Volksbühne de Berlin fut en 1993 : « Ne pas tout miser en un tour de main sur Coca-Cola ». Parmi les artistes de la RDA, il ne fut pas le seul – mais probablement celui qui réussit le mieux – à prendre parti pour l’Est de l’Allemagne. La première chose que la Volksbühne exigea, c’est de laisser à celle-ci un peu de temps pour permettre une prise de conscience des ruptures que la chute du Mur avait provoquées
dans les biographies, dans les pensées et dans la vie quotidienne des anciens citoyens de la RDA, et peut-être pour permettre de les aider à les assumer. Car la pression économique s’est fait sentir, depuis la réunification, dans tous les domaines publics et privés. Et il est évident que face à cette situation, les théâtres des nouveaux Länder ont été confrontés à d’énormes problèmes, aussi bien d’ordre interne que par rapport à leur public.
Aujourd’hui, il existe en Allemagne 151 théâtres nationaux et municipaux qui sont financés par les deniers publics. Ils engloutissent la partie la plus importante des subventions de théâtre qui se montent globalement à 2,1 milliards d’euros. À peine 10 % vont à des théâtres privés et à d’autres scènes indépendantes qui co-produi- sent ou invitent des spectacles en tournée. Par contre, dans les théâtres nationaux et municipaux, les mises en scène sont produites par les ensembles locaux et financées par eux-mêmes. Bien que pour des raisons économiques, on ait déjà essayé d’ébranler le système, ces maisons fonctionnent jusqu’à présent avec plusieurs branches d’activités, c’est-à-dire qu’elles possèdent différents ensembles de théâtre, de danse et de musique ( un ballet, un chœur, un orchestre). Ce système des ensembles fixes est une spécificité du théâtre allemand qui permet, d’un côté, un travail et un fonctionnement bien spécifiques, mais qui implique, d’autre part, le dilemme d’avoir à gérer beaucoup de personnel. À l’échelle de la Répu- blique fédérale, le théâtre allemand est une « grande entreprise » qui emploie environ 40 000 salariés. Plus de 80 % du budget d’un théâtre sont engloutis par les coûts salariaux – encore faut-il préciser que le personnel artistique est relativement peu nombreux par rapport aux techniciens et à l’administration. Dans beaucoup de cas, il s’agit de contrats à longue durée, et dans les anciens théâtres de l’Est, ce sont souvent des contrats à vie. Dans ce domaine, le collectif de théâtre était un modèle de vie et de production idéales et donc nécessairement fondé sur la durée. Ainsi, à l’Est comme à l’Ouest, se sont formés des ensembles qui comportaient non seulement des acteurs fixes, mais aussi leurs propres dramaturges et metteurs en scène. Certes, les façons de travailler sont déterminées par la composition des différentes troupes, car tout acteur a envie d’être sur les planches, mais il faut aussi éviter de former trop de stars si l’on ne veut pas détériorer complètement le climat de travail. Mais surtout, que ce soit dans l’harmonie ou dans une confrontation ( productive), des relations de travail à long terme se nouent avec les metteurs en scène et l’on crée ensemble un profil, qui se traduit non seulement par le choix des auteurs et des textes ( que la dramaturgie détermine souvent) et par la griffe de certains metteurs en scène, mais auxquels l’acteur prête son visage, dans le vrai sens du terme : car avec le temps, le public apprend à connaître « ses » acteurs, qu’il suit pendant la saison et durant des années dans différents rôles. Un visage qui revient, un style qu’on connaît, une évolution qu’on peut partager – et un « vieillissement » commun : ce sont des éléments identitaires d’un théâtre qui ne cherche plus vraiment une identification sur le plan esthétique.
La logique du programme de saison – pour quel public ?
On appelle cela : ancrage local. On fidélise ainsi le public. Le théâtre allemand a vendu jusqu’il y a peu plus de la moitié de ses tickets à des abonnés individuels ou de groupe (des associations qui achètent un contingent de tickets et les répartissent parmi leurs membres). Dans les deux cas, les spectateurs profitent de conditions favorables, mais apparemment les jeunes spectateurs ont changé d’habitudes. Comme pour le cinéma, on décide à la dernière minute, juste avant la fermeture de la caisse, d’aller au théâtre. Car même dans les petites villes, l’offre culturelle s’est beaucoup diversifiée pour le « citoyen des médias » et la concurrence se fait sentir, d’autant que dans des grandes villes comme Berlin, Hambourg, Munich, etc., beaucoup de théâtres cherchent à attirer l’attention du spectateur. Après une chute très sensible du nombre de spectateurs dans les années 70, les statistiques de fréquentation sont restées relativement stables depuis avec environ 20 millions de spectateurs par saison. L’époque après la chute du Mur était toutefois difficile pour les théâtres à l’Est, parce qu’elle apportait non seulement de nouvelles habitudes télévisuelles et de nouvelles possibilités de loisirs à ses citoyens, mais également parce qu’elle avait entraîné de sérieux problèmes sociaux et du chômage. Les habitants de villes comme Francfort/ Oder ou Halle partaient en grand nombre vers l’Ouest ou les grandes villes, dans la plupart des cas pour des raisons économiques. Parmi eux, il y avait beaucoup de gens de cette couche sociale cultivée qui avait fréquenté les théâtres.
Un ensemble qui joue pendant l’année dans un lieu, pour une certaine ville, ne fidélise pas seulement le public, mais soutient aussi certaines stratégies de programme. Pour commencer, dans les théâtres allemands, le rideau se lève six fois par semaine pendant les dix mois de la saison, et des représentations ont lieu souvent sur plusieurs scènes à la fois à travers la pratique du théâtre de répertoire. Ce qui veut dire que tous les jours il y a une autre représentation, le décor est démonté et remonté, on alterne en très peu de temps entre le classique et le contemporain avec des mises en scène très différentes. Par saison, on compte jusqu’à vingt productions propres de la maison. Il est vrai que le théâtre de répertoire rend pratiquement impossible d’accueillir des mises en scène de l’extérieur ou de partir en tournée : il n’y a pas de budget pour la première variante, et une tournée n’est pas possible parce que tous les acteurs, les dramaturges et les techniciens sont occupés pratiquement tous les jours dans le théâtre lui-même. On permet en général des répétitions de six à huit semaines par production et, si elle a du succès, elle reste parfois plusieurs saisons au programme. Pour un acteur, cela signifie qu’il travaille parallèlement

Checkpoint Charlie, Berlin. PhotoPeterThieme.
plusieurs rôles, qu’il répète le matin avec un metteur en scène et qu’il joue le soir un autre rôle. Mais cela signifie aussi que l’acteur apprend à embrasser toute l’étendue de la littérature de théâtre et acquiert des expériences de travail très diversifiées lorsqu’il débute. C’est la même chose pour les metteurs en scène qui sont inclus dans le système comme « artistes associés » ou comme metteurs en scène invités. Il n’y a pas d’autres pays où les théâtres proposent autant de possibilités de travail relativement sûres une fois qu’on est « admis » dans les ensembles des théâtres municipaux. À moins de bénéficier de la réputation de star, les metteurs en scène ne sont toutefois pas toujours tout à fait libres dans leur choix des pièces et des sujets, ainsi que pour le choix des acteurs.
Car le programme de la saison d’un théâtre allemand est d’abord élaboré par le dramaturge. À travers tout le pays, on trouve le même schéma selon lequel les pièces sont choisies : un tiers d’auteurs classiques, un tiers d’auteurs classiques modernes, un tiers de textes contemporains ( ce qui a donné, en chiffres absolus pour la saison 2001 / 2002, environ 5 800 mises en scène de presque 2 500 pièces différentes). Ce ne fut qu’au milieu des années 90 que l’intérêt pour des auteurs vivants a augmenté de manière sensible, après une phase d’interprétation radicale des classiques. Contrairement aux usages en France, les textes de ces auteurs sont souvent non seulement montés en création mondiale, mais aussi joués après dans différentes mises en scène. Grâce à certaines vagues « à la mode » que l’on retrouve régulièrement dans le système allemand, certains auteurs et certaines pièces se sont fait connaître d’un coup puisqu’ils étaient montés par des metteurs en scène très différents sur plusieurs scènes à la fois. Il faut ajouter à cela qu’aujourd’hui toute une série d’hommes de théâtre produisent aussi leurs propres textes qui, parfois, ne sont que des collages de textes, qu’ils montent ensuite eux- mêmes, ce qui du reste n’est pas inhabituel en France. On adapte aussi volontiers de nos jours des scénarios de films ou des romans. De tels projets, pour lesquels la Volksbühne a créé une certaine tendance esthétique que beaucoup d’autres tentent d’imiter, s’intègrent très bien dans les grandes lignes thématiques que beaucoup de programmateurs de saison ont choisies pour devise.
Car la tendance des dernières années, c’est non seulement d’établir dans chaque saison des transversalités entre les différentes mises en scène, mais aussi de plus en plus souvent de reprendre certains discours socio-philosophiques. C’est le contenu qui prime sur l’esthétique qui doit rester assez variée pour que le théâtre municipal allemand puisse répondre aux attentes du public, souvent formulées avec véhémence : il faut qu’il y ait quelque chose pour tous les goûts et surtout pour celui des abonnés. C’est là que le bât blesse dans beaucoup de théâtres municipaux, car beaucoup de directeurs pensent ne pas pouvoir se permettre des exercices esthétiques sur la corde raide.
Les nouvelles tendances artistiques naissent donc souvent en dehors du système, dans les institutions marginales ( les théâtres « libres ») ou on les expérimente dans les festivals. C’est d’ailleurs seulement là, le « Hebbel- Theater / Hebbel am Ufer » de Berlin mis à part, que l’on a la possibilité en Allemagne de voir des personnalités de théâtre internationales. Mais puisque le théâtre doit également développer des stratégies de marché pour trouver son public, il absorbe tout ce qui se trouve comme jeunes et nouveaux talents, peu importe où ceux-ci trouvent leur premier succès ( concrètement : il faut que la presse en parle ). Tout ce qui est « jeune et frais » est porté aux nues pour l’instant, tout au moins par la presse, même si des « vieux serviteurs » du théâtre ne peuvent pas être relevés aussi facilement.
Le plus grand problème du théâtre allemand d’aujourd’hui, ce n’est peut-être pas le manque de créativité artistique que l’on appréciera avec nuances, en fonction de sa diversité. Ce qui prime actuellement dans la discussion sur la crise du théâtre, c’est la chasse au public et le débat sur la politique culturelle qui crée de fausses contraintes de légitimation pour les théâtres. Le système traditionnel souffre d’une nouvelle composition de la société qui consomme la culture et qui est moins poussée que l’ancienne bourgeoisie cultivée par la recherche d’idéaux intellectuels et la conscience de faire partie d’une élite. Le théâtre n’a plus la fonction de guide.
Les discussions importantes sur la société sont menées de nos jours aussi sur les écrans de cinéma et de la télévision.

Pourquoi la crise ne s’arrête jamais
La réduction de subventions, qui a entraîné ces dernières années des fermetures de théâtre et des fusions ou des suppressions de certaines branches d’activités, est bien un signe, mais pas la seule raison de la crise.
Ce qui est enviable dans le théâtre allemand, c’est sa grande « richesse » en structures hautement professionnalisées dont il disposait jusqu’à présent et qui continue d’exister d’une façon relativement naturelle ; mais égale- ment son rôle de pilier dans le monde culturel et social, ce qui le fait considérer comme « important » jusqu’à nos jours. C’est ainsi qu’on arrive à expliquer comment les États allemands de l’Est et de l’Ouest ont réussi à répondre aux besoins de base en théâtre de toute une population. Mais dans les années à venir, les buts d’une « éducation morale » ou d’un progrès idéologique et politique ne feront plus vraiment partie des réflexions. Car la société postmoderne n’a pas seulement galvaudé les utopies, elle a tellement multiplié les valeurs et les expériences que l’art ne peut plus se revendiquer d’aucun horizon commun en valeurs intellectuelles et existentielles. Et les histoires dans le théâtre ne peuvent plus réduire à un dénominateur commun les conceptions et les expériences. Car cela voudrait dire qu’il existe un modèle existentiel, un idéal. Et un langage commun pour en parler.
Mais le théâtre ne dispose même plus de ces repères sans se mettre en doute lui-même, et il s’éloigne ainsi du geste littéraire. Par contre, les mythes triviaux du quotidien pénètrent dans le monde théâtral qui cherche un nouvel enracinement en absorbant les phénomènes populaires – dans le domaine musical, cinématographique, mais aussi dans certaines représentations du corps et des associations d’idées. Et il est obligé de se chercher à chaque fois un nouveau langage pour toutes ces « sources d’inspiration » dans le monde médiatique et artistique. Et dans le théâtre allemand surtout, un langage qui intervient dans les débats contemporains. Le spécialiste du théâtre Andrzej Wirth le formule ainsi :
« Ce dont le théâtre dans notre pays a besoin ne peut être observé qu’à l’extérieur du théâtre ». La recherche et l’observation des réalités à l’extérieur conduit alors à un « réalisme engagé » ( d’un Thomas Ostermeier), ou à « l’éclectisme forcé » d’un Frank Castorf qui veut « se battre » à sa façon avec la vie quotidienne. Mais comme, de nos jours, les réalités sociales conduisent plutôt à des craintes qu’à des certitudes, cette crise pénètre évidemment aussi dans le théâtre, et cela bien au-delà de la discussion structurelle. Qu’il continue donc à crier d’une manière bien théâtrale : « La crise, c’est moi ». Il doit simplement se décider, en Allemagne comme ailleurs, entre le nombrilisme autosuffisant ou la tentative d’aborder la question un peu plus complexe de savoir comment s’entrecroisent les visions du monde et du moi.