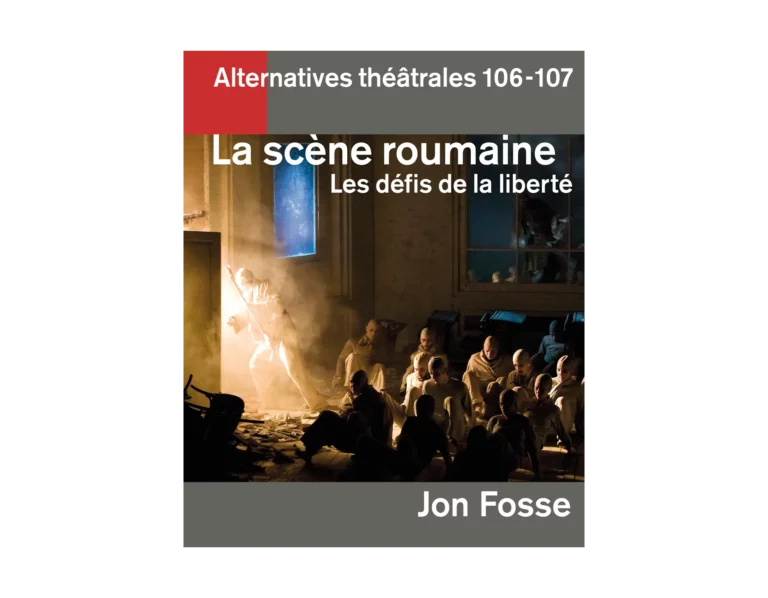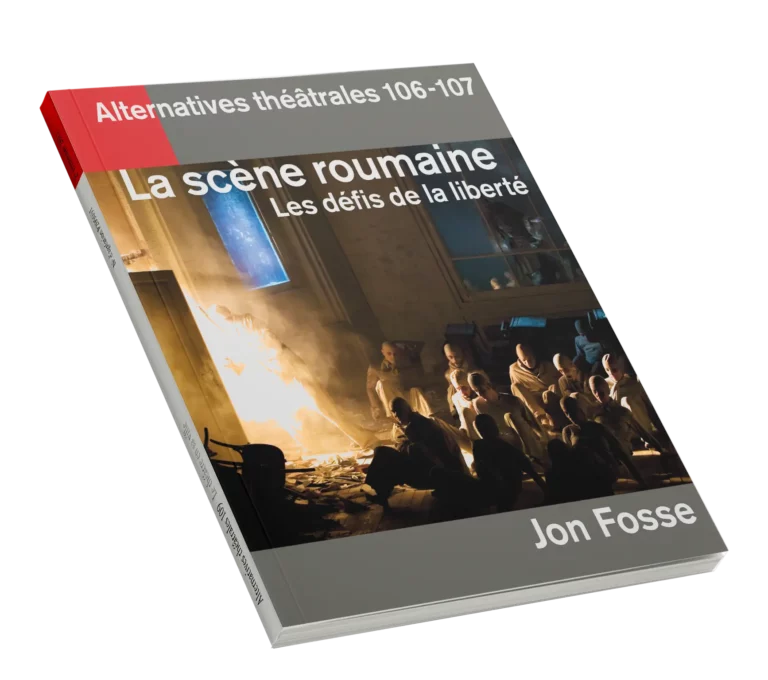IL Y A DES ANNÉES, quand après une représentation d’UBU ROI, le recteur du Conservatoire de Bucarest dit, presque en s’excusant, « je préfère la langue de Racine », il suscita des sourires ironiques parmi les jeunes gens que nous étions et qui voyaient, par ailleurs, dans ses propos, un acte d’allégeance à l’égard du conformisme de l’esthétique officielle. Dans les libertés linguistiques prises actuellement, peut-on déceler une insurrection contre les interdits de jadis ? En partie, sans doute, mais le phénomène ne peut se réduire à cet affrontement avec le passé.
Le hors-normes de la langue
Un symptôme pointe. Il se généralise et contamine la plupart des textes nouveaux qui paraissent, surtout dans les pays de l’ancien Est, de Sigariov à Gianina Carbunariu ou Nicoleta Esinencu, de Stefan Pecaaux frères Plesniakov, de Bucarest à Varsovie ou Moscou. Ces auteurs sacrifient toute convenance langagière et cultivent l’agressivité d’une langue que l’on pourrait appeler « langue brute ». Langue qui draine les pires injures, les expressions les plus ordurières, les appels les plus explicites au sexe, comme si les jeunes personnages qui étalent leurs déchirements dans ces textes ne pouvaient pas se dissocier de cette langue crue, violente et… odorante. Langue du « rang le plus bas », pour paraphraser Kantor qui parlait de la « réalité du rang le plus bas » comme matière de son théâtre… Pareille langue surprend et déroute. À quoi correspond cette volonté d’employer le vocabulaire le plus grossier et de le projeter, de le donner à entendre sur une scène ?
Il s’agit en premier lieu – cela va de soi – d’une décision polémique, pareille à celle de Jarry qui se dressait contre la langue d’apparat, la langue à l’abri de cette dimension excrémentielle sous le signe de laquelle, grâce au célèbre « Merdre », il plaçait son UBU. Chez les auteurs actuels, la parenté avec ce geste originaire de la modernité est flagrante : ils engagent le procès d’une langue construite, maîtrisée, complexe en utilisant une langue élémentaire qui intègre tous ses résidus et fait fi des exclusions anciennes, des contraintes longtemps respectées. C’est comme si, par cette libération de la moindre censure, les écrivains nous donnaient à entendre une sorte de « retour du refoulé » de la langue. C’est le réveil d’un « ça » linguistique, équivalent du « ça » de l’inconscient freudien, car les écrivains puisent dans la strate la plus profonde de la langue. Langue basse réfractaire à tout idéalisme. Elle s’assume comme langue concrète, matérialiste. Comment expliquer cette montée vers la scène d’un vocabulaire banni ? À quoi correspond-elle ? Un commun désir d’attaque et une volonté de destruction généralisée se rejoignent dans cette posture qui finit en symptôme de l’écriture moderne.