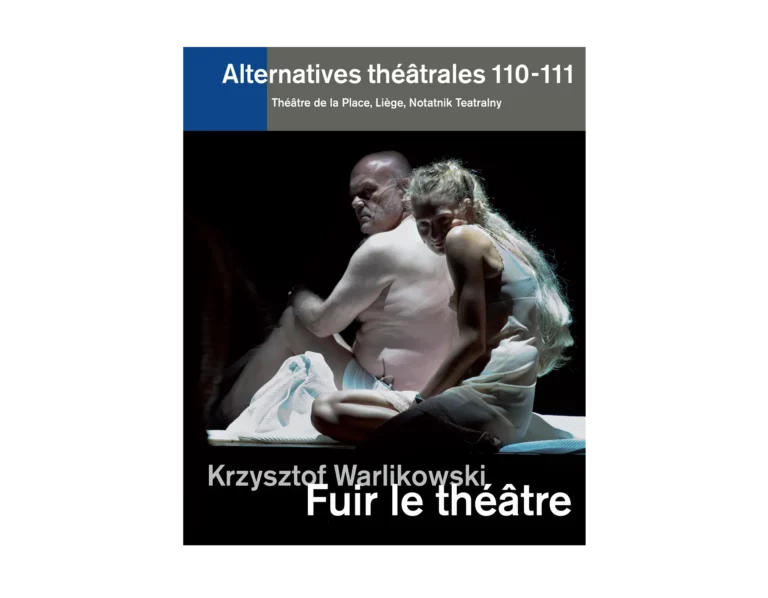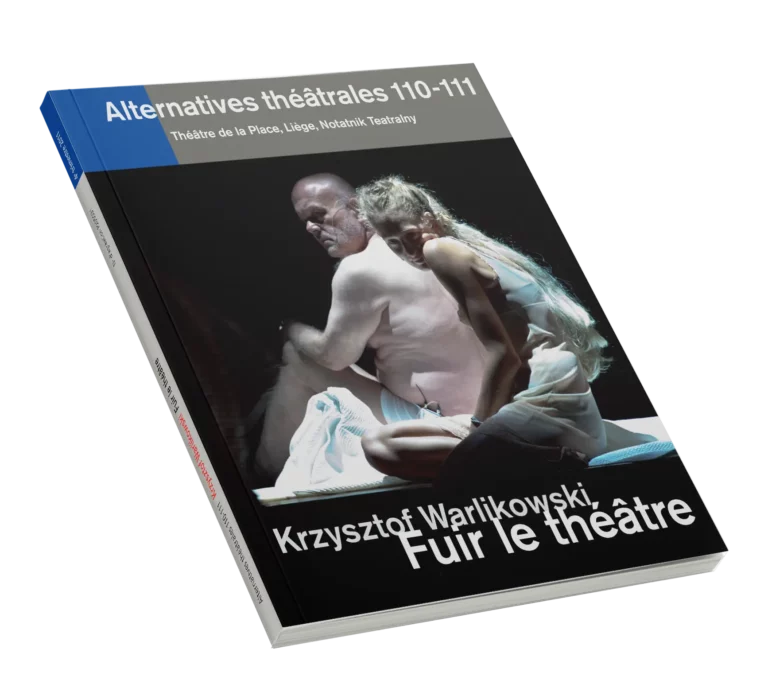Bernard Debroux : Pourquoi ta compagnie s’appelle-t-elle la Compagnie Louis Brouillard ?
Joël Pommerat : Quand j’ai choisi ce nom, j’avais envie d’un nom qui pourrait éveiller le plus de curiosité possible, qui pourrait interpeller l’imagination. Je trouve que ce n’est pas trop mal réussi. Je voulais surtout trouver un nom qui ne soit pas neutre, parce que je voulais vraiment, à ce moment-là, créer l’identité d’une compagnie et pas seulement « me faire un nom » comme auteur et metteur en scène. J’avais l’ambition de constituer une compagnie, une troupe, parce que j’avais déjà la conviction que, de toute façon, on ne pouvait pas faire du théâtre tout seul. Et qu’en tout cas, si on voulait vraiment explorer, faire de la recherche théâtrale, il fallait travailler en communauté au sens pratique du terme. Donc j’ai choisi ce nom « brouillard » parce que je voulais définir quelque chose. J’ai inventé ce personnage qui s’appelle Louis Brouillard qui est évidemment un être imaginaire. Mais, dans ce nom, il y a quelque chose
qui constitue en quelque sorte un mot d’ordre pour mon travail, c’est la notion d’ambiguïté, de flou. C’était aussi se positionner par rapport à un théâtre qui, dans les années quatre-vingt, a souvent été du côté du rationalisme, un théâtre qui voulait tout raconter, tout dévoiler, un théâtre un peu français aussi finalement, un théâtre cartésien. Le théâtre de Molière aussi, c’est-à- dire un théâtre où les choses s’énoncent clairement, on parle du visible des choses. Ce qui n’est pas de l’ordre du visible n’est pas accessible. C’est la poésie abstraite qui peut s’en occuper mais le théâtre, c’est l’art du visible. J’ai toujours eu la conviction que le théâtre pouvait être aussi un art de l’abstraction, voire de l’invisible ou encore de l’imaginaire et pas simplement de l’apparent. Donc le brouillard. En opposition, par exemple, à une compagnie qui est une référence, le Théâtre du Soleil et qui, en plus, avait posé l’imaginaire du côté du climat. Donc, c’était un clin d’œil, car j’aime beaucoup cette troupe, c’est une référence pour moi. Je me suis aussi positionné de façon contradictoire par rapport à ce travail.
B.D.: Pour toi l’idée de compagnie, du collectif, de la communauté, est important. D’un spectacle à l’autre, les questions d’écriture se posent de manière différente. En regardant Cercles/fictions, on est en face d’une sorte de poésie en actes. Il y a quelques années encore, lorsqu’on parlait d’un texte de théâtre, on parlait d’un poème dramatique. Ensuite, cette notion a eu des connotations un peu désuètes, un peu traditionnelles parce qu’on sait bien qu’aujourd’hui, le théâtre c’est autre chose que cela. Pourtant, ici, on est vraiment en présence d’un univers poétique, de fragments poétiques. Comment, pour ce spectacle, le processus d’écriture s’est-il déroulé, notamment avec les acteurs. Il y a eu des étapes d’improvisation suivies par des étapes d’écriture. Des va-et-vient entre l’une et l’autre ?
J.P.: Je n’en ai pas un souvenir totalement précis à vrai dire. Mais une chose est certaine. Pour Cercles comme pour les autres créations, j’ai travaillé en plusieurs étapes successives. Nous avons eu quatre sessions de répétition, plus un atelier qui avait précédé ces quatre sessions.
Et ces quatre sessions de répétition ont été espacées de deux-trois mois quasiment chacune. La première session de travail de Cercles a eu lieu au mois d’avril à Bruxelles, la seconde à Toulon au mois d’août, la troisième au mois de décembre et la dernière, qui suivait, au mois de janvier à Paris au Théâtre des Bouffes du Nord, où on a créé le spectacle. Entre chacune de ces périodes, je suis retourné à l’écriture individuelle. Chez moi, ou en tout cas dans des lieux où j’écrivais solitairement. Évidemment, les sessions de travail, de répétition, étaient des moments où je pouvais faire des tentatives, des essais, avec les comédiens. J’ai demandé aux acteurs d’improviser sur des thèmes, des situations, des personnages que je leur proposais. Ça a été l’occasion d’explorer la lumière, le son, l’espace scénographique. Souvent, quand on parle de répétition au théâtre, ils’agit de partir d’un objet défini et le mettre en chantier.
Là, les répétitions finalement mettent en chantier un objet qui n’est pas encore défini, qui commence à se définir intellectuellement. Il n’y a pas de texte préalable, le texte s’écrit pendant les répétitions. J’écris, par exemple, le matin, avant de venir à la répétition, mais j’écris aussi entre les périodes. On est vraiment dans un aller-retour. Le temps de répétition est vraiment un temps de recherche. Des choses sont expérimentées, explorées et donc forcément des choses sont rejetées, mises de côté. Des tentatives sont abouties mais beaucoup d’autres ne le sont pas. Et le spectacle se dessine à travers des pistes qui commencent à être explorées et qui pour certaines sont stoppées net pour que d’autres aient vraiment le temps de se prolonger. L’écriture du spectacle n’est vraiment constituée que le jour de la première représentation où peut-être les choses vont se cristalliser et finalement se fixer parce qu’il n’est plus temps, au moment de la confrontation avec le public, de continuer la recherche, mais elle pourrait sans doute
se prolonger encore.
B.D.: Les périodes de répétitions ne concernent que les acteurs ou l’ensemble des participants ? La scénographie, l’écriture scénique semble tellement importante. Y a‑t-il un va-et-vient de l’un à l’autre, sont-elles là dès le début ?
J.P.: La particularité de la démarche que j’ai voulu mettre en place, c’est que pour créer un spectacle, pour l’écrire et le mettre en scène, je considère qu’il nous faut entre trois et quatre mois. Trois mois en trois périodes séparées les unes des autres. Si on travaillait trois mois d’affilée, on n’aurait pas les mêmes conditions du tout. Séparer ces trois périodes c’est prendre du recul. Pour ces trois périodes, il y a des conditions qui sont mises en place et qui sont à l’identique de celles qui sont là pour le spectacle, tel qu’il est présenté aujourd’hui. Dès le premier jour de répétition, la lumière est mise en place. Et il y a d’ailleurs beaucoup plus de projecteurs installés qu’aujourd’hui où on a fait le choix et on a trié. La scénographie est en place, le gradin est posé, peut-être pas dans sa finalisation évidemment mais dans une maquette à l’échelle quasiment un, dès le premier jour de répétition. Des costumes sont là pour que les acteurs puissent aller y piocher, dès le premier jour. Le matériel sonore est en place à l’équivalent de ce qu’il est aujourd’hui dans ce théâtre où on joue le spectacle.
Les équipes techniques sont présentes évidemment. Toute cette technique et ces équipes sont importantes et coûteuses, présentes à tous les stades de l’exploration. C’est pour ça qu’on peut, je crois, vraiment faire ce qu’on peut appeler une recherche sur la lumière, sur la scénographie. Bien souvent la recherche s’arrête à la réflexion intellectuelle et elle n’a pas la possibilité de continuer à se confronter à la réalité du plateau et des trois dimensions. C’est comme s’il y avait le temps de la réflexion et puis ce temps devrait s’arrêter pour entamer le temps de la réalisation. Je suis réfractaire à cette idée qu’on ne puisse pas continuer à réfléchir en réalisant.
B.D.: Pour l’écriture, y a‑t-il une part qui appartienne vraiment aux acteurs, dans ces fragments qui ont été expérimentés et puis un moment donné retenus ?
J.P.: Il y a vraiment très peu de mots, de phrases qui proviennent des improvisations. Je pense que dans ce spectacle il y en a peut-être un tout petit peu plus que dans d’autres, parce que c’est une écriture particulière qui se rapproche de la parole de la vie de tous les jours. Mais en même temps, vraiment, je ne me sers pas des improvisations pour écrire directement. Pour répondre précisément, deux ou trois phrases sont peut-être issues véritablement des improvisations. Et ce sont des scènes très spécifiques, ce sont presque des scènes que je voulais garder improvisées même. Je finis par écrire en me servant des improvisations. J’ai besoin de prendre en charge la parole. Ce n’est pas pour autant que les improvisations ne me servent pas mais je n’attends pas des acteurs qu’ils créent le langage. Quand je propose aux acteurs d’improviser, ils m’aident à prendre conscience souvent des enjeux d’une situation. Je définis une certaine situation entre deux personnes. Et, le fait de demander aux acteurs d’explorer cette situation, me fait prendre conscience beaucoup mieux que si j’étais dans ma tête, ce qui se passe réellement, physiquement et au-delà entre ces deux personnages. Et d’un seul coup, il y a des choses qui m’apparaissent qui ne me seraient pas apparues si j’étais resté au stade de l’écriture ordinaire, je le sais. Ces choses qui m’apparaissent ne sont pas forcément des choses qui sont prononcées par les acteurs, ce sont des choses que je ressens. Comme quand on voit deux personnes dans la vie en train de se parler ou de s’affronter sur un sujet et on est visionnaire de ce qui se passe entre ces deux personnes dont peut-être eux-mêmes n’ont pas conscience. C’est cette dimension-là qui est la plus importante dans l’écriture. Quand on écrit, finalement, il y a la face immergée de l’iceberg et tout ce qui sous-tend ce dialogue. C’est ça que j’attends de l’improvisation. Elle ne m’apporte pas du langage, de la parole. Je dirais qu’il n’y a rien de plus facile que d’écrire du dialogue ou de la parole mais, en revanche, cerner ces enjeux dont je parlais, c’est ce qui est finalement le plus essentiel.
B.D.: Tu indiques dans le programme distribué aux spectateurs que deux éléments ont été à l’origine du spectacle. D’abord cette idée du cercle qui a donné son nom au spectacle. Le théâtre fait la part belle en général à la frontalité. Se pose la fameuse question du quatrième mur, toujours un peu trouble. Je pense notamment aux Marchands, lorsque le personnage regarde la télévision sans télévision et qu’il regarde le public. Ici, c’est, semble-t-il, une conversation avec Peter Brook qui a donné naissance et confirmé cette idée ou en tout cas qui t’a mis sur ce chemin différent, de ne plus avoir un rapport uniquement frontal mais ce rapport circulaire. Était-ce pour toi une idée ancienne ?