« Et seulement quand nous aurons échoué, définitivement battus et sans espoir, léchant nos blessures, dans le plus triste état, alors nous commencerons à nous demander si nous n’avions pas tout de même eu raison et que la terre tourne. »
Bertolt Brecht
« LEBEN DES GALILEI » — comme on dirait « vie de Jésus », cet autre galiléen — relate en une suite de paraboles la passion d’un homme, témoin et fondateur d’une nouvelle alliance. Œuvre testamentaire d’un apocryphe sans doute — Christ et Judas ne font qu’un en la personne de Galilée — mais néanmoins exemplaire en ce qu’elle révèle. Que cette révélation galiléenne ne nous préserve pas de l’apocalypse et donc de l’anéantissement, c’est là, semble-t-il, la « bonne nouvelle » que le siècle de Brecht n’a pas démentie.
Galileo Galilei a vocation à l’univers. Il est un homme catholique en somme, au sens étymologique du terme. Frère en utopie du Don Rodrigue de Claudel, lui aussi veut élargir le monde à sa manière et, au désenclavement géographique de la vieille Europe, adjoindre le désenclavement de l’esprit lui-même. Mais c’est sur le doute et non pas sur la foi qu’il fonde son espérance. Précurseur des Lumières, il se doit de faire la lumière, d’interpréter l’univers qui lui fait signe au travers de sa lunette astronomique. Et ce qu’il voit, c’est que le ciel est aboli. Notre galiléen des temps nouveaux proclame un monde sans Dieu. Voilà l’homme entre sa conscience et son rien. « Ô doute seule éternité » pourrait être son credo.
Cette parole profondément « dysangélique », Galilée la dispense à tour ce qui gravite autour de lui. Chaque figure qui lui fait face est comme une tentation incarnée de la pensée adverse, et cette gravitation théâtrale galiléo-centrique décrit les différentes stations de l’homme jusqu’à son abjuration. A chaque étape, se renouvelle l’invitation à pactiser avec le Diable, autrement dit l’Église et son Ponce Pilate de Pape. Et Galilée finit par trébucher et décevoir celui de ses disciples qu’il aimait le plus. La chair est faible, il est vrai, et qui n’abjurerait sa croyance, même fondée en raison, sous la menace de la torture ? Andrea cependant, son fils par la semence de l’esprit, aurait bien voulu croire qu’il s’agissait d’une ruse. La ruse n’est-elle pas l’une des cinq conditions selon Brecht pour écrire la vérité ? Mais Galilée dénonce à la fin le pacte, s’accuse avec véhémence d’avoir trahi la nouvelle alliance.


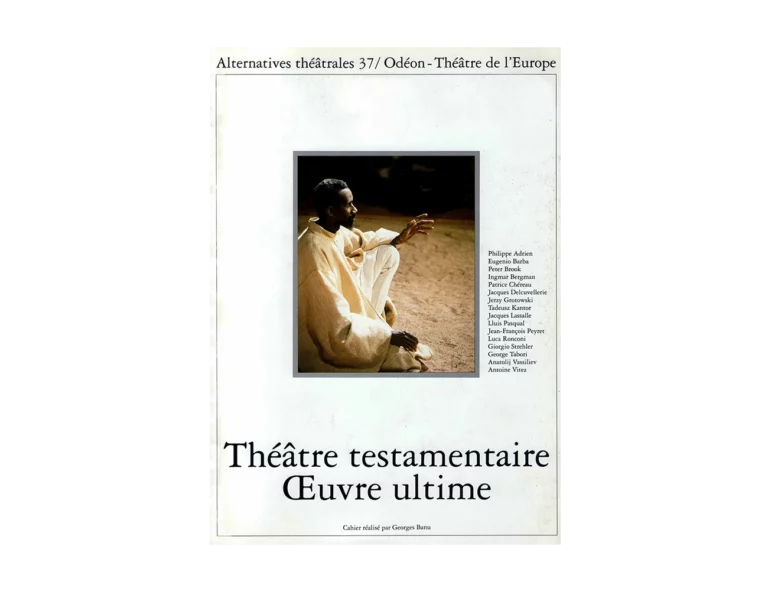
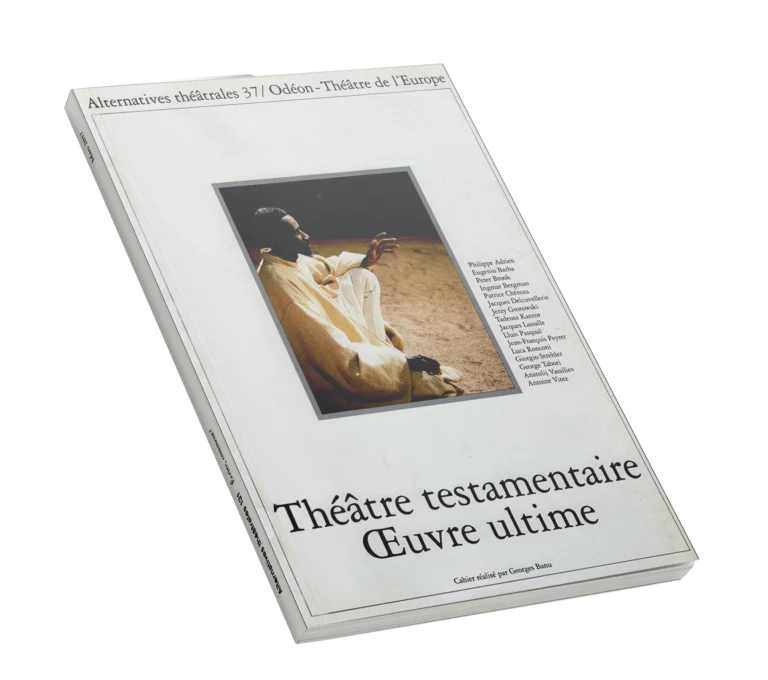
![Lequeu, Jean-Jacques (1757-1826), D’après nature [femme enceinte] : [dessin]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Dapres_nature_femme_enceinte___.Lequeu_Jean-Jacques_btv1b53164350x_1-428x261.webp)

