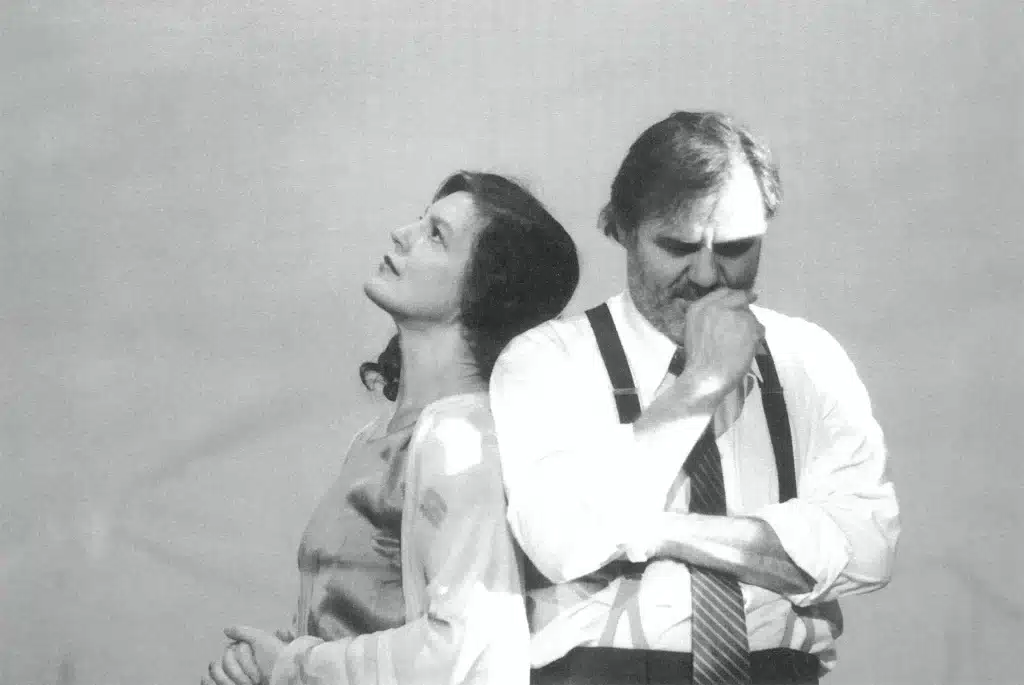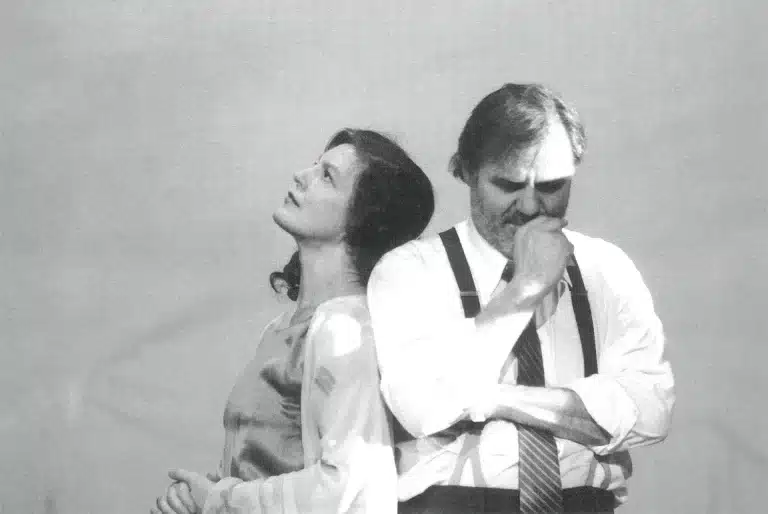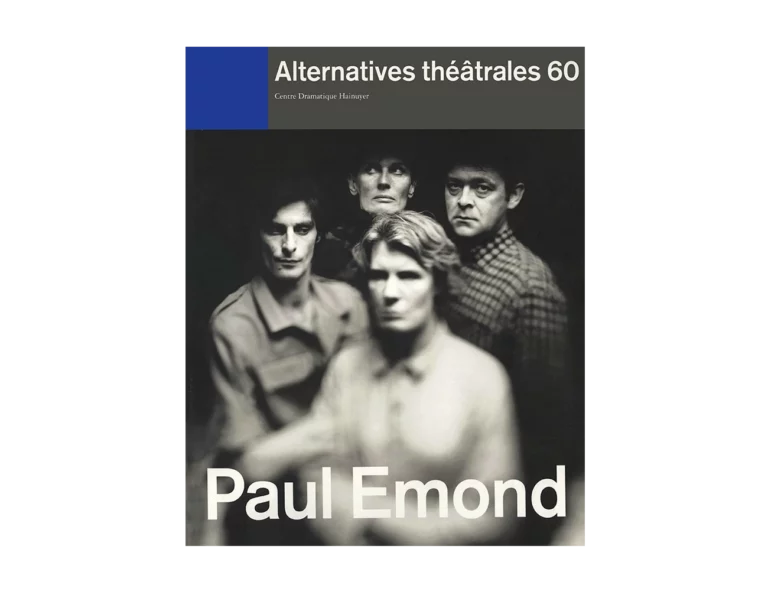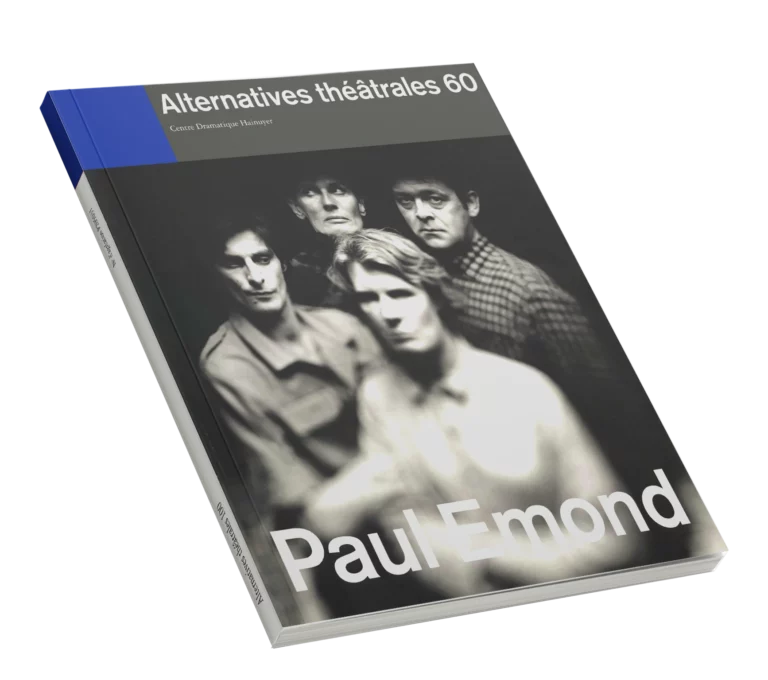OLIVIER ORTOLANI : Votre évolution de metteur en scène a‑t-elle connu des moments de rupture, des tournants particulièrement décisifs ou bien s’est-elle déroulée de manière continue ?
Peter Zadek : De nombreuses ruptures jalonnent mon histoire de metteur en scène. J’ai commencé à travailler en Angleterre, après la guerre. J’y ai fait une série d’essais dans des conditions extrêmement difficiles, à tel point, que je ne savais pas si c’étaient les conditions qui étaient tellement difficiles ou si je manquais de talent. Je ne savais qu’une seule chose : je continuerai, quoi qu’il arrive. Au début des années cinquante on m’a soudain collé l’étiquette d’un metteur en scène de Genet, d’Ionesco et du théâtre de l’absurde, dont je ne voulais absolument pas. Mais cette étiquette me rendait crédible, parce qu’elle allait de pair avec ma situation d’émigré en Angleterre. (Elle ne m’a pas pour autant permis d’entrer dans un club — comme par exemple Le club John Osborne des jeunes hommes en colère —). Comme je ne pouvais pas vivre des deux, trois mises en scène de Genet et d’Ionesco que j’avais réalisées, j’ai monté tout ce qu’on m’offrait en province : Shakespeare aussi bien que des pièces de boulevard (à un certain moment même cinquante par an, une par semaine). Et je crois que ça m’a fait beaucoup de bien d’essayer tellement de choses différentes, même si, en le faisant, je n’avais évidemment pas encore trouvé ma vraie voie. Sauf que je savais dès le début que c’étaient les acteurs qui m’intéressaient ; le regard dans les yeux des acteurs.
Dans un deuxième temps, à partir de 1958, j’ai travaillé en l’Allemagne, où j’avais tout à coup des possibilités toutes autres : même si je ne suis allé qu’en province, j’ai pu monter de grandes pièces dans Le théâtre municipal d’Ulm. Tout de suite j’ai mis en scène Shakespeare ainsi que des comédies musicales et j’avais affaire à une troupe formidable, ce qui m’a permis de commencer à faire ce qui m’intéressait vraiment. Ça allait dans le sens d’un théâtre très réaliste avec un fort accent de cabaret tel que je le pratique toujours. Mais à l’époque c’était particulièrement accentué sans doute parce que je venais tout juste de quitter l’Angleterre et que j’avais sans cesse en tête son humour. Un humour sec et bizarre, qu’au fond je n’aimais pas tellement quand je vivais en Angleterre. À Ulm j’ai aussi rencontré Wilfried Minks dont les scénographies me procuraient le soutien formel dont j’ai toujours eu besoin, qu’il vienne d’un acteur, d’un scénographe ou des deux. Minks a beaucoup influencé mon travail, il m’a apporté la sérénité ; grâce à lui, je me sentais en sécurité. J’ai donc pu prendre des risques, plonger Le travail dans un grand chaos, et à la fin seulement remettre les choses en ordre — ce que je continue à faire aujourd’hui. Ce fut ma période d’expérimentation, elle devait durer jusqu’à la fin des années soixante à Brême. C’était une période où je me suis intensément confronté à la forme, grâce à Wilfried Minks en particulier. Il s’agissait non pas de mettre en ordre le chaos à l’intérieur des acteurs — qui était aussi le mien —, mais de le libérer et de le présenter. J’ai fait alors des choses très extrêmes. Dans LES BRIGANDS1 de Schiller, par exemple, je me suis rangé complètement du côté de Minks et j’ai fait des mouvements et des masques très stylisés, de sorte que l’image et les acteurs devenaient presque identiques. Les acteurs me devenaient alors de plus en plus étrangers, c’était devenu trop formel. Aujourd’hui encore Bruno Ganz m’en veut, car lorsqu’il jouait Franz dans LES BRIGANDS — merveilleusement bien d’ailleurs — j’étais assis dans le parterre et je lisais le journal par réaction de défense contre tout ça ; je trouvais les acteurs trop peu libres et trop fixés. Mais j’ai aussi monté L’ÉVEIL DU PRINTEMPS2 de Wedekind, et cette fois, l’espace construit par Minks m’a permis de travailler de manière très méticuleuse, très détaillée et très précise avec les acteurs. Mon travail oscille toujours entre ces deux pôles : le chaos et la forme. D’une manière un peu simplifiée, je dirais que la forme est ce que j’ai trouvé chez les Allemands et que le chaos, je l’ai rapporté d’Angleterre.
À la fin des années soixante, Wilfried Minks et moi avons cessé notre collaboration — Minks voulait faire de la mise en scène, je voulais essayer autre chose. J’ai tendance à fuir et à détruire les choses que j’ai autour de moi pour repartir à zéro. Ainsi de 1968 à 1972 j’ai réalisé surtout des films — LA COUPE, JE SUIS UN ÉLÉPHANT, MADAME, PIGGIES —, j’ai travaillé beaucoup avec Tankred Dorst et je n’ai pas fait beaucoup de théâtre. À cause de la séparation avec Wilfried je ne me sentais plus sûr de moi, je devais trouver une autre voie ; le Belge Guy Peellaert a été mon nouveau partenaire, avec lui j’ai réalisé LA COUPE3, deux fois au théâtre et une fois au cinéma. C’était un travail très important pour moi, car il m’ouvrait une direction nouvelle, hautement stylisée (à laquelle cependant je ne m’identifiais pas du tout).
En 1972, je suis allé à Bochum où, à ma plus grande surprise, j’ai constaté que les mineurs ne fréquentaient pas le théâtre et qu’il n’y avait qu’un public de classe moyenne. Le désir de changer cette situation a beaucoup influencé mon travail. J’ai commencé avec PETIT BONHOMME QUE FAIRE4, avec lequel j’inaugurais toute une série de spectacles qui m’occupent encore aujourd’hui. Des spectacles qui s’apparentent à la forme du cabaret, mais qui sont en partie aussi très réalistes. PETIT BONHOMME QUE FAIRE était un très beau spectacle, il a eu un énorme succès — on aurait pu Le jouer encore dix ans s’il n’avait pas été aussi cher. Pendant ce temps je m’éloignais de l’esthétique un peu sévère de Minks pour aller vers une méthode de travail moins contrôlée et plus chaotique. À ce moment-là j’ai aussi fait la connaissance d’un scénographe, Goetz Loepelmann qui était aussi chaotique que moi. Son goût était pareil au mien, c’était un Allemand bien que sa manière de penser ressemblât à celle d’un Anglais. Le travail dans le détail — l’aspect d’une plante dans la fenêtre, si elle se penchait à gauche ou à droite — l’intéressait davantage que la grande forme. Mais il a aussi admirablement accompli la grande forme comme par exemple dans HEDDA GABLER5 où il avait construit un espace dément. Loepelmann était un sculpteur. Ainsi pour TEMPS DE GLACE6, le décor n’était constitué que d’un arbre énorme mais cet arbre, il l’avait construit de ses propres mains pendant des mois. À la fin, il avait l’air d’un arbre absolument naturaliste. Mais ceci n’était pas Le cas, c’était une grande œuvre d’art. L’esthétique de Loepelmann créait des espaces qui partaient d’un centre tel un soleil. C’était une période très belle et sauvage, car avec Loepelmann et Karsten Schälicke que j’avais fait venir comme peintre et dramaturge à Bochum, débutait à vrai dire mon travail sur Shakespeare. Schälicke, un ami de Minks, était venu une fois à Brême et m’avait montré quelques pages de Shakespeare qu’il avait traduites. Il ne parlait pratiquement pas l’anglais et sa traduction n’était pas littéraire mais rythmique ; grammaticalement c’était absurde. Mais il avait trouvé quelque chose pour Shakespeare qui m’avait toujours manqué dans les autres traductions : Le rythme et la sauvagerie. Avec lui j’ai mis en scène LE ROI LEAR7 et LE MARCHAND DE VENISE8. Si je jette aujourd’hui un coup d’œil sur ces traductions, je pense : Quelle trivialité ! Qu’on fut ravi de ça à l’époque ! Ensuite j’ai mis en scène OTHELLO9, LE CONTE D’HIVER10 à Hambourg et HAMLET11 à Bochum. Mes spectacles devenaient de plus en plus libres et s’étaient souvent beaucoup éloignés du texte de Shakespeare. Mais quelque part, j’avais trouvé un mélange entre la sorte de psychologie qui m’intéressait et une forme très libre et sauvage. Mes mises en scène de Shakespeare n’étaient jamais des interprétations, mais toujours des propositions qui, si on se laissait séduire, pouvaient apporter certaines choses, qui n’étaient pas de l’ordre de la compréhension.
Les années 70 ont été pour moi une période libératrice, décisive pour mon travail de metteur en scène. Je disposais soudain d’un espace de liberté que beaucoup de gens recherchaient à l’époque.
Tout ça s’est effondré à la fin des années 70 quand j’ai quitté Hambourg. Dans un premier temps, j’ai alors été un peu perdu. Le début des années quatre-vingt n’était pas une très bonne période pour moi. J’étais à Berlin — un endroit névrotique — et les mises en scène que je réalisais — à l’exception de GHETTO12 — étaient un peu curieuses. Elles avaient beaucoup affaire avec mon passé juif et les nazis, comme par exemple celle de CHACUN MEURT POUR SOI13, d’après le roman de Hans Fallada.
Au milieu des années quatre-vingt, j’ai été nommé directeur de théâtre à Hambourg. J’ai alors réalisé deux mises en scènes que je compte parmi mes travaux préférés : ANDI14 et LULU15. Ces spectacles étaient bien plus convainquants que LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE16 et COMME IL VOUS PLAIRA17.
Les années 90 sont pour moi plus difficiles à juger et à définir. Il me semble que chacune des mises en scènes réalisées ces dernières années est pour moi une expérience nouvelle et différente.
O. O.: Comment définissez-vous aujourd’hui le métier de metteur en scène ?
P. Z.: Ce que j’ai toujours considéré comme essentiel dans ce métier est la relation avec les acteurs. Pour moi, mettre en scène veut dire : dix acteurs et moi. Le reste : la scénographie, les costumes, la lumière, la musique jouent le rôle de complément.
J’ai actuellement envie de mettre en scène HAMLET et de partir en tournée à Strasbourg, Vienne, Berlin. Cet HAMLET n’est fait dans ma tête de rien d’autre que de quinze acteurs. C’est tout ce qui m’intéresse : travailler et partir sur la route avec des comédiens itinérants. Mais c’est extrêmement difficile à réaliser : comment convaincre les acteurs vedettes avec lesquels je travaillais dans les années 70 de partir et vivre ensemble ? Il existe un merveilleux livre d’Ivor Brown, un critique anglais très bon et conventionnel, dans lequel il décrit comment vivait la troupe de Shakespeare. C’est un de mes livres préférés, je l’ai lu très souvent et il m’a servi de modèle. De même le livre de Clurman sur le Group Theatre dans lequel il décrit comment, dans les années trente, un groupe d’acteurs, de metteurs en scène et d’auteurs comme Odets, Kazan et Strasberg menaient une sorte de vie de famille tout en réalisant une série de spectacles excitants comme par exemple GOLDEN BOY.
La plupart des metteurs en scène expliquent trop et veulent toujours recevoir des réponses. J’aime au contraire poser des questions. Je ne me vois pas comme un philosophe ou comme un médecin qui a des messages à prononcer. En tant que spectateur, je refuse que quelqu’un me fasse des exposés. C’est pourquoi je trouve MAHAGONNY — que je monte actuellement pour le Festival de Salzbourg —, très sympathique : c’est une pièce pleine de contradictions qui ne contient aucun message. Mais elle pose les bonnes questions sur notre société.
O. O.: Qu’attendez-vous d’un acteur ?
P. Z.: La première chose qui m’importe chez un acteur, c’est de savoir s’il met en mouvement mon imagination. J’en prends conscience dès les premiers instants. Et ça n’a rien à voir avec son talent. C’est très égocentrique mais c’est ainsi.
L’essentiel chez un acteur est le courage et l’impudence qu’il entretient vis-à-vis de lui-même. Qu’il soit prêt à utiliser tout se qu’il trouve en lui comme matériau et à le faire sans la moindre retenue. Ce qui présuppose évidemment aussi une sorte d’exhibitionnisme, mais le métier de comédien est de toute façon un métier exhibitionniste. L’acteur doit en outre avoir une très grande imagination tout à fait différente de celle d’un écrivain qui lui permette de s’identifier avec des personnages et des événements qu’il se représente. Il doit par exemple pouvoir s’imaginer qu’il marche sut la lune tout en développant les pensées Les plus complexes et les plus différenciées sur Proust. Et cela doit se faire sans le moindre effort. Wildgruber est en ce sens vraiment exemplaire, car si je dis à ce géant de s’imaginer qu’il est une petite fille mince de huit ans, il est absolument capable de le faire.
Ensuite, il faut que l’acteur soit prêt à me permettre de toucher son imagination et de la fixer. C’est ce qui est le plus difficile. Je crois que beaucoup de metteurs en scène ont peur d’un acteur comme Wildgruber, parce qu’il a une imagination énorme, débordante. Le metteur en scène se sent alors en position de faiblesse, parce qu’il a le sentiment que l’acteur fait des choses extraordinaires qui le mènent quelque part où il ne peut pas le suivre et ensuite, quand il veut que l’acteur le recrée, il n’arrive pas à le décrire et encore moins à le fixer.
Wildgruber a en outre un cerveau qui fonctionne comme un ordinateur hautement sophistiqué. Cela veut dire qu’on peut travailler avec lui de manière très, très détaillée, qu’au cours d’une semaine il produira quatre cents versions d’une même scène et que si plus tard on veut avoir une particule de ce qu’il a fait il y a quatre semaines, alors il peut le reproduire avec précision. Mais il ne le répétera pas seulement, il le reproduira, il Le revivra et il le mettra en relation avec tout ce qui se passe autour de lui et avec toute la pièce.
Ce qui compte aussi beaucoup c’est qu’un acteur puisse simplifier des choses très complexes sans les rendre simplistes. Gert Voss par exemple possède ce talent extraordinaire. Avec lui je peux m’aventurer dans les processus Les plus complexes et la version qu’il en donnera à la fin sera tellement simplifiée qu’elle sera compréhensible pour le spectateur sans pour autant être bête.
O. O.: Qu’est-ce que vous détestez le plus chez les acteurs ?
P. Z.: Je n’aime pas travailler avec des acteurs destructeurs qui détruisent leur entourage, qui me détruisent, qui détruisent la pièce, qui détruisent le public. Je n’aime pas travailler avec des acteurs agressifs. Je voudrais que les moyens avec lesquels je rencontre le public par l’intermédiaire des acteurs soient des moyens amicaux et non agressifs. Ce n’est pas toujours le cas. Pendant la période à Brême, par exemple, mes moyens étaient d’une agressivité assez prononcée. Je crois que plus je travaillais sur Shakespeare, moins mes spectacles étaient agressifs. Comme Tchekhov, Shakespeare aborde les hommes avec un grand amour, une grande vitalité et une grande curiosité. Accéder à ça pleinement ou en partie a toujours été, au fond, ce que je désirais.

O. O.: En repensant à vos spectacles, il me semble que vous cherchez à ramener l’acteur du côté de l’enfance, BR où prolifère la curiosité, l’imagination, la naïveté, le jeu et la pureté. Loin de tout professionnalisme.
P. Z.: Je ne sais plus qui c’était, mais quelqu’un a dit un jour que les meilleurs spectacles shakespeariens ont été réalisés par des amateurs. Shakespeare joué par des amateurs — cela m’a toujours énormément intéressé, de même que toute virtuosité m’a toujours ennuyée — de manière générale, pas seulement chez Shakespeare. C’est pourquoi je n’ai jamais aimé la célèbre mise en scène du SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ de Peter Brook : les acteurs y présentaient en effet sans cesse une virtuosité qui n’est pourtant pas celle d’artistes de cirque.
Gert Voss est par exemple un virtuose absolu, il sait tout jouer, il sait tout faire. Avec moi il est prêt à abandonner sa virtuosité. Lorsque j’ai travaillé la première fois avec lui il n’a pas du tout compris ce que je voulais de lui. Mais peu à peu il s’est intéressé à ce côté enfantin. Tous les artistes que je trouve formidables ont une nature enfantine très forte.
Je me rappelle par exemple comment Danny Kaye dans un one man show au Palladium à Londres s’est assis à un certain moment près de la rampe en sortant une boite d’allumettes de sa poche qu’il lançait à quelqu’un dans la première rangée de la salle qui la lui renvoyait ensuite. Il a fait ça pendant cinq minutes : jeter la boite d’allumettes et la rattraper, la jeter, la rattraper. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m’a tout simplement bouleversé comme tout le public qui était évidemment venu pour voit ses numéros virtuoses. Ou Laurence Olivier quand il découvre dans ŒDIPE qu’il a couché avec sa mère et commence à crier. J’ai oublié tout le spectacle, mais ce cri, je l’entends toujours. C’était comme un bébé qui crie quand on le frappe avec un croc à viande.
Ceci est évidemment très prononcé chez Shakespeare, car dans le théâtre élisabéthain tout le rapport entre l’acteur et le public avait une très grande simplicité. On disait ce qu’on pensait et c’était compris de cette manière ; on le disait aussi très vite, de sorte qu’il n’y avait pratiquement pas de temps pour y réfléchir. Un HAMLET intégral ne durait pas plus que trois heuresce qu’on peut s’imaginer difficilement aujourd’hui. Il ne restait pas de place pour faire de grands jeux psychologiques …Comme je vis à la fin du vingtième siècle, je ne peux me passer de jeux psychologiques. J’essaie toujours de relier l’inconciliable, la simplicité des Élisabéthains à la psychologie d’Ibsen ou de Tchekhov ; car on ne peut pas faire comme si on ne l’avait pas vécu. Il y a aussi très peu d’acteurs qui pensent, qui ressentent et qui changent assez vite pour concilier ces deux dimensions. Wildgruber et Voss réussissent tous les deux, chacun à sa manière. Les acteurs qui viennent de la R.D.A. savent aussi le faire, mais ils le font artificiellement. Ils ont appris à faire autant de ruptures que les grands acteurs dont je viens de parler, avec la seule différence que leurs ruptures proviennent de l’art et de la structure et sont donc totalement inintéressantes. Chez un acteur de la R.D.A., il doit y avoir une « conception » théorique juste et le lien avec la vie intérieure de l’acteur est absolument secondaire, alors que chez un acteur comme Gert Voss, il doit toujours y avoir une base psychologique, un point de départ pour une phrase ou une pensée ou un sentiment.
O. O.: Vous avez travaillé avec des acteurs allemands, français et anglais. Peut-on parler de spécificités nationales chez les comédiens ?
P. Z.: Évidemment. La différence entre un acteur de la R.D.A. et un acteur ouest-allemand ne se pose pas en termes de nationalité mais d’éducation. Je pense tout de même que le mélange d’est- et ouest-allemand produira dans une ou deux générations une troisième catégorie d’acteurs où en fin de compte les qualités analytiques des acteurs de la R.D.A. pourraient avoir de bons effets.
En ce qui concerne mon expérience parisienne — dans MESURE POUR MESURE19 en 1991 —, je dois dire que j’ai eu d’énormes difficultés avec les acteurs français que j’ai trouvés artificiels et rhétoriques. Isabelle Huppert était la seule qui n’était pas ainsi, parce qu’elle venait du cinéma. Cette drôle de manière de penser littéraire et théâtrale des acteurs français, ces élévations à la fin des phrases, tout ça m’est complètement étranger.
Chez les acteurs ouest-allemands avec qui j’ai travaillé le plus souvent, il existe évidemment beaucoup de problèmes, mais ce qui m’intéresse le plus chez eux, c’est leur introversion. Je trouve ça tout à fait merveilleux. Un acteur allemand préfère au fond les répétitions aux représentations. Un acteur anglais s’ennuie aux répétitions et ne comprend pas du tout pourquoi il n’y a pas déjà la première après trois semaines de répétitions. Dans son autobiographie LA LANTERNE MAGIQUE Ingmar Bergman raconte comment pendant les répétitions de HEDDA GABLER avec des acteurs anglais tout le monde avait déjà fini après trois semaines et lorsqu’il leur demandait comment est-ce possible, Laurence Olivier lui répondait : les acteurs désirent jouer devant le public et quand ils sont en face d’un public ils veulent travailler avec lui.
O. O.: Vous avez dit un jour qu’à un certain moment de votre travail théâtral les vieux acteurs (comme O. E. Haase, Hans Mahnke, Günther Lünders) vous ont particulièrement séduit.
P. Z.: Le théâtre est fait en grande partie de projections. C’était une période — le début des années 70 — où je faisais une projection sur mon propre vieillissement. J’ai mis alors en scène LEAR, TEMPS DE GLACE, PROFESSEUR UNRAT19— qui étaient toutes des pièces sur des hommes spéciaux. C’était une sorte de vécu et non de crise de l’âge moyen qui avait sans doute affaire avec Le fait que mon père est mort en 1970. Il avait atteint un grand âge et avait été un homme drôle et plein de vie que j’aimais beaucoup. Ma mère était déjà morte depuis dix ans. Mes parents étant morts, j’étais tout à coup leur unique héritier. Ça m’a certainement beaucoup préoccupé. À Brême j’ai travaillé avec grand plaisir avec un vieil acteur qui s’appelait Kastner. Ce n’était pas un acteur exceptionnel, mais le fait qu’il soit vieux, me fascinait. Il y a un côté intéressant chez les vieux comédiens, car ils savent qu’ils ne seront plus très longtemps sur scène et ils se disent alors : « si je ne laisse pas sortir les choses maintenant, je ne les laisserai jamais sortir ». C’est la dernière chance. Ensuite je pense avoir assez de talent pour traiter ces acteurs-là de manière à ce qu’ils se sentent bien. Je me suis toujours beaucoup occupé d’eux et je les ai aussi traités comme de vieux messieurs. Parce qu’on les a souvent traités — surtout dans le théâtre allemand — de manière grossière et irrespectueuse. Le vieux Shylock — Hans Mahnke —, qu’il ait été une projection de moi-même, on peut se l’imaginer aisément.
O. O.: On vous a reproché souvent d’exploiter les marottes, les lubies et Les bizarreries de vos acteurs et de les exposer de manière voyeuriste. Moi, j’ai plutôt l’impression que vous vous intéressez aux « folies » et aux manies de vos acteurs non pour les mettre à nu et les ridiculiser, mais au contraire pour atteindre leur noyau le plus individuel, le plus personnel. Beaucoup de vos acteurs semblent tirer leur force et leur énergie justement de l’inhabituel et de l’inégal et non du convenable et de ce qu’on appelle le bon goût.
P. Z.: Oui, c’est vrai. Dans les années soixante, je les ai en effet peut-être un peu exploités, mais c’était plutôt dû à ma maladresse qu’à mes intentions. Dans les années 70, c’était sans doute tel que vous le décrivez ; l’ensemble de Bochum était un ensemble de fous : les types les plus extravagants qu’on puisse trouver sut terre se retrouvaient tous à Bochum. Chaque jour y débarquait quelqu’un d’autre de bizarre, avec des cheveux verts, un anneau dans le nez ou autre chose en disant : il faut que j’y reste, il me faut travailler ici. Cela entraîne évidemment aussi un certain nombre de désavantages, parce qu’après un certain temps on ne peut plus faire quelque chose de normal.
J’ai toujours beaucoup aimé les gens extravagants et les marginaux. Le petit-bourgeois moyen ainsi que le théâtre petit-bourgeois, c’est ce que je déteste le plus. Lorsque l’oncle Vania commence à ressembler à un employé de banque hambourgeois, cela ne m’amuse pas du tout.
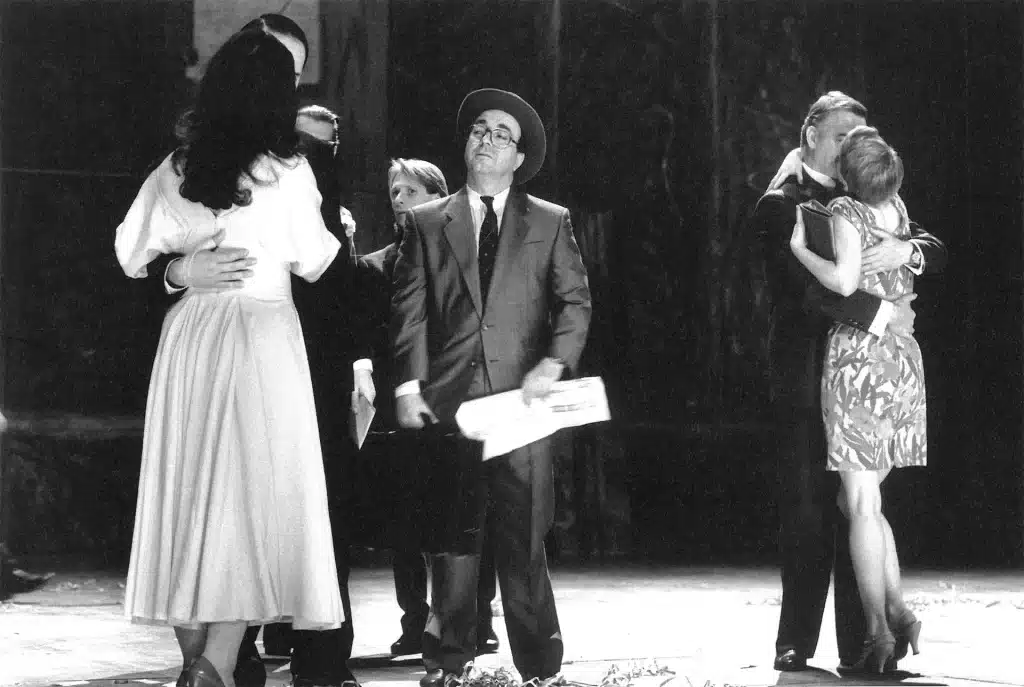
O. O.: On dit souvent de vos répétitions qu’elles se déroulent de manière très chaotique. N’existe-t-il pas alors le danger qu’un acteur fragile perde le contrôle de la situation et entre en crise, parce qu’il n’arrive pas à gérer cela ?
P. Z.: Oui, ça arrive souvent. Lorsqu’il s’agit d’un jeune comédien, c’est salutaire et lorsqu’il s’agit d’un vieux comédien, ce peut être très difficile, car j’exige d’eux qu’ils abandonnent leur maîtrise. Leur vanité en souffre, ils sont contraints de se remettre en question, car si ce que je fais est juste, alors ce qu’ils ont fait jusqu’à présent est faux.
Cela ressemble un peu à ma relation avec le public. Dans mes spectacles, je démontre avec beaucoup de conviction que le monde est ainsi, et si c’est juste, alors les spectateurs n’ont pas raison, parce qu’ils ont cru longtemps le monde autre.
Les spectateurs prétendent par exemple très souvent qu’ils n’entendent pas un de « mes » acteurs. À l’époque c’était Ulrich Wildgruber, aujourd’hui c’est Angela Winkler. Ils refusent de croire que quelqu’un puisse parler de manière aussi normale que ceux-ci le font. Les spectateurs sont encore très sensibles aux tabous du langage.
Lorsque pour LE MARCHAND DE VENISE21 j’ai travaillé pour la première fois au Burgtheater à Vienne, j’y ai amené Eva Mattes, non seulement pour qu’elle joue Portia, mais aussi pour montrer aux autres avec sa manière directe et sympathique comment il faut jouer ça. Et les acteurs, Gert Voss en particulier, ont été très attentifs. C’est pourquoi c’était merveilleux de l’avoir au Berliner Ensemble. Mais là c’était plus difficile. Même si les acteurs ont vu ce qu’elle faisait et comment elle le faisait, ils ne l’ont pas vraiment compris. Certains acteurs qui avaient travaillé pendant des mois étaient complètement perdus quand ils entraient sur scène. Car ils étaient habitués à avoir une conception de leur rôle qu’on peut noter et apprendre par cœur. Soudain ça n’existait plus. Ils venaient sur scène, devaient commencer et ne savaient plus quoi faire.
O. O.: Des acteurs comme Eva Mattes ou Ulrich Wildgruber ne sont-ils pas aussi vos représentants sur scène ?Car ils ne pensent pas seulement à leur rôle mais ils interviennent aussi d’une certaine façon dans le cours du spectacle.