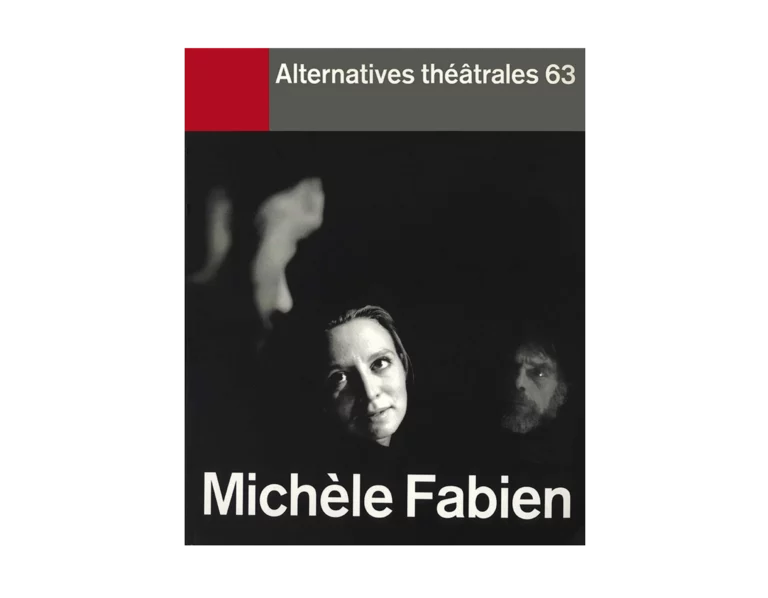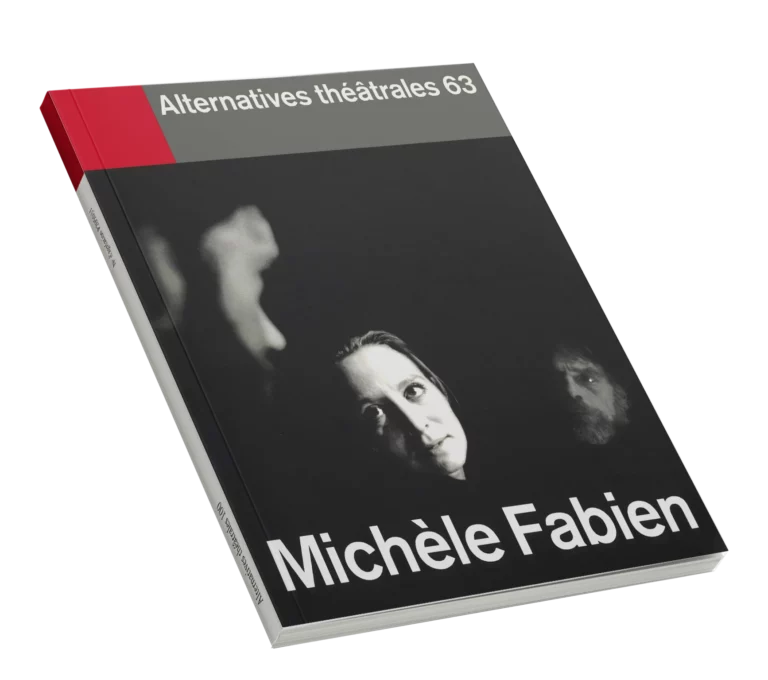CLAIRE, BERTY, CHARLOTTE, elles sont trois femmes qui ont occupé — un peu, beaucoup — la scène de l’Histoire. Elles reviennent sur la scène du Théâtre pour dire leur histoire à elles, une histoire dont on verra qu’elle leur fut en quelque sorte volée. Michèle Fabien a choisi d’assurer ainsi leur retour fantomatique dans trois pièces distinctes, qui leur sont dédiées dès le titre. Un seul et même modèle dramatique préside aux trois mises en œuvre. Ce modèle, Fabien y eut recours dès JOCASTE, mémorable moment de théâtre. Mais, en ce cas, elle touchait à un personnage tout nimbé de son appartenance mythique : Jocaste, mère et femme d’Œdipe, était toujours déjà un personnage de théâtre. Dans CLAIRE LACOMBE, dans BERTY ALBRECHT, dans CHARLOTTE1 , c’est bien autre chose2. Fabien s’y affronte à un réel historique dont le mythe ne s’est pas emparé et qui, d’être moins prestigieux et plus commun, n’en recèle pas moins une grande charge d’émotion.
Claire, Berty, Charlotte, trois femmes mais nullement quelconques. Dressées sur le plateau, seules ou presque en face de nous, fières, elles sont la Révolutionnaire, la Résistante et l’‘Impératrice. Revenantes donc et arrachées par la grâce d’une dramaturge à une Histoire trop silencieuse à leur propos. Trois spectres venus du royaume des morts et nous demandant compte de notre oubli. Car c’est bien comme telles que nous les percevons de prime abord. Et s’instaure de la sorte un rapport troublant, presque gênant, entre personnage et spectateur. D’une part, les trois héroïnes, récapitulant leur passé, vont se livrer de quelque manière à une confession. Elles s’y livrent sans complaisance mais non sans la jouissance de dire, de se dire enfin. D’autre part, toujours digne et noble, cette confession s’entend aussi comme acte d’accusation, dans lequel sera reproché à la postérité, aux spectateurs par conséquent, d’avoir manqué à cette justice élémentaire qu’est l’hommage de la mémoire à ceux qui ont contribué à faire l’Histoire.
Claire, Berty, Charlotte, trois femmes qui accusent et pourtant trois destins tellement dissemblables. Claire, petite comédienne montée de province à Paris, fut prise dans la tourmente révolutionnaire de 89. Elle fédéra des femmes pour qu’elles fassent entendre leur voix dans le grand avènement des temps nouveaux. L’ordre révolutionnaire la rejeta, voulant que ceux dont elle croyait partager la lutte, la jugent et l’’emprisonnent. Berty, grande bourgeoise d’opinion protestante, qui choisit tôt l’engagement et qui, pendant la deuxième guerre mondiale, fonda avec Henri Frenay et d’autres le groupe de résistance Combat. Elle devait en mourir, dénoncée, puis exécutée. Charlotte enfin, fille du premier roi des Belges, épouse de ce Maximilien, fils cadet de l’Empereur d’Autriche, qui gouverna la Lombardie, puis que des puissances européennes envoyèrent régner sur le Mexique dont il fut l’empereur. Charlotte se voulut politiquement active aux côtés de son mari et prit sa part dans telle réforme ou dans telle négociation diplomatique. Lui, finit fusillé par ses propres sujets, tandis qu’elle revenait en Belgique où, longuement, elle survécut dans un état de folie contracté tôt.
Claire, Berty, Charlotte, trois époques distinctes, trois classes distinctes, trois destinées distinctes. Mais ceci en partage : avoir agi sut un terrain réservé jusqu’à aujourd’hui aux hommes, celui du politique. Toutes trois ont empiété sur le domaine interdit, au moment où se produisaient des bouleversements laissant croire que les choses n’étaient plus comme avant, qu’une brèche s’était ouverte et que les femmes pouvaient partager l’action des hommes. Ainsi de la Révolution, ainsi de la Résistance, ainsi même de ce drôle de règne à vocation libératrice et sociale qui fut celui de Maximilien au Mexique. Mais l’Histoire s’est vengée de cette impertinence. Elle a censuré les trois intervenantes, en les renvoyant, avec leurs prétentions à s’engager, aux oubliettes. L’Histoire-mémoire ne faisait ainsi que confirmer le geste de l’Histoire-événement. Car déjà de leur vivant l’action des trois personnages s’est vue contrée, barrée. Le travail de dénégation est un travail ancien, en quelque sorte originel. C’est ce que relève Charlotte, dans la pièce la plus récente et à la faveur d’une réplique qui, de toute sa forme, dit combien la logique dénégative est récurrente et combien elle se boucle sur elle-même : « Tu es mon père qui dit non à mon nom, tu es Maximilien qui dit non à mon lit. Tu es Napoléon qui dit non à mon histoire. Tu es l’Histoire qui me dit non ! Mon histoire qui me bannit, et mon nom, et mon lit. Est-ce ma vie, cela ? »
Léopold Ier, Maximilien, Napoléon : le complot des hommes, des hommes d’une même femme. Donc Fabien féministe ? Gardons-nous de conclure trop vite. Là n’est pas, la visée première de son théâtre. La volonté initiale des trois pièces est de questionner le refoulé de notre mémoire, d’interroger trois « vécus » pour y voir ce qui s’y oblitère de la sorte. Par là, la dramaturge rejoint ce grand mouvement contemporain qui, sachant ce que dit l’Histoire, veut connaître ce qu’elle tait et qui s’avère être le symptôme d’un rapport de domination écrasant mais occulté. C’est donc sur un impensé qu’elle opère. L’intéressant est qu’elle n’y procède pas en historienne mais en auteur de fiction et de théâtre. Autrement dit, qu’elle demande à la fiction dramatique — une fiction dramatique qui sait, qui est documentée, qui cite les textes — de faire remonter sur la scène de l’imaginaire un passé enfoui dans son obscure vérité, avec ce que celle-ci pouvait avoir de contradictoire et de convulsif.
Or, s’il est ici question de femmes parce que leur sexe en général voit son histoire largement biffée, il arrive que certains hommes soient eux aussi, en raison de leur appartenance sociale, victimes de ce genre de censure. Écrivant ces pièces-ci, Michèle Fabien se réfère sans nul doute au travail de Jean Louvet, dont elle fut proche à l’Ensemble Théâtral Mobile. Dans CONVERSATION EN WALLONIE comme dans L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE, Louvet convoque aussi des revenants. Son propre père prolétaire dans le premier cas — et c’est toute une classe ouvrière qui s’y donne à lire — Julien Lahaut dans le second. Là encore, la projection fictionnelle est comme une descente dans un passé collectif scandaleusement barré.
Mais revenons à Claire, Berty et Charlotte. Témoignant sur elles-mêmes, elles ne dédaignent pas l’emphase. Tout intimisme de la parole serait une nouvelle concession. Elles parlent haut et net, reprenant les faits en récit quand cela s’avère utile. Mais elles ne conçoivent pas leur témoignage en plaidoyer. Nous les voyons qui acceptent d’avouer leurs contradictions ou encore qui ne retrouvent le passé qu’en brèves échappées, loin d’une trop stricte cohérence. Elles n’entendent pas reprendre à leur compte cet ordre du discours qui est celui des « maîtres », de ceux qui font et écrivent l’Histoire et Les ont exclues de toujours. Elles cassent donc le flux discursif et optent pour une figuration fractionnée ou elliptique des événements, au gré de la démarche mémorielle.
La vertu de ce fractionnement est de laisser passer la violence qui sourd des trois rôles. Les revenantes ont certes, et pour cause, quelque chose de fantomatique. On ne peut se le dissimuler, elles sont dans le manque et dans la perte. Mais aucun gémissement maeterlinckien toutefois. Elles témoignent avec douleur mais aussi avec force, une force qui vise à l’efficace. Il y a chez Michèle Fabien un surgissement de la parole qui scande les mots, frappe la formule, lance le cri ou l’anathème et qui est sans doute l’une des marques politiques de son théâtre. En même temps, cette force, qui est du corps et de la voix, reste maîtrisée. De façon soutenue, les personnages de Fabien nous font douce violence. Écoutons parler Berty Albrecht de la façon dont elle a perçu les débuts de la guerre :
«Et moi, dès juin 40, c’est leur gentillesse que je n’ai pas pu supporter. Les bruits de bottes, les ordres en allemand, les fusils que l’on arme et qui claquent, ça va, on sait, c’est clair, c’est l’ennemi. On se hait, on se bat, c’est normal.
Mais cette paix gluante qu’ils nous imposent, leur gentillesse parfaite, leur bonne éducation, c’est cela qui fait mal. Quand ils font croire qu’ils sont comme nous, simplement des soldats, des vainqueurs, alors que tout est faux et qu’ils sont à genoux devant Hitler. Des nazis. »
Si Le ton garde cette fermeté mesurée, c’est que les revenantes ne réclament pas justice à proprement parler. Elles veulent avant tout nous dire comment c’était, ce qu’elles ont vécu. Avec la volonté qu’à travers leur exemple nous apprenions à mieux déchiffrer l’Histoire, à voir où étaient vraiment les rapports de force, à ne pas céder aveuglément aux représentations mythifées. C’est en ce sens que l’on peut parler d’un théâtre citoyen. Théâtre d’alerte, qui met en garde contre les fauxsemblants du discours ordinaire et refuse l’action de la machine à décerveler. Au moment où, en Belgique, la médiatisation d’un mariage princier incite une population à l’hystérie de circonstance, il est bien qu’une pièce comme CHARLOTTE s’écrive et soit jouée, pour nous rappeler que, derrière la façade trop lisse des palais et des beaux mariages, les familles royales cachent à l’occasion dans le placard quelque folle ou quelque folie.