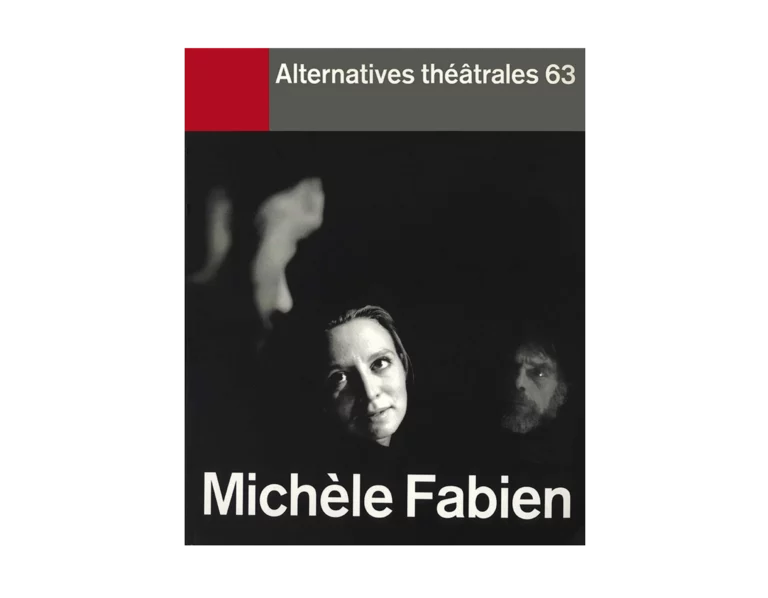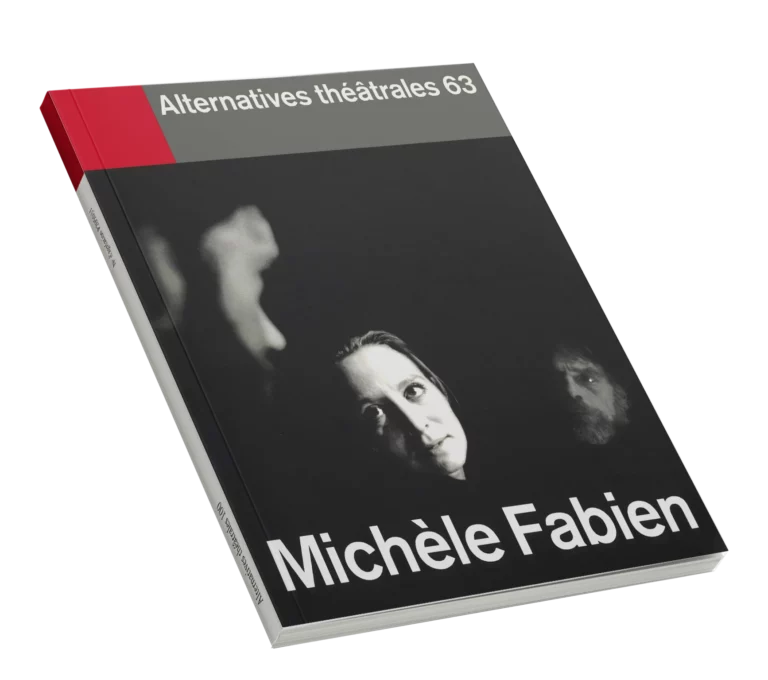Après l’avoir été au Théâtre National de Strasbourg auprès de Jacques Lassalle, ainsi qu’auprès de Philippe van Kessel au Théâtre National de la Communauté Française de Belgique, Yannic Mancel est aujourd’hui conseiller artistique et littéraire auprès de Stuart Seide au Théâtre du Nord à Lille et Tourcoing. Il enseigne la dramaturgie et l’histoire du théâtre dans les universités de Lille III et Dunkerque. Il est membre du comité de rédaction d’Alternatives théâtrales.
JULIE BIRMANT : Dans quelles circonstances as-tu été amené à côtoyer le travail de Michèle Fabien ? Comment l’auteur et le dramaturge de l’E.T.M. envisageait, vivait le moment des répétitions ? Intervenait-elle ?
Yannic Mancel : J’ai connu Michèle Fabien assez tardivement, au début des années 90. Je l’ai rencontrée quand je suis venu m’installer à Lille car elle développait avec Marc Liebens à cette époque-là un partenariat avec la Rose des Vents, la scène nationale de Villeneuve d’Ascq.
Le premier travail que j’ai côtoyé était celui qu’elle a fait avec Marc Liebens sur LA VILLE de Paul Claudel. Elle en était la dramaturge. Je l’avais invitée dans un cours public à l’Université, pour parler de son travail sur la pièce. La relation ambivalente qu’elle entretenait avec le théâtre de Claudel m’a par la suite éclairé sur un certain nombre de contradictions qu’elle cherchait à approfondir et à exacerber dans son propre travail. Notamment celle de la confrontation d’une forme lyrique, poétique, à la question du politique, qui est présentée dans LA VILLE d’une façon assez désespérante et négative. Le premier texte personnel de Michèle Fabien que j’ai découvert, c’est ATGET ET BERENICE, d’abord à la Rose des Vents puis au Théâtre National où j’entamais ma première saison en tant que conseiller artistique. Cette pièce est une fiction documentaire. À l’origine, se trouve un matériau constitué par un travail de dramaturgie et de documentation qui était ensuite entièrement refondu dans un travail artistique de fiction. Ce que je trouve remarquable dans l’écriture de Michèle Fabien, c’est Le rapport entre l’extraordinaire précision documentaire de ses sources, qu’elle accumulait dans le travail préalable, et le jaillissement tout à fait spontané d’une écriture personnelle qui se réapproprie cette matière et qui en fait un objet de fiction original, artistique, littéraire, dans lequel elle parvient à projeter son intimité, ses propres fantasmes, sa subjectivité d’artiste et de femme. Il y a peu d’auteurs qui réussissent à écrire des fictions documentaires qui soient aussi des œuvres originales ; celles que j’ai pu lire sont souvent laborieuses, techniques, didactiques, pédagogiques, et n’ont pas cette grâce littéraire par laquelle sont portés les textes de Michèle.
C’est pourquoi j’ai toujours imaginé qu’elle travaillait toujours en deux temps : dans la première moitié du travail, elle devait avoir une activité de dramaturge, comme si ça avait été au service d’un metteur en scène, sur un texte ou une fable déjà établis, et dans un deuxième temps, elle devait faire table rase de tout ça, et restituer ce matériau avec cette espèce de virginité qu’elle savait retrouver à chaque fois.
J’ai côtoyé Michèle Fabien un peu plus directement au moment de DÉJANIRE. Pendant les répétitions, elle était une observatrice assez distante du travail de Marc. J’ai eu l’impression qu’elle se dépossédait assez facilement de son texte, du moins en apparence. Je ne pense pas qu’elle ait eu sur ses propres textes le désir d’assumer une présence dramaturgique très vigilante, de chaque instant, ni a fortiori un désir de co-mise en scène. Je crois qu’elle a toujours assumé sa fonction d’auteur, d’auteur présent aux répétitions, disponible à répondre aux questions et à prodiguer des conseils, mais pas réellement intervenant ni contraignant.
J. B.: Tu as pu assister au travail de Michèle Fabien adaptatrice et du metteur en scène Marc Liebens sur l’AMPHITRYON de Kleist. Quelles sont les raisons qui ont amené Michèle Fabien à réécrire la pièce ?
Y. M.: Plus exactement, j’ai suivi la reprise du spectacle en deuxième saison au Théâtre National. L’axe dramaturgique essentiel de sa vision de l’AMPHITRYON de Kleist comme de celui de Molière était celui d’une Annonciation. Elle a toujours cherché à rapprocher le mythe grec d’Héraklès du mythe chrétien de la naissance de Jésus. Il était clair que ces deux mythes se superposaient et qu’il fallait offrir aux spectateurs une lecture à plusieurs niveaux d’interprétation ; et cela, sans volonté de distorsion, sans chercher à faire entrer un mythe dans un autre. En même temps que l’on retrouvait très précisément dans son adaptation le mythe antique d’Alcmène, Amphitryon, Zeus et de la naissance d’‘Héraklès, on était amené à lire cette histoire comme une préfiguration archaïque — très présente dans notre inconscient collectif — de la fable de Marie, de Joseph, du Saint Esprit et de la naissance de Jésus.
Ensuite, comme dans toutes ses pièces, Michèle Fabien a pratiqué ce que j’appelle le « décentrement », une caractéristique de la relecture renouvelée des mythes et des classiques — qu’elle partage avec d’autres auteurs ou metteurs en scène de son temps (Planchon, Lassalle, Vincent, Müller.) — et qui consiste en l’occurrence à accorder la priorité de l’éclairage et du regard à Alcmène, à la femme. Ce qui nous amène à une dimension très importante de l’écriture de Michèle Fabien : c’est une des plus belles écritures féminines — et je préfère dire féminine plutôt que féministe, même si derrière le féminin, le féministe n’était jamais loin — qui ait relu les grandes fables fondatrices à partir du regard subjectif de la femme. Et pas toujours de la femme attendue. Une des raisons, je crois, pour laquelle elle a écrit DÉJANIRE, est que, dans la tradition, le destin de ce personnage est un peu oublié par rapport à celui de Médée, par exemple. Elle aimait ce genre de réhabilitation. C’était peut-être une manière de combattre une sorte d’injustice. Et cela explique aussi l’intérêt qu’elle portait à la CASSANDRE de Christa Wolf…
J. B.: Sauf que Michèle Fabien ne rebaptise pas son adaptation d’AMPHITRYON : ALCMÈNE.
Y. M.: Non, et je crois que si elle a gardé le titre de Plaute, Molière ou Kleist, c’est par respect du public, par souci de son élargissement et de son « éducation » critique. Pour inciter le public à venir voir cette nouvelle lecture d’AMPHITRYON et le surprendre. Je crois qu’elle aimait bien aussi risquer une certaine déception des attentes du public, mais une déception compensée par un regard neuf. C’est un peu l’enjeu de ce que j’appelle le « décentrement » : on privilégie un personnage demeuré secondaire dans la tradition et on reconstruit la fable autour de lui. Racine n’a rien fait d’autre en décentrantrecentrant la légende traditionnelle d’Hippolyte et de Thésée sur le personnage de Phèdre.
J. B.: DÉJANIRE est à ton avis un des plus beaux textes de Michèle Fabien. Le spectacle était décevant. Vous en avez parlé. Quelles sont les questions qui ont été soulevées ?
Y. M.: Michèle et Marc font partie de ces artistes qui m’ont le plus ému par leur probité intellectuelle et par leur capacité d’autocritique. Je ne sais pas si c’est lié à une sorte d’éthique, mais ils étaient, à l’égard de leur propre travail, d’une exigence, d’une absence d’indulgence et parfois même d’une cruauté surprenantes. Jamais la moindre complaisance sur un objet qu’ils venaient de réaliser. Quand il y avait des insatisfactions, des échecs partiels, ils en parlaient avec une franchise tout à fait déconcertante. Et il est vrai que nous avons beaucoup parlé de nos frustrations à propos de DÉJANIRE, un sentiment d’incomplétude face au résultat du spectacle. D’ailleurs je crois que c’est la raison pour laquelle au Plan K, Marc Liebens et Michèle ont voulu rectifier le tir avec CASSANDRE, où les seuls éléments scénographiques évoquaient un jardin zen, de même qu’avec UNE PAIX ROYALE au Marni où l’espace était également très neutre et très dépouillé. L’écriture de Michèle est à mon sens une écriture de plateau nu qui ne supporte pas l’encombrement d’une scénographie trop signifiante. J’avais eu déjà la même sensation à propos d’ATGET ET BERENICE. Je trouvais que cet écran de Plexiglas — une présence matérielle très forte — entre le public et les acteurs, était un élément scénographique trop fort, trop présent ; même s’il renvoyait au cadrage de la photo, à l’objectif photographique, à la matière transparente qui isole l’appareil de la réalité, et s’il y avait sans doute beaucoup de bonnes raisons dramaturgiques. Cet écran nous isolait de la chair des acteurs et, par le fait, les désincarnait. Je pense que ce n’était pas juste. Car s’il y a bien une écriture féminine charnelle dans le paysage théâtral francophone, c’est bien celle de Michèle Fabien. Dans DÉJANIRE, c’est le damier au sol et la présence de loges, celles d’un théâtre inversé, qui étaient très encombrants. C’étaient des signes trop forts par rapport à la pureté, à la transparence des textes de Michèle. Ce qui faisait, je pense, la grande réussite d’AMPHITRYON, c’était que les acteurs étaient très proches du public, et parlaient dans un couloir dépouillé, délimité par une charpente en bois tendue de bâches. Le rapport direct, confidentiel, intime qu’on avait avec la chair et Le souffle des acteurs correspondait très bien à la sensualité du propos de la pièce de Michèle. L’écriture de Michèle stimule tellement l’imaginaire du spectateur que si l’on superpose cette production très forte d’images, très excitante, à des dispositifs scénographiques trop ostentatoires, on risque à chaque instant de produire un effet de pléonasme où le texte, comme la scénographie, est toujours perdant.