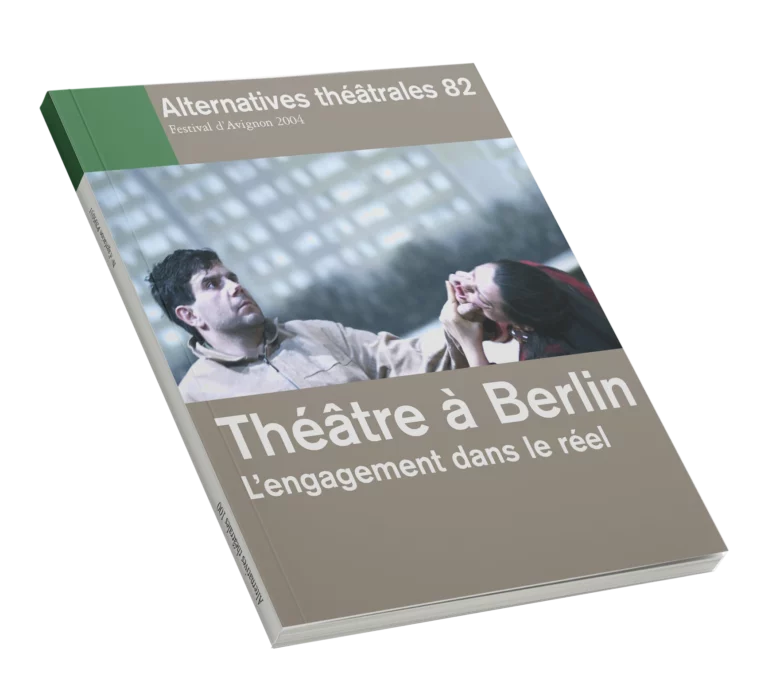« NOUS REGARDONS ce monde qui caresse notre désir d’ordre et de moralité puis nous nous rendons compte que ce puritanisme, ce système basé sur une forme d’ordre idéologique et religieux du capitalisme, est troué comme une passoire par l’irrationalité, la violence et les pulsions sexuelles. »
Ce constat a amené Frank Castorf à choisir des auteurs engagés, enragés et courageux comme compagnons de travail, s’appuyant sur eux pour creuser son sillon, pour développer une double confrontation : avec lui-même en revendiquant un théâtre profondément autobiographique, et avec la complexité du monde pour éclairer les rapports de force idéologiques, politiques, économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés en ce début de XXIe siècle. Après Dostoïevski, O’Neill, Tennessee Williams, Boulgakov…, il s’intéresse à l’auteur italien ( jamais traduit en français) Pitigrilli et à son roman COCAINA.
COCAINA est l’un des quarante ouvrages de cet auteur (né en 1893, de son vrai nom Dino Segré), publiés entre 1920 et 1975. Il fait partie d’une première série de publications aux titres aguichants, coquins et sulfureux : MAMMIFÈRES DE LUXE, LA CEINTURE DE CHASTETÉ, OUTRAGE À LA PUDEUR, LA VIERGE DE 18 CARATS, qui ont fait de ce journaliste de profession un auteur à la réputation incandescente avant qu’il ne change de style à partir des années trente ( il développera alors un scepticisme laïque) pour terminer, après la Seconde Guerre mondiale, par un retour aux valeurs du catholicisme traditionnel. Romans, nouvelles, mémoires, aphorismes et poèmes constituent une œuvre dont Umberto Eco dira qu’elle est tout à la fois « agréable, savoureuse, rapide et foudroyante ». Très proche de la littérature « de gare » à la française, type Maurice Dekobra et sa MADONE DES SLEEPINGS, toujours rangée dans le rayon « enfer » des bibliothèques familiales de la bourgeoisie cultivée européenne, l’œuvre de Pitigrilli fut traduite en Allemagne dès les années vingt ( COCAINA fut même interdit aux moins de 18 ans jusqu’en 1988…).
Politiquement controversé, Pitigrilli reçut le soutien de Mussolini qui lui écrira : « Vous n’êtes pas un écrivain italien, vous êtes un écrivain français qui écrit en italien », ajoutant : « Pitigrilli n’est pas un écrivain immoral, il photographie son époque. Si la société est corrompue, ce n’est pas de sa faute. » Il fut cependant interdit par la censure qui officiellement le considérait comme un opposant aux valeurs morales et idéologiques mises en avant par le régime fasciste et dut s’exiler en Suisse après l’adoption des lois antisémites en 1938, ce qui n’empêcha pas les résistants anti-fascistes de l’accuser d’avoir été membre de l’O.V.R.A., la redoutable police secrète fasciste.
Toute son œuvre est empreinte d’une froideur ironique, sceptique et distanciée, cultivant les paradoxes, d’un esprit corrosif en lutte contre tous les faux-semblants. Admirateur de Voltaire, Barbusse, Wilde et flaubert, ce provocateur avait pour devise : « À la bêtise de mon parti je préférerai toujours l’intelligence du parti adverse. » Son roman COCAINA raconte, en quatorze chapitres, l’histoire de Tito Arnaudi, étudiant en médecine de Turin, qui, ayant arrêté ses études, vient vivre à Paris, la moderne Babylone des années vingt. Installé dans un hôtel borgne de Montmartre, il s’incruste dans la vie de bohême jusqu’au jour où il devient, par hasard, journaliste. Son rédacteur en chef lui confie un reportage sur « la captivante coco » et sur le milieu des cocaïnomanes. Son article est un succès, il gagne beaucoup d’argent et s’installe dans un grand hôtel de la place Vendôme. Commence alors pour lui « la bohême chic », entre « messes blanches » et partouzes lascives, interrompues par la rédaction de quelques articles, la vie superficielle et décalée d’un journaliste mondain qui plonge dans la drogue et perd « toute pudeur et toute volonté ». Ayant retrouvé une ex-maîtresse turinoise, Maddalena, secrétaire sténodactylo devenue danseuse mondaine sous le nom de Maud, il mène une vie de débauche entre elle ( qui se prostitue relativement facilement pour de l’argent ou pour le plaisir) et une richissime Arménienne, mariée à un capitaliste du pétrole originaire du Caucase, qui dépense sans compter pour organiser des parties fines, totalement « cocaïnées » et « éthérées », où Tito rencontre le gratin de la société intellectuelle et culturelle parisienne. Choisissant l’amour de Maud qu’il surnomme « sa Cocaïne », il part avec elle en Argentine pour une tournée « artistique », fréquentant toujours les milieux interlopes, cosmopolites et dévergondés jusqu’à ce qu’il se lasse d’elle devenue « vieille et grosse » à 24 ans… De retour à Turin, il reçoit une lettre de Maud qui l’invite à la rejoindre à Dakar… ce qu’il fait car son amour pour elle est le plus fort. Après une ultime représentation du ballet de Maud « sublime- ment belle », ils font l’amour « violemment » près de la voie ferrée où passe à vive allure « le grand express de l’Afrique occidentale ». Tito propose alors à sa Maud- Cocaïne de rester avec elle pour toujours à condition qu’elle ne le trompe plus, ce qu’elle refuse, préférant être seule que de renoncer aux « plaisirs variés » de la chair. Tito revient alors pour la seconde fois à Turin et décide de faire un ultime bilan : « J’ai tout essayé dans la vie : l’amour, le jeu, les excitants, les hypnotiques, le travail, l’oisiveté, le vol. J’ai vu les femmes de toutes les races et les hommes de toutes les couleurs. Il n’y a qu’une chose que je ne connais pas encore : la mort. Je veux la provoquer…» Il décide donc de se suicider mais en laissant une part au destin qui voudra peut-être le sauver. Il avale donc « des bacilles du typhus » puis consulte des médecins dont l’incompétence le fera mourir dans « un bain glacé ».
Œuvre d’un cynique maudit et libertin, COCAÏNE est surtout devenu un document historique aux relents « véristes » et « d’annunziens ». Le vice y est toujours dépeint d’une façon ambivalente, à la fois excitant et destructeur. Pitigrilli chatouille son lecteur là où ça fait du bien tout en cherchant à provoquer le dégoût, dénon- çant ce monde interlope et nihiliste mais en distillant toujours un sentiment d’attrait pour ces interdits moraux étalés à pleines pages. Il décrit des personnages qui perdent leur volonté et se laissent guider uniquement par leurs sens, glissant vers la mélancolie puis le désespoir devant une vie inutile où l’homme devient malléable, docile et asservi.
De cette matière romanesque ( dont on dit que Fassbinder voulait faire un film juste avant sa mort), Frank Castorf a conservé les protagonistes essentiels ( Maud, Tito, l’Arménienne Kalatan Ter-Grégorian, le rédacteur en chef du journal, l’ami journaliste) et quelques figures hautes en couleur. Il garde un semblant d’intrigue et quelques parties dialoguées du roman, comme un metteur en scène Petit Poucet qui laisserait quelques traces, quelques cailloux aux spectateurs tout en les entraînant dans son propre univers, dans ses propres fantasmes, dans son propre délire.