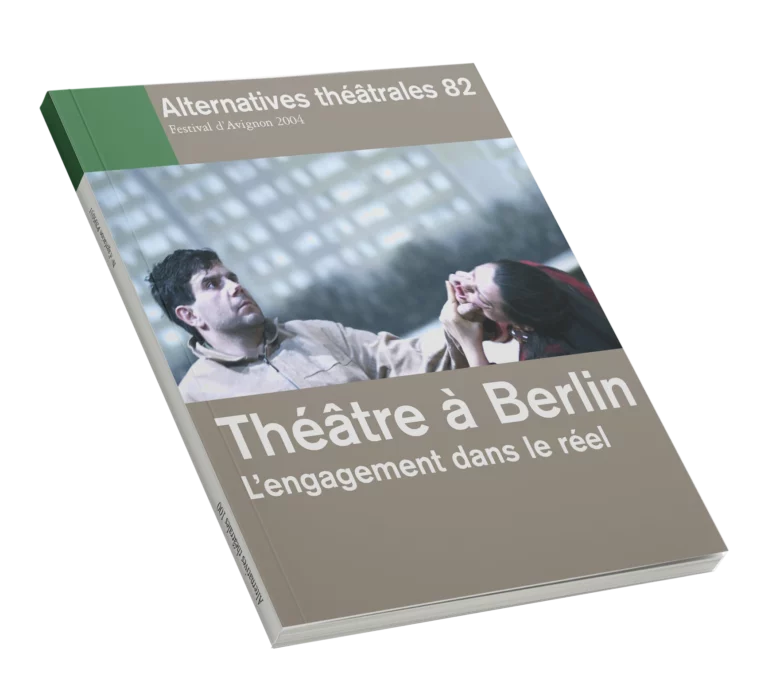IL EST IMPOSSIBLE de mettre tous les jeunes metteurs en scène allemands dans le même sac. Une telle affirmation ressemble peut-être à une fuite. Pour la justifier, j’énumère tout simplement les noms de quelques metteurs en scène et leur attribue une caractéristique sous forme de thèse : Michael Thalheimer ou l’abstraction par images fortes, Simone Blattner ou la mise en scène du pouvoir féminin, Armin Petras ou la nostalgie mélancolique tellement humaine de l’Allemagne de l’Est, Stefan Pucher ou la transformation de la scène en écran vidéo, René Pollesch ou les conséquences catastrophiques de la mondialisation, Falk Richter ou la citation pop, Stefan Kaegi ou le théâtre en dehors du théâtre, Thirza Bruncken ou « je peux aussi faire des mises en scène tout à fait classiques », Christian Paulhofer ou « glamour » et chute, Thomas Ostermeier ou « le réalisme se cache encore dans chaque pièce », Stefan Kimmig ou la peur bleue du faux ton, Tom Kühnel ou le plaisir de jouer avec des marionnettes, Robert Schuster ou la recherche de la grande vision du monde, Nicolas Stemann ou « le cercle vicieux de la politique », Ingrid Lausund ou « on peut improviser sur tous les sujets ».
Ils font tous partie de la soi-disant jeune génération de metteurs en scène en Allemagne qui ont envahi les théâtres. Mais que veut dire jeune, au fond ? Bien qu’une réponse à cette question soit difficile à trouver – et surtout pour soi-même –, dans le cas présent, elle est facile à donner : je pense qu’aujourd’hui, est jeune, et pas seulement dans le théâtre allemand, celui qui n’a pas encore atteint l’âge de quarante ans.
La pop
La question est probablement décisive pour l’appréciation du jeune théâtre allemand en général : quelle signification faut-il attribuer à la musique pop dans le théâtre allemand ? Je commencerai par une observation toute simple : je m’étonne régulièrement de découvrir l’énorme connaissance des metteurs en scène en musique pop. Il y a des représentations où à chaque tournant dramatique, on entend la chanson adéquate, et c’est surtout frappant pour les mises en scène des auteurs classiques. Et cela ne se passe pas seulement lorsque le metteur en scène est lui-même musicien, comme par exemple Stefan Pucher, mais cela devient presque contraignant, même pour les metteurs en scène plutôt conventionnels. Ce qui est certain – et cela me semble être le point le plus important – c’est que les metteurs en scène allemands s’y connaissent admirablement bien en musique pop. Et on a parfois l’impression que certains trouvent plus important de mieux connaître les chansons de Madonna ou de Radiohead que les textes de Lessing et Schiller.
Ensuite, je constate qu’en pénétrant dans les théâtres allemands, la pop produit presque toujours une certaine attitude face à la matière, à la pièce. Certains caractérisent cela de subversion affirmative. La subversion affirmative signifie à peu près ceci : puisqu’on sait que les choses ne peuvent pas être changées par le biais de la critique, puisqu’on sait qu’une position qui se situe en dehors des situations est difficilement définissable, puisqu’on déteste se placer au-dessus du drame, du vrai et du vécu ou de celui de la pièce de théâtre, puisqu’on considère une telle attitude comme peu digne de foi, hybride et contraire au plaisir, on ne prend aucune position de supériorité. On ne veut pas de position souveraine, raisonnable, on veut être de ce monde où l’on vit, on veut se placer là où on voit la pop. Il n’y a donc pas de sens que le metteur en scène connaîtrait et que le spectateur devrait saisir, et il n’y a certainement pas de message. On met en scène les circonstances à hauteur des yeux du spectateur et on met tout en œuvre pour ne pas se surélever. Si l’on aborde le drame sous cet angle, on ne peut qu’être un arrangeur de matériaux, et l’acteur non plus ne peut se soumettre à la volonté du metteur en scène. Tout cela se cache derrière mon affirmation.
Ensuite, on avance d’un pas et on essaie de pousser les choses, les situations dans la pièce au-delà de leurs frontières. Le moyen le plus facile, pour ce faire, c’est de les simplifier, comme le fait par exemple Michael Thalheimer. On peut les pousser vers l’absurde, comme le font presque tous les metteurs en scène de temps en temps. On peut tenter de les faire se démasquer mutuellement, ce qui semble toutefois assez difficile à réaliser. On ne se place donc pas au-dessus des situations, on essaie de les faire éclater de l’intérieur, de les rendre visibles et de les pousser à l’extrême. Dans la plupart des cas, on adopte une attitude ironique et la chanson pop sert souvent à exprimer cette attitude ironique. Celle-ci, ou, pour le dire autrement, cette attitude de rupture, est supposée exprimer la subversion. Mais si cela est le but, ce n’est qu’une faible sorte de subversion. Cette subversion n’est plus qu’une affirmation de soi, une sorte d’autonomie ou de liberté passagère par rapport au contenu dramatique de la pièce. C’est probablement Stefan Pucher qui a visualisé le plus efficacement cette attitude fondamentale du théâtre pop. Toutes les tentatives d’échapper à la situation ressemblent chez lui à des souvenirs du bon vieux temps, chargés de la mélancolie de celui qui sait qu’il a échoué.
Cette attitude d’affirmation subversive n’est pas vraiment un phénomène nouveau. Carl Hegemann, dramaturge et philosophe à la Volksbühne de Frank Castorf à Berlin, l’a déjà décrite :
« Dans notre société de consommation, on assiste à un renversement paradoxal du sens de la critique et de l’affirmation. Lorsque nous critiquons le capitalisme et que nous trouvons ses effets négatifs, nous l’affirmons en même temps. Car il ne fonctionne que grâce à l’innovation, et l’innovation naît de la critique et de la négation de l’acquis. Mais si nous l’affirmons, nous

sommes peut-être subversifs puisque nous lui retirons son suc vital, c’est-à-dire la critique. C’est Marx lui-même qui supposait qu’on pourrait arriver à faire danser les situations en leur jouant leur propre mélodie. Une attitude très affirmative par rapport à la constitution, par exemple, est automatiquement subversive. Le personnage de la critique conduit automatiquement vers celui de l’autocritique. L’affirmation et la critique changent de position. Comme Heiner Müller le savait déjà, « la critique rationaliste est pratiquement la chose la plus inoffensive que l’on puisse faire ». On est confronté aujourd’hui lors de chaque intervention critique à cette étrange ambivalence. La critique se transforme immédiatement en affirmation, alors que l’affirmation peut gagner un pouvoir subversif insoupçonné. Ce n’est pas un phénomène nouveau. Ce ne l’était déjà plus lorsque nous avons commencé à la Volksbühne il y a dix ans. La « théorie critique » de l’école de Francfort avait été délogée par la formule antithétique « subversion par affirmation ». New wave et culture pop étaient là aussi et le fait qu’on mettait enfin des vêtements chics à la mode, tout cela était une sorte de surenchère de la critique devenue la forme routinière de la critique. »
Mais visiblement, le théâtre allemand éprouve des difficultés à quitter ce cercle vicieux. Car depuis longtemps, il a perdu effectivement une bonne partie de son potentiel critique.
Alors qu’il est toujours au centre des discussions sur la perte de l’héritage classique, qu’on l’accuse d’être superficiel et inculte, le théâtre pop garde l’étiquette de la citation. Des particules de la scène techno, de la vie des clubs, des expériences de la drogue, de la vie des marques, des films ou de la publicité envahissent le théâtre. Et pourtant, il y a peu de vraies pièces de théâtre qui soient nées de ces expériences. Peut-être en ai-je vu chez Falk Richter, Stefan Pucher, Christina Paulhofer ou bien Simone Blattner, mais fondamentalement, la pop ne semble être que citation, pas un monde propre à partir duquel on pourrait mettre en scène une vraie pièce dramatique.
Les pères
Rien n’est plus nuisible au théâtre que la discussion sur les générations qui dure depuis maintenant dix ans. Il y a deux ans, elle prenait un nouvel élan lorsqu’on voulait chasser Stefan Bachmann et Christoph Marthaler de Bâle et de Zurich parce qu’on avait l’impression d’avoir affaire à une jeunesse sauvage, superficielle, à des morveux épris de pop et oublieux des traditions. En même temps, les « vieux » metteurs en scène tels que Bondy, Zadek, Peymann étaient à nouveaux les chéris des critiques aussi vieux qu’eux qui déclaraient que tous les jeunes étaient plus ou moins des crétins.
Malheureusement, la discussion sur les générations dans le domaine théâtral a été lancée par les pères, parce qu’ils avaient une expérience comme génération, qu’ils s’entendent comme telle et attendent maintenant la même chose des fils. Les jeunes ne s’en sont pas encore remis. Les attentes se sont transformées en une sorte de contrainte d’innover à tout prix ce qui fait de la jeunesse depuis plus de dix ans la marchandise la plus recherchée des théâtres. Dans aucun autre domaine on ne trouve ce battage médiatique qui donne aux metteurs en scène, à l’âge de trente ans, déjà l’air de petits vieux.
Les jeunes dirigent depuis longtemps quelques-uns des plus grands théâtres de langue allemande : Thomas Ostermeier à Berlin ou Matthias Hartmann à Bochum, alors que Stefan Bachmann vient déjà de quitter Bâle et que d’autres directeurs ( Wilfried Schulz à Hanovre, Christoph Marthaler à Zurich, Tom Stromberg à Hambourg, Frank Bambauer à Munich et Elisabeth Schweeger à Francfort) se considèrent comme les gardiens de la jeunesse. Ainsi les jeunes atterrirent, à un âge où d’autres coulent encore une douce vie de rêves, d’une façon assez brutale, sur le sol ingrat de la réalité face à l’utilisation de l’espace scénique.
Le vrai père du théâtre allemand contemporain est pourtant quelqu’un qui ne conduit pas la discussion sur les générations : Frank Castorf. Pour tous ceux qui allaient au théâtre en Allemagne dans les années quatre- vingt-dix et qui s’intéressaient en plus aux questions esthétiques et sociales, Castorf était incontournable, et ses grosses farces qui coupaient l’action sont devenues entre-temps tout à fait courantes dans tous les théâtres allemands, bien que leur fonction ne soit pas tout à fait claire ; incontournable aussi la façon excentrique, extatique du jeu des comédiens qui étaient poussés souvent dans leurs derniers retranchements en ce qui concerne l’endurance, l’habilité corporelle ou la torture du corps ; incontournable cette forme libre d’assemblage d’idées par laquelle il arrive à fondre tout ce matériau, même tout à fait dissemblable, en une mise en scène d’une grande cohérence.
Sujets I.
Il y a trois ans, on organisa à Francfort l’Experimenta, une expérience vraiment unique de rencontres théâtrales alternatives choisies par les jeunes qui se sentaient exclus des rencontres annuelles théâtrales de Berlin (« l’étalage » annuel des réalisations théâtrales de langue allemande). Déjà à l’époque, il fallait se poser la question sur les générations. Le théâtre d’aujourd’hui, si l’on veut considérer l’Experimenta comme l’image prototype du jeune théâtre, est sans merci, mais il a de grandes difficultés à se dépasser, ou à s’extérioriser et donc à se trouver. Est-ce que cela indiquerait un commun dénominateur ? Les réalisations des jeunes metteurs en scène ont-elles un même cadre et sont-elles d’un même monde ? Évidemment non. En fait, il y a peu de points communs, aucun dénominateur commun du point “de vue esthétique. Bien que les acteurs, les metteurs en scène et les dramaturges le sachent très bien, ils cherchent. Ils cherchent une conscience commune,
une sorte de point de repère, ils cherchent quelque chose qui pourrait leur donner un langage.
Autrefois, le langage commun était généré par le conflit des générations. C’est fini. Les fils d’aujourd’hui savent que le grand geste de l’assassinat du père ne fait plus d’effet parce qu’il est creux. Ils n’ont donc aucun conflit de leur côté sur lequel ils pourraient faire leurs armes et qui les aiderait à se profiler. Mais ils savent très bien qu’ils doivent trouver quelque chose d’aussi fort que l’assassinat du père. Le monde aime les signes forts.
Puisqu’ils se sentent obligés de faire de grands gestes et qu’ils doivent de toute façon inventer des images et raconter des histoires, parce qu’ils doivent surmonter la peur du vide, les fils recherchent les sujets les plus immenses et commencent par les œuvres du passé. On cherche le grand geste, la vision du monde, le système.
Et ainsi, ils font leurs armes sur les grandes pièces universelles qui sont évidemment très vieilles : le HAMLET de Nicolas Stemann inaugurait l’Experimenta et permet probablement de la résumer au mieux. Son HAMLET tourne autour de la question de savoir comment on peut trouver son propre point de vue dans un monde que, d’un côté, on comprend tout à fait et qu’on est même amené à approuver, mais qui, de l’autre, arrive à intégrer tout geste – et ce ne doit même pas être un geste révolutionnaire – et donc en fait un geste inutile. Claudius, le faiseur, est devenu le personnage central, on n’a plus affaire au père mort, à l’esprit, au drame psychologique.
La pièce de Stemann se situe à un nombre inquiétant de niveaux et ce qui fait peur, c’est qu’il en garde la vue d’ensemble et toutes les ficelles en main. Mais cela ne sert malheureusement à rien pour son HAMLET. Là où toutes les strates métaphysiques sont pensées, aucune d’elle ne promet plus la liberté. Les acteurs jouent les acteurs, ils jouent la pièce dans la pièce dans la pièce et ainsi de suite. C’est comme si tout d’un coup les années quatre- vingts étaient devenues réalité. Où tout ce qu’on fait est une citation d’une autre pièce, où le monde est un théâtre et parce qu’il n’existe pas d’alternative d’action, toute tentative de fuite se termine dans la souricière. Il n’y a pas d’action authentique, pas de position, et pas de « je ». C’est pourtant cela que nos expérimentateurs d’aujourd’hui cherchent toujours. Ils ont juste trouvé leur propre attitude. Là où toute action est citation, le théâtre et le monde ne peuvent plus être distingués. Et ainsi le théâtre peut enfin redevenir une belle grande métaphore.
Peut-être l’idée suivante peut-elle conduire à un dénominateur commun : les jeunes metteurs en scène, eux aussi, aiment les grands classiques par-dessus tout. Et surtout les metteurs en scène allemands aiment actuellement Henrik Ibsen, sa psychologie tricotée de maille étroite, mais parfois aussi construite de telle façon qu’elle laisse échapper la fatalité qu’Ibsen voulait démontrer.
Sujets II
Les metteurs en scène cherchent des sujets qui dépassent les domaines des relations amoureuses stressées et de l’enfer de la famille, de l’expérimentation linguis- tique et de l’esthétique des rêves. Ils cherchent des visions du monde qu’ils ne trouvent pas dans la plupart des pièces contemporaines. C’est pourquoi on trouve de plus en plus des adaptations de romans et de films sur les scènes de théâtre. La Volksbühne a fait le premier pas : Frank Castorf met en scène Dostoïevski et Boulgakov, René Pollesch adapte les classiques de la science-fiction que sont SOYLENT GREEN et LE CROTALE. Mais c’est aussi le cas dans beaucoup d’autres théâtres : les romans de Houellebecq et de Beigbeder sont adaptés à Berlin, Hanovre et Düsseldorf. À Hanovre, le réalisateur néerlandais Fred Kelemen a mis en scène sa version de FAHRENHEIT 451 de Truffaut, Matthias Hartman a produit à Bochum l’adaptation du roman pop 1979 de Christian Kracht sous forme d’une performance à plusieurs niveaux, etc. Du point de vue esthétique, on trouve au théâtre deux approches caractéristiques de la littérature et du film. Quelques metteurs en scène retrouvent, dans les scénarios, des pièces de théâtre qui peuvent être adaptées à la scène sans trop de pertes.
Ceci est valable pour la plupart des films dogmatiques – LA FÊTE fut un succès à Dortmund, Dresde et Francfort, et on peut dire la même chose de la comédie mélanco- lique sur le suicide de Aki Kaurismäki I HIRED A CONTRACT KILLER qui fut beaucoup jouée en Allemagne. À côté de cette pratique du théâtre où il s’agit surtout d’histoires touchantes qui fascinent, il y a aussi des metteurs en scène qui peinent à vouloir absolument monter des sujets apparemment impossibles et qui exploitent des romans à couches multiples comme une sorte de carrière pour leur théâtre post-dramatique.
Ici, le jeu et l’interprétation du modèle deviennent le sujet même, les spectateurs participent au processus des questions et de la recherche, de l’expérimentation, parfois aussi de l’embarras. La résistance du texte en prose, la fragilité qui naît de cette volonté de jouer contre le mur du non dramatique, l’arrêt des acteurs et leur précipitation soudaine fondent en grande partie la fascination du théâtre de Castorf.
Politique
Quel rôle revient à la politique dans le jeune théâtre allemand ? Honnêtement, je ne le sais pas. En fin de compte, Stefan Pucher n’est-il pas plus politique que Peymann ? Je ne le sais pas. Est-ce politique lorsque Pucher se moque très subtilement dans son RICHARD III de la vie des Zurichois, au début et à la fin avec Christoph Marthaler ou est-ce simplement une référence du théâtre à lui-même qui ne voit plus rien d’autre que lui-même ? Je ne le sais pas. Est-ce que Armin Petras est politique lorsqu’il fait jouer LA CRUCHE CASSÉE en Afghanistan ?
Ou Falk Richter est-il politique lorsqu’il écrit des articles contre George Bush ? La formulation des situations politiques est faite d’une façon très prudente par les jeunes metteurs en scène de théâtre, il existe une grande réticence, comme je l’ai dit sous la rubrique pop, à prendre position face aux grands événements que la politique fournit encore toujours. On préfère se lancer dans la recherche de l’authentique, même si l’on sait que cela aussi est une chimère.
Télévision
La télévision est une expérience médiatique, peut-être celle par excellence, que tous les metteurs en scène de la jeune génération partagent. La télévision est donc le point de référence essentiel pour presque tous les metteurs en scène allemands, avec les textes des pièces et la musique pop. À côté des pièces qui ont la télévision pour sujet, la télévision fournit des dramaturgies, comme par exemple chez Ostermeier, dont le réalisme cache clairement une esthétique de télévision, comme par exemple dans NORA. La télévision fournit une bonne part de l’expérience de la réalité, visualisée dans beaucoup de mises en scène modernes. Cela se voit, non seulement dans les dramaturgies, non seulement dans les nombreux postes de télévision qui envahissent les scènes, mais aussi dans les nombreuses citations empruntées au monde télévisé. La télévision est acceptée comme une part essentielle de l’expérience, elle n’est plus considérée comme opposition au théâtre, comme un média concurrentiel. Elle est évidente.
Vidéo
Lorsque le théâtre se situe par rapport à une autre expression artistique, alors il le fait de préférence par rapport aux installations vidéo. La danse n’occupe plus la place prépondérante qu’elle occupait précédemment, peut-être parce que d’importants éléments de la danse moderne font partie entre-temps du théâtre qui est de plus en plus chorégraphique.
Encore une fois, c’est la Volksbühne et Frank Castorf qui sont les grands précurseurs. D’une façon encore plus artistique, Stefan Pucher a utilisé des projections vidéo dans son RICHARD III. Il s’agit ici d’une mise en scène qui est typique à mes yeux et que je voudrais donc briève- ment décrire. La lumière s’éteint, la fille sur la place 214 se lève. Elle est si pure qu’on aimerait l’appeler pudique ; elle porte un bouquet de fleurs et avance vers la scène.
Il y a là les acteurs, devant le rideau de fer, alignés comme pour recevoir les applaudissements. La représentation vient de commencer et se termine déjà. La fille passe devant chacun des acteurs, l’un après l’autre, mais elle ne leur remet pas le bouquet. Il n’y a pas d’applaudissements, pas de sympathie. Et la représentation est peut- être arrivée au bout, mais elle ne veut pas finir. La fille, les acteurs, le rideau de fer, les fleurs, rien n’est vrai, c’est une vidéo. Cette vidéo est projetée sur le ( vrai) rideau de fer et devant celui-ci se tiennent les ( vrais) acteurs ( bien entendu, il faut se poser la question de savoir ce qui est vrai au théâtre, ce qui est permis et vrai pour les acteurs), alignés pour les applaudissements. Ainsi cette pièce qui se termine ne dure vraiment que quelques secondes, la fin est le début ou vice versa.
Mais déjà le théâtre est doublé par la technique de la vidéo et a noué la boucle. La scène vient de devenir cet immense espace de significations où tout est possible, où tout pourrait être suggéré et où, pourtant, rien n’est encore arrêté. Et nous avons à nouveau la confirmation que le metteur en scène Stefan Pucher est le plus fameux faiseur de nœuds du temps, de notre époque… Jamais auparavant, une scène n’a été ainsi effeuillée. Pucher la dévêt comme un amant doué, les couches tombent l’une après l’autre et n’en dévoilent qu’une autre. Après le prélude de la projection vidéo sur le rideau de fer, Richard lève celui-ci pour tomber sur le rideau de velours dont sort Lady Anne. Lorsque le rideau de velours se lève, on voit un mur baroque avec des serpents, des cassettes en bois et des niches, doublé à son tour par la répétition vidéo de cette image. Ainsi, le mur aussi ressemble à une immense image télévisée.
Dans les niches, il y a les hommes de la cour qui se préparent à entrer en jeu. Alors, le rideau vidéo se lève et le mur se lève. Pucher provoque un tremblotement et des images brouillées par le biais de ses différents rideaux, une impression que même Castorf n’a pas réussi à susciter en transformant son théâtre populaire en un immense studio vidéo.
Mais est-ce que, derrière tous ces rideaux, se dévoilera toute la vérité que tous les érotiques attendent ? Lorsque la scène s’ouvre, des enfants sortent des profondeurs pleurant le roi, leur père qui leur a été ravi par Richard.
Mais l’image trompe. Pucher ne raconte pas l’histoire de la douleur des victimes ni de la mort des enfants. Parmi les bidimensionnels, ce Richard est roi. Puisque la scène est un plan et que les acteurs font partie de ce plan, Richard se révèle être le seigneur de la troisième dimension. Il peut monter sur une passerelle dans la salle, il peut soulever les coulisses, il peut bouger sans contraintes, il est libre.
Le port de micros
La vidéo exige le port de micros, c’est-à-dire le son amplifié. J’ai l’impression qu’aujourd’hui on n’utilise “plus tellement les micros pour faire entendre un acteur durant un intermède musical ou d’un coin caché ou lorsqu’il parle le dos tourné au public.
Il y a deux autres raisons. D’une part, l’œil habitué à l’écran de cinéma retrouve ainsi dans le théâtre une sorte d’intimité qui ne peut être restituée par les techniques théâtrales et de diction traditionnelles.
D’autre part, on a parfois l’impression que les acteurs sont plus naturels ou parlent plus naturellement – pas seulement dans les scènes intimes et chuchotées – lorsqu’ils portent le micro-cravate. Le fait d’être relié au circuit technique leur donne plus de modernité.
Acteurs
Il existe dans le théâtre allemand un plaisir visible de l’excentrique, probablement dans la lignée de Castorf. Jusqu’à récemment, j’ai eu l’impression que beaucoup donneraient toute la pièce pour un numéro bien joué.
En plus, on constate dans le théâtre allemand que les acteurs trouvent un plaisir de plus en plus prononcé à crier ou, du moins, à parler très rapidement. “Actuellement, j’ai l’impression d’assister aussi à une tendance contraire. Quelques jeunes metteurs en scène cherchent très sérieusement à réaliser des pièces d’un seul jet, ils tentent vraiment de créer des rôles bien caractérisés et bien répétés et non pas laissés au hasard, à l’accidentel, ce qui donne peut-être bien une relation authentique face au rôle, mais qui évite « l’essentiel ». L’EURIPIDE de Lars Ole Walburg en est un bel exemple. D’autres metteurs en scène recherchent un style qu’ils poursuivent systématiquement à travers toute la pièce. Ils cherchent à trouver une forme pour une pièce.
Contrairement à d’autres expressions artistiques, le théâtre reste lié à une certaine forme de naturel qu’on ne peut pas nier, qu’on ne peut pas ignorer puisqu’on ne peut pas quitter le corps. Même la danse est plus artificielle que le théâtre, puisqu’elle a pratiquement pour programme le dépassement du corps. Mais le jeu des acteurs sur les scènes allemandes est devenu entre- temps très artificiel. J’ai l’impression que ce sont les jeunes metteurs en scène surtout qui se battent contre le mur de cette corporalité, alors qu’elle est tout simplement là, par la nature même du corps humain.
J’ai l’impression, et ceci serait ma thèse de base en conclusion, que le théâtre parcourt seulement actuellement, sous l’influence des jeunes metteurs en scène, une phase d’abstraction que d’autres arts ont connue beaucoup plus tôt. Je veux parler de la deuxième phase d’abstraction des années cinquante et soixante.
On a l’impression que le théâtre ne peut aborder qu’actuellement ces questions formelles et ces évolutions esthétiques. Car à l’époque, le théâtre allemand était entièrement défini par ses tâches sociales.
Texte développé à partir d’une intervention lors de la rencontre « Bilan, tendances, perspectives de la jeune mise en scène en France et en Allemagne aujourd’hui » ( dirigée par Barbara Engelhardt), Centre Européen de la Jeune Mise en Scène / European Center for Young Directors ( Maison Gaston Baty) en juillet 2003.