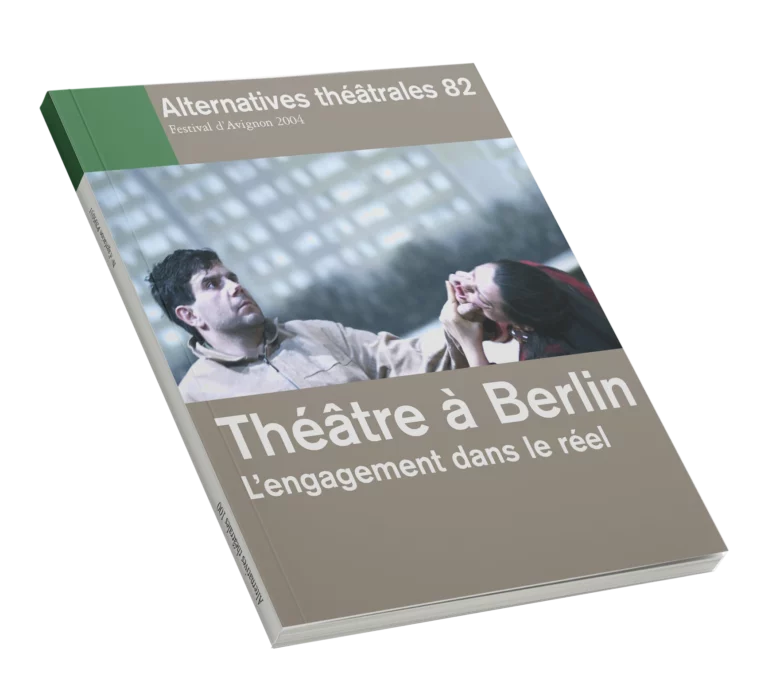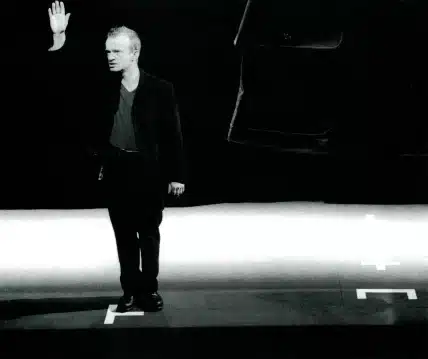BERNARD Debroux : Le théâtre allemand est-il encore une référence ? Dans son contenu mais surtout dans sa manière de concevoir la place du théâtre dans l’espace social ?
Bernard Sobel : On pourrait se poser la question de la manière suivante. Pourquoi avons-nous, nous Français, besoin d’Achtenbusch, de Brecht, de Thomas Bernhardt, de Peter Handke, de Manfred Karge, etc.? Pourquoi avons-nous besoin de ces poètes ? Nous n’en avons pas besoin parce que ce sont des auteurs de théâtre allemands, nous en avons besoin parce que leurs poèmes et ceux de Lenz, de Büchner ou de Kleist nous aident à comprendre ce que nous faisons. On pourrait d’ailleurs aussi se demander, en retour, pourquoi l’Allemagne – après Diderot, le vrai père d’un certain théâtre allemand – n’a pas besoin du théâtre français. En dehors des classiques ( Racine, Molière…), il n’y a pas beaucoup de poètes français joués sur les scènes allemandes.
Je pourrais aussi vous répondre d’une autre façon, apparemment paradoxale. Hier, je me suis promené dans Berlin, le Berlin dans lequel j’ai vécu il y a déjà bien longtemps. Il y avait une immense manifestation avec des drapeaux rouges. Cela faisait des années que je n’étais pas venu à Berlin. Il y a aujourd’hui une statue de Brecht en face du Berliner Ensemble, la maison dans laquelle j’ai travaillé pendant cinq ou six ans. On y jouait hier LA MÈRE,dans une mise en scène de Klaus Peyman.
Et le soir, j’ai vu le travail de Frank Castorf sur le texte de Boulgakov, LE MAÎTRE ET MARGUERITE. En arrivant, j’ai vu inscrit sur la façade du théâtre Volksbühne( Théâtre du peuple) et en haut sur le toit, visible de loin, en lettres de néon bleu, Ost( Est). Moi, le communiste, je me baladais dans un pays disparu, un pays fantôme. C’est de ce mélange que je peux parler. Je n’ai pas une vue théorique des choses. Castorf dit : « Je suis désespéré. Maintenant il n’y a plus que l’individu qui m’intéresse », mais en même temps il affirme quelque chose d’autre avec cet Osten lettres de néon. Je pense que ce qui le meut, c’est d’être un enfant de cet Ost, la RDA, et que le fait d’y avoir vécu l’habite complètement. Et ce pays disparu est aussi, toujours, notre paysage à nous, hommes de théâtre, dans notre rêve, notre désir d’être utiles. Et ces milliers de drapeaux rouges, brandis dans un Berlin libéré de la Stasi et de l’univers totalitaire du communisme, disaient au gouvernement social-démocrate : « Comme ça, ça ne va pas ! » Et j’entendais le gouvernement répondre : « Ça ne va pas, mais on ne sait pas comment faire autrement. » C’est comme ça que je peux parler du théâtre allemand.
Je relisais un texte de Diderot adressé aux poètes dramatiques : «[…] l’applaudissement vrai que vous devez vous proposer d’obtenir, ce n’est pas ce battement de mains qui se fait entendre subitement après un vers éclatant, mais ce soupir profond qui part de l’âme après la contrainte d’un long silence, et qui la soulage. Il est une impression plus violente encore, et que vous concevrez, si vous êtes nés pour votre art et si vous en pressentez toute la magie : c’est de mettre un peuple comme à la gêne.
Alors les esprits seront troublés, incertains, flottants, éperdus ; et vos spectateurs, tels que ceux qui, dans les tremblements d’une partie du globe, voient les murs de leurs maisons vaciller, et sentent la terre se dérober sous leurs pieds. » Pour moi, le théâtre allemand, c’est ça.
Je crois que si les poètes allemands nous ont été utiles, si nous en avons eu besoin, c’est parce qu’être allemand n’était, n’est pas évident pour un Allemand. Ce n’est pas évident dans un pays qui a connu l’hitlé- risme, un régime totalitaire mais accepté par 99 % de la population. Même aujourd’hui, j’ai l’impression que pour beaucoup d’Allemands, le passé de la RDA leur inspire plus de honte que le passé nazi. Le nazisme était en quelque sorte consubstantiel à l’Allemagne, ce n’était pas artificiel, non allemand. L’expérience du socialisme, elle, n’était pas allemande. Ce n’est pas facile d’exister comme sujet, comme individu allemand. Il faut assumer beaucoup. Pour nous, l’existence d’un Papon, ce n’est pas vraiment un problème, parce que nous n’avons pas à l’assumer personnellement. Mais pour des Allemands, c’est très différent, compte tenu de ce qui est arrivé chez eux à l’espèce, et, du coup, à ce que ça veut dire être un être humain en Occident, dans la rationalité. Ils n’ont pas cessé d’être choqués. « Suis-je le fils d’un épouvantable tortionnaire, ou suis-je le fils d’Heiner Müller ? »
Nous n’avons pas, nous, ce genre d’interrogation.
En voyant tous ces drapeaux rouges, je me posais la question, toujours la même, celle posée déjà par le roi Lear quand il est dans la lande et découvre que dans son royaume il y a des chômeurs. À un moment où en France, avec les « fins de droits », 265 000 personnes sont déclarées socialement inutiles.
Dans le spectacle de Castorf, une phrase m’a particu- lièrement frappé : « I want to believe » (« Je veux croire »).
Je crois que tous les poèmes du théâtre allemand sont là pour dire : il ne faut surtout pas croire, parce que commencer à croire, c’est déjà le début de la catastrophe.
B. D. : Que pensez-vous de cette idée du collectif qu’il y a dans le théâtre allemand ? Est-ce une illusion, est-ce une vraie pratique ? En France, le théâtre est fort l’affaire du metteur en scène, affaire individuelle en quelque sorte.
B. S. : Je pense que c’est une fausse question. De quoi parle-t-on quand on parle d’individus et de collectif ?
Est-ce que L’ENCYCLOPÉDIE est une œuvre collective ou est-ce l’œuvre de Diderot ? Le talent de Diderot a permis à d’autres talents de se développer. L’art de faire fonctionner un collectif, c’est-à-dire l’art d’amener des individus au maximum de leur expression et de les faire travailler ensemble, peut être le talent de quelqu’un qui n’est pas capable de faire autre chose. C’est une question de management. Le grand chef d’équipe, c’est celui qui sait se rendre « dispensable ». C’est le besoin qui fait que j’ai besoin de l’autre. Il faut donc que je fasse preuve de courtoisie, que l’on puisse échanger, que chacun s’y retrouve. Mettre en scène n’est pas un métier. Je peux le faire sans posséder aucune technique. Être acteur, cintrier, maquilleur, c’est un métier. Un metteur en scène a besoin de la technique des autres pour pouvoir expérimenter ; il peut, lui, ne pas en avoir du tout. Je crois même profondément qu’un metteur en scène est mort à partir du moment où il a un savoir-faire. Il est celui qui peut faire un bon usage de la technique des autres et les faire avancer dans leur propre technique. Partout, bien sûr, se greffe la question du pouvoir, des rapports de pouvoir. On peut mettre le nom de collectif là-dessus, si l’on veut…

B. D. : Je voudrais revenir à la question de la respon- sabilité sociale du théâtre. Ne ressent-on pas d’avantage en Allemagne à la fois cette responsabilité des autorités publiques par rapport aux institutions affirmant l’impor- tance pour une ville d’avoir un théâtre qui a un rôle à jouer dans l’espace social et celle des responsables de théâtre qui se sentent investis d’une fonction sociale, convaincus que la fonction artistique est intimement liée à la fonction sociale ?
B. S. : Je pense que la comparaison avec le théâtre allemand permet simplement un effet d’étrangeté. Elle permet un regard différent sur le théâtre français, sur la fameuse exception culturelle. La France souffre de jacobinisme. Vous pouvez être un acteur à Düsseldorf, à Leipzig, à Hanovre, à Dessau, ou à Cologne. Les outils de travail sont là, qui appartiennent à la tradition allemande, parce que l’unité du territoire a été réalisée tardivement. La plupart des grandes villes d’Allemagne étaient les capitales d’un État et avaient leur théâtre. Le théâtre était un service public. Et il le reste. Le théâtre de Gennevilliers, lui, pour prendre un exemple concret, existe parce qu’un jour je me suis dit avec quelques autres : « On va aller travailler là-bas. » Il ne faut pas raconter et se raconter d’histoires. Ce qui était premier, c’était notre désir de faire du théâtre. L’engagement politique, une réflexion sur la fonction sociale des pratiques artistiques avaient peut-être leur place dans ce désir, mais il ne faut pas mettre la fonction sociale avant le désir. Après coup, on peut se dire que ce désir trouve une expression plus profonde et plus riche dans le fait que d’autres vont avoir besoin de ce que ce désir peut produire. Naturellement, le besoin qu’ont les autres de ce désir va changer la nature du désir. C’est comme dans un rapport chimique.
Mais il aurait très bien pu ne pas y avoir de Théâtre de Gennevilliers. Par contre, si Castorf n’était pas là, il y en aurait un autre à sa place. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu’il ferait le même travail, mais il prétendrait à la même nécessité.
Là se pose la question du service public. Castorf touche de l’argent pour rendre des services. Il doit présen- ter 24 spectacles par an parmi lesquels des opérettes, des spectacles de danse, du théâtre de boulevard, de studio, etc. Quoi qu’il en soit, il faut qu’il y en ait 24. Peut-être qu’à l’intérieur de ce cadre, par chance, un génie se manifestera. L’outil est là pour produire 24 spectacles par an, et c’est ce qu’on est en droit d’exiger de lui, en tant que responsable de l’outil. Après, à Castorf et aux artistes de se débrouiller pour pouvoir éventuellement exprimer leur génie. Castorf réussit à dire : « La Volksbühne, c’est l’expression de Castorf. »
Et il va mettre en œuvre tous les moyens pour ça.
B. D. : Est-ce qu’en France on ne conçoit pas qu’un théâtre est d’abord l’expression d’un individu alors qu’en Allemagne on est plus attentif à la fonction sociale du théâtre ?
B. S. : Je suis très reconnaissant aux hasards qui ont fait que Castorf ait pu aller au bout de son expérience, mais ce n’est pas la caractéristique du système. Le service public suppose que l’on fasse du service public. Vous pouvez faire, aussi, éventuellement, de la recherche dans un hôpital public, mais ce n’est pas cela le service public de l’hôpital. Ce sont rarement les deux choses en même temps. Un grand intendant est celui qui donne naissance à d’autres. D’ailleurs, ce pourrait être une manière de faire le bilan de son action que de se demander :
« À qui, à quoi ai-je donné naissance ? » Repérer un jeune artiste et lui permettre de se révéler au moment où il est mûr pour ça, c’est une responsabilité, à la fois éminem- ment sociale et éminemment individuelle, puisque vous devez avoir le « nez » de vous dire : « Ce gars-là va faire des choses importantes. » Le profondément individuel et le profondément collectif ne sont pas séparables.
Vous devez accepter que l’artiste, pour être éminemment social, soit au service de son individualité.
B. D. : Vous préparez pour l’instant HOMME POUR HOMME…
B. S. : Il faut traduire UN HOMME EST UN HOMME, pas HOMME POUR HOMME. Il ne s’agit pas d’une substitution, mais d’une transformation. La traduction ancienne induit en erreur. UN HOMME EST UN HOMME est au centre de tout ce dont nous venons de parler. Ce poème se trouve à un croisement où, après les massacres de masse de la guerre 1914 – 1918, la question de l’individu et du collectif se trouve posée de nouveau, naturellement et de façon paradoxale. Aux politiques, bien sûr, mais aussi aux philosophes et aux artistes. La rupture est d’une telle violence qu’on ne peut plus se poser la question du « moi » comme on se la posait avant. Tout l’humanisme classique a volé en éclats. Si donc on se situe dans la courte durée, on ne peut pas bien parler d’UN HOMME EST UN HOMME. C’est comme Shakespeare, au moment de l’explosion des structures de la société médiévale européenne dans laquelle la place de l’individu dans le monde était jusqu’alors fixée précisément par le rôle joué dans l’organisation sociale : guerrier, prêtre, paysan ; laïc ou clerc. D’un seul coup – on n’a pas appelé ça par hasard la Renaissance – l’élargissement de l’univers géographique, physique et intellectuel opère une rupture extraordinaire, qui fait que se posent cette série de questions : qui est-on, où est-on, à quoi sert-on ? Si on se situe dans la longue durée, j’ai l’impression de travailler sur un poème ininterrompu. De Marlowe à Beckett, il s’agit toujours du poème de l’homme occidental. Qu’est-ce que j’entends dans Beckett ? ( C’est aussi une manière de parler d’UN HOMME EST UN HOMME ).
J’entends le silence. Qu’est-ce que c’est que ce silence ? C’est Auschwitz. Ce sont les millions de morts qui n’ont pas eu droit à la parole. Comme au sortir des tranchées de 14 – 18. Dans UN HOMME EST UN HOMME, j’entends le silence du Soldat inconnu. Et en même temps, à l’horizon commence une tentative pour sortir du cercle infernal, diabolique où l’humanité semble s’être piégée. Si des individus peuvent être tués en masse, qu’est-ce que cela peut encore signifier être un individu ? Ne faut-il pas chercher d’autres voies, puisque les anciennes ont conduit à une telle « inhumanité » ? La naissance de cette question, on la sent chez Rimbaud :
« Le drapeau va au paysage immonde et notre patois étouffe le tambour.
Aux centres nous alimenterons la plus cynique prostitution. Nous massacrerons les révoltes logiques.
Aux pays poivrés et détrempés ! – au service des plus monstrueuses exploitations industrielles ou militaires.
Au revoir ici, n’importe où. Conscrits du bon vouloir nous aurons la philosophie féroce ; ignorants pour la science, roués pour le confort ; la crevaison pour le monde qui va. C’est la vraie marche. En avant, route ! »
À cette citation des ILLUMINATIONS, je voudrais ajouter cette note de Brecht en 1938 : « La foi de la classe prolétarienne en sa victoire finale me plaît beaucoup.
Sa foi, par là étroitement liée à tant d’autres choses qu’on leur dit, me trouble, il est vrai. » Mais dès 1918, Brecht écrivait à un ami : « Il est possible que la terreur réside au centre. Il est possible que ce concept de « totalité » qui ne cesse de resurgir dans tous les discours comme une chose qui a existé, qui a disparu et dont il faudrait qu’elle revienne, doive subir la transformation centrale.
Si l’homme des masses est un mythe, nous nous en tenons à ce mythe. Il n’y a alors pas d’individu qui reproduise l’humanité. Il n’y a alors pas de totalité pour cet individu, mais seulement pour l’homme des masses… Le sentiment de bonheur ne pourrait se manifester que dans la masse, la masse serait donc nécessaire, l’individu pourrait donc sans dommage pousser son individualisation jusqu’à l’extrême. Si l’on pouvait penser à fond cette idée, cela aurait peut-être des conséquences. »
Au moment où, avec le socialisme, on va faire l’expé- rience du Tout pour l’Homme, avec l’espérance vient la chair de poule. Mais vient aussi le moment de s’engager ou de ne pas s’engager. C’est la question à laquelle ont été confrontés tous les fils des tranchées, que ce soit Brecht, Gotfried Benn ou Louis Aragon. La dernière phrase d’UN HOMME EST UN HOMME est : « Il va tous nous décapiter. » Je pense que Brecht parle là par rapport à l’expérience en cours dans la jeune URSS. Il est à un moment de son engagement où il n’a pas encore les certitudes qu’il aura plus tard, il sent seulement et il cherche, sans autocensure. Et il ne variera jamais sur le caractère positif, malgrétout, de la capacité de son héros à changer, à se transformer, quel que soit le résultat de la métamorphose. « Je suis désespéré, dit Castorf, il n’y a plus que l’individu qui m’intéresse. » Et puis il y a la masse, les 500 000 Berlinois qui défilaient hier…