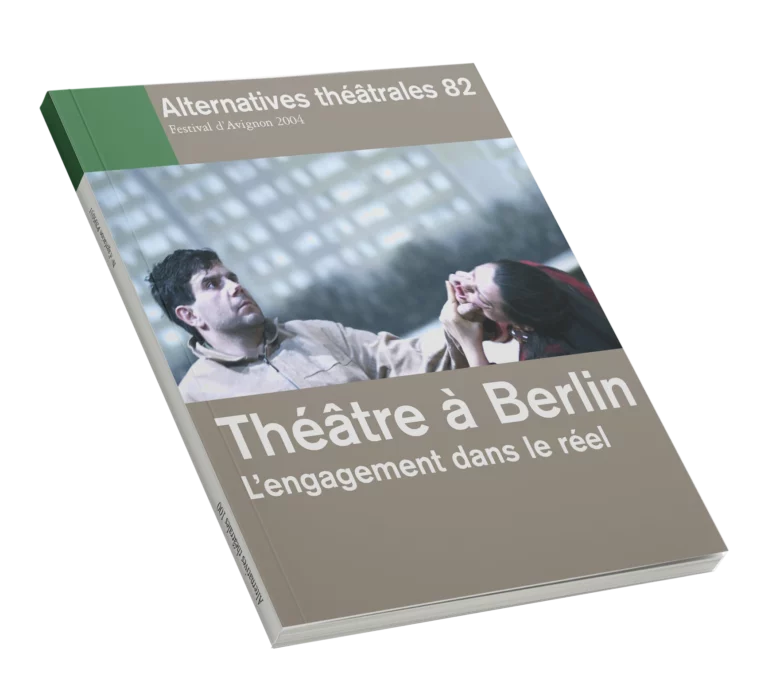Promenade dans la Friedrichstrasse
FAISONS un bout de chemin ensemble ! Montons la Friedrichstrasse. C’est comme ça qu’on découvre le mieux le nouveau Berlin dont on parle tant partout. Nous commençons dans la partie sud, là où la rue toute droite à deux bandes de circulation vient de Kreuzberg et rejoint le centre de Berlin à l’endroit de l’ancien Checkpoint Charlie.
À l’époque de la guerre froide, Kreuzberg avait la réputation d’être le haut lieu d’un anticapitalisme romantique, où les jeunes gens essayaient de trouver une autre façon de vivre, en dehors des lois du marché capitaliste, en créant des menuiseries, des compagnies de taxis et des bistrots sous forme de collectifs administrés par eux- mêmes. Pleine de couleurs comme l’arc-en-ciel, multiculturelle, politiquement correcte, telle devait être la vie dans la république autonome de Kreuzberg. Il en reste très peu après la chute du Mur. Les bohémiens et hors-la- loi sont partis vers le Prenzlauer Berg, là où l’on trouvait alors une offre abondante de logements bon marchés dans des maisons complètement délabrées. Les anciennes entreprises alternatives basées sur l’exploitation personnelle ont fait faillite ou se sont professionnalisées. Seuls les Turcs sont restés fidèles à Kreuzberg et y forment la troisième ville turque en importance de population après Istanbul et Ankara. Mais à la place de l’espoir de pouvoir fonder une cohabitation exemplaire de différentes cultures s’est glissée aujourd’hui l’inquiétude face à une sorte de ghetto librement choisi, à un cloisonnement, à une radicalisation et un abandon des jeunes Turcs qui n’ont souvent que peu de formation et donc aucune chance sur le marché du travail.
À droite, au croisement de la Friedrichstrasse et de la Kochstrasse, on voit la maison d’édition du Tageszeitung (Taz), probablement le projet alternatif le mieux réussi qui appartient aujourd’hui à une association. Plus loin, dans la Kochstrasse, se dresse le building des éditions Axel Springer qui était situé à l’époque directement contre le Mur, un consortium conservateur dont les deux journaux de boulevard influencent encore aujourd’hui l’opinion publique dans la ville. Le Taz et Springer sont les deux pôles opposés non seulement des Berlinois, mais aussi de la presse générale en Allemagne. Le Taz qui a commencé, il y a 25 ans, à former une opinion publique d’opposition, est devenu actuellement pratiquement le journal officiel de la coalition du SPD ( parti social-démo- crate) et du Grüne Partei ( les Verts). Mais malgré tout, ce sont les feuilles de Springer avec les seins nus et les grands titres sur la première page qui forment essentielle- ment la pensée des Allemands et de leur gouvernement.
En face de la maison du Taz, la maison Haus am Checkpoint Charlie occupe largement le coin. Ce musée du Mur célèbre les évasions spectaculaires de la RDA et commémore les morts, ceux qui ont été fusillés par les gardes de la RDA lors de leur tentative de franchir la frontière entre les deux Allemagnes.
Une question qui hante les Berlinois depuis 1990, c’est de savoir de quels morts il faut se souvenir et à quel endroit symbolique et topographique. Les morts de ce Mur ne jouent pas de rôle dans ces réflexions, dans le meilleur des cas ils servent d’éléments de manipulation aux conservateurs. Par contre, la discussion sans fin sur le monument aux Juifs européens assassinés qui commence à prendre forme tout près de la Porte de Brandebourg fut longtemps prépondérante. Mais que fait-on pour les autres victimes du régime nazi, le demi-million de Tsiganes assassinés, les homosexuels tués dans les camps de concentration, les handicapés, ceux qu’on appelle les asociaux ? S’agit-il vraiment de victimes d’un régime ou de victimes de la communauté allemande qui n’a pas refusé de suivre son gouvernement jusqu’à la fin tragique ? Et qui sont les coupables ? Un musée, la Topographie des Terrors ( Topographie de la terreur) s’est donné pour mission d’explorer cette question qui reste toujours controversée. Ce musée et lieu de mémoire près du parlement berlinois, érigé dans les caves de l’ancien quartier général de la Gestapo, d’une architecture exigeante, n’arrive toutefois pas à sortir de l’état provisoire. Le Land Berlin estime ne pas pouvoir se permettre les investissements pour l’achèvement du lieu à cause de l’augmentation des frais. Le gouvernement fédéral rouge- vert qui a déjà repris à sa charge plusieurs des institutions culturelles de la ville s’est déclaré incompétent.
Derrière le Checkpoint Charlie qui servit de point de passage, jusqu’en 1990, aux familles des forces alliées, commence le désert de l’urbanisation moderne. Des façades en verre, en béton, des fenêtres alignées, tout est quadrangulaire, carré, fonctionnel. La hauteur prescrite à Berlin, à savoir qu’aucun édifice ne peut dépasser cinq étages, uniformise le paysage urbain. Le summum de l’excentricité, ce sont les fondations en triangle de l’American Business Center créé par l’architecte mondialement connu Philip Johnson.
Nous traversons la Leipziger Strasse, où sont alignées à l’Est les anciennes résidences de l’époque est-allemande. Alors que la plupart des citoyens de l’« État, des paysans et ouvriers », habitaient dans des appartements délabrés avec chauffage au poêle, ou à la périphérie dans les maisons préfabriquées avec du matériel bon marché, les services nationaux de logement distribuaient dans la Leipziger Strasse des appartements relativement modernes et très spacieux. Des diplomates ou d’autres privilégiés de l’État pouvaient y emménager.
Entre la Leipziger Strasse et le boulevard Unter den Linden ( Sous les tilleuls ), la Friedrichstrasse se fait fastueuse : on y voit des magasins de luxe où les vendeuses baillent, car excepté à l’époque de Noël, il n’y a pas beaucoup de clients ici. Les nouveaux millionnaires en dollars russes préfèrent en tout cas nettement le KadeWe (Kaufhaus des Westens – les grands magasins de l’Ouest). Sur la droite, à dix minutes de marche, on trouve le quartier 205, un centre commercial de luxe, avec du marbre et des fauteuils en cuir et un patio recouvert d’une baie vitrée. Espoir en pierre du retour de la société aisée à Berlin. Les mêmes investisseurs ont fait renaître l’hôtel Adlon près de la Porte de Brandebourg et rêvent actuellement de faire revivre les bains de mer à Heiligendamm sur la mer baltique, à 300 km de la ville, lesquels étaient fréquentés autrefois par la haute bourgeoisie de Berlin.
Cette illusion nostalgique a occupé l’opinion publique pendant des années après la réunification de la ville. On était convaincu que Berlin pouvait retrouver sans rupture l’époque dorée des années 1880 à 1933, l’époque où la capitale prussienne avait la réputation d’être la métropole la plus moderne et animée du continent. C’était le rêve de la renaissance de la ville industrielle que fut Berlin. On avait l’impression que les politiciens berlinois n’avaient pas réalisé la fin irrémédiable de l’époque industrielle. Peu d’entreprises ont déplacé leurs usines sur la Spree et les entreprises délabrées de l’Est implosaient en nombre dans les années quatre-vingt-dix. Le chômage augmentait, les riches s’établissaient dans les environs, les recettes de la ville baissaient. Lorsque le ballon de haute conjoncture de l’économie sur internet éclata à la fin du millénaire et que même la banque appartenant au Landne put être sauvée qu’à force de subventions de plusieurs milliards, la ville sortit de son rêve et se retrouva avec une montagne de dettes qu’elle ne pourra jamais rembourser dans les cent ans à venir, à moins de bénéficier d’aides extérieures. Berlin est en faillite. N’est resté que le décor du spectacle de la renaissance qui n’a jamais eu lieu.
Les Galeries Lafayette représentent une sorte de symbole de ces espoirs éteints. On avait promis, lors de l’ouverture de cet édifice avec l’élégant angle arrondi sur la Pariser Strasse, que la filiale des grands magasins parisiens ramènerait le savoir-vivre français aux petits- bourgeois de la capitale. Plus tard, le bâtiment fit parler de lui lorsque des tonnes de fenêtres tombèrent de la façade en verre sur la Friedrichstrasse. Par miracle, aucun passant ne fut tué. Et il tient aussi du miracle que les Galeries Lafayette aient survécu jusqu’à ce jour. Dans le meilleur des cas, quelques touristes passent les portes en verre ; à part eux, il y a uniquement les employés des ministères environnants qui viennent s’y sustenter rapidement entre l’heure du midi dans le département alimentation situé au sous-sol.
En face des Galeries Lafayette, l’Institut russe — anciennement soviétique – des sciences et de la culture parle d’une autre époque berlinoise. Les vainqueurs de l’histoire auraient préféré balayer sous le tapis les quarante ans de souveraineté russe sur Berlin et sur la RDA. Pour l’instant, l’édifice inauguré en 1984, où seule la communauté russe fête encore ses cosmonautes et ses inventeurs, empêche symboliquement l’effacement complet des événements qui se sont déroulés entre 1945 et 1990.
Quelques maisons plus loin, quelques militants pour les droits civiques en RDA et un tas de groupes de gauchistes et de démocrates fondamentaux ont lutté pendant des années pour la sauvegarde de la « maison de la démocratie ». Aujourd’hui, plus rien ne rappelle l’anarchie optimiste qui régnait entre le moment de la chute du Mur et l’établissement du nouvel ancien ordre à Berlin. Dans l’édifice classiciste fraîchement rénové s’est établie l’association des fonctionnaires allemands ; un restaurant italien très cher est un lieu de rencontre pour fonctionnaires et hommes d’affaires.
En longeant le boulevard Unter den Linden,on approche déjà du quartier des théâtres. En passant la gare Friedrichstrasse qui est devenue ces temps-ci un grill gigantesque de poissons, on voit tourner l’ancien logo sur le toit du Berliner Ensemble, sur l’autre rive de la Spree. Deux rues plus loin, le Deutsches Theater avec son petit théâtre rattaché donne sur la place Max Reinhardt.
Par contre, en tournant à droite « aux tilleuls », on arrive à l’université Humboldt où Hegel enseigna sa dialectique il y a 200 ans, et on tombe sur le théâtre Maxime Gorki fondé en 1952 avec le but d’y entretenir l’image des pièces dramatiques à thèse du réalisme socialiste. En traversant l’île des musées derrière le théâtre Maxime Gorki, on arrive à partir des Hackeschen Höfe dans l’ancien quartier juif (« Scheunenviertel » – quartier des granges) — où se trouvent d’ailleurs les Sophiensaele du théâtre alternatef où la chorégraphe Sasha Waltz fêtait ses premiers succès – et après dix minutes à pied, on tombe sur la place en triangle Rosa Luxemburg. Dans le ciel s’élève la tour de la télévision berlinoise et devant nous se dresse le bâtiment monumental de la Volksbühne, construit en 1914, détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale et reconstruit avec le marbre de la chancellerie hitlérienne après la guerre.