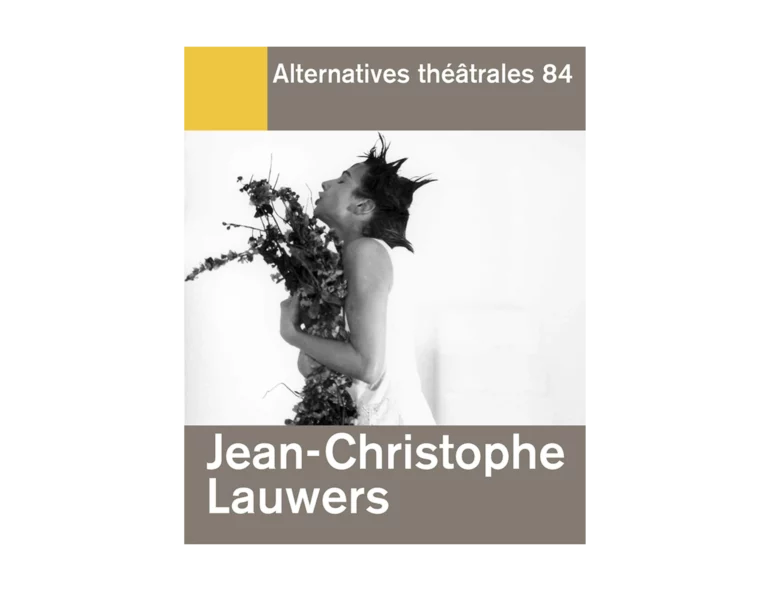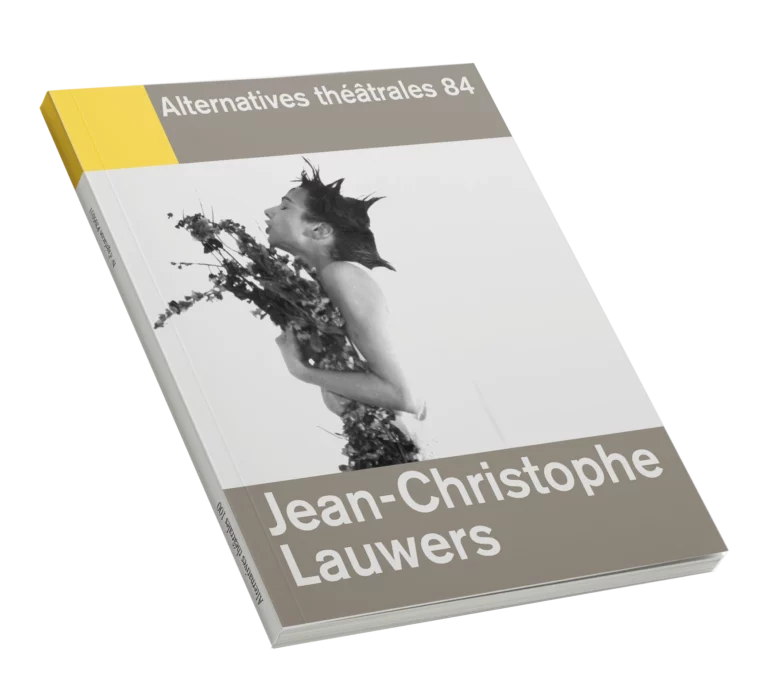L’individu
À partir du Ciment d’Heiner Müller, on peut développer plusieurs thèmes. Parmi les plus évidents : la révolution, l’idéalisme, la condition de la femme, les nouvelles relations de couple…
Je crois que ce qui m’intéresse le plus, là-dedans, dans cette matière dense et complexe, c’est justement la complexité müllerienne. La complexité en ceci qu’elle s’oppose à la complication. De la première, on peut dire qu’elle caractérise une composition d’éléments divers, de la seconde qu’elle procède d’un concours de difficultés. L’écriture de Müller n’est pas volontairement obscure, mais essentiellement foisonnante et prolixe. Essentiellement parce qu’elle veut pointer l’être humain, dans son centre, dans sa vitalité.
Dès lors, la révolution russe m’apparaît comme un décor, la cimenterie comme un accessoire, un objet, les rapports hommes / femmes comme une exemplification. Cela signifie que plutôt qu’aborder la pièce en tant que présentation d’un groupe social aux prises à une situation sociale, je voudrais la prendre comme une présentation d’êtres, de personnages, d’individualités confrontés à leurs semblables.
Cela rejoint sans doute l’explication que donne Müller de l’échec des révolutions socialistes : on a voulu partir du bien-être de tous pour arriver à l’épanouissement de chacun, alors qu’il fallait d’abord penser à l’épanouissement de chacun pour tendre au bien-être de tous.
L’aspiration de l’homme à construire un monde meilleur est de manière récurrente confrontée au problème de la réalité concrète et quotidienne de la vie. C’est le sens du titre de l’avant-dernier tableau de Ciment. Je suis la faim. Qui veut changer le monde doit faire avec moi.
L’individu est pris dans une constellation de préoccupations basiques, alimentaires et de survie qui le coupent dans ses élans idéalistes. Il veut d’abord nourrir ses enfants avant de nourrir le monde.
Une telle conception aurait été qualifiée par Lénine de gauchisme, c’est-à-dire de révolutionnaire. C’est la position du jeune camarade dans La Décision de Brecht. Là non plus, il n’est pas étonnant que Müller ait rédigé une suite à cette pièce de Brecht, dans laquelle les assassins du jeune camarade ne répondent plus à une idéologie mais à un permis de tuer sans limites qui les transforme en machines.
Les machines
Machines. Le mot traverse toute l’œuvre de Müller.
Si la machine, pour le pouvoir soviétique, était le symbole et la condition même du prolétariat — sans machines, pas de travail, sans travail, pas de prolétaires —, elle est pour Müller la « dévoratrice de l’existence sociale et élimine le prolétariat comme sujet de l’histoire ».
Elle dévore l’existence sociale parce qu’elle circonscrit celle-ci aux seuls gestes du labeur, et elle élimine le prolétariat comme sujet parce qu’il est devenu objet de l’industrialisation de la Russie.
Nous sommes à l’aboutissement du processus de mécanisation du travail, et nous voyons que la prophétie müllérienne s’accomplit. Nous assistons à la disparition de la classe ouvrière. Elle est peu à peu remplacée par une nouvelle classe : celle des chômeurs. Peut-on encore parler de classe sociale pour les chômeurs ? Ne sont-ils pas plutôt une catégorie sociale, en ceci qu’ils émargent d’horizons divers et de classes sociales diverses ?
Et sans classes sociales, plus de lutte de classes, plus de changement.
Mais revenons-en à Müller. Pour lui, le système soviétique aboutit à la mécanisation de l’homme. Dans Mauser, l’homme devient machine à tuer, à tel point que la main et le pistolet ne forment plus qu’un corps indissociable. Ciment s’ouvre sur un tableau intitulé « Sommeil des machines ». Dans ce tableau, on voit que ce sommeil est aussi celui de la ville de Novossierk où se déroule l’action. Les hommes de la ville ne sont plus rien, parce que les machines ne sont plus rien. La fin de la pièce qui correspond au redémarrage des machines marque le renouveau de l’homme soviétique, sa « renaissance », mais c’est aussi la mort des individualités, la mort de deux seules entités humaines à penser par elles-mêmes, hors de l’idéologie du parti, à savoir Polia et Ivaguine.
« Nous ne pouvons arrêter le cours de l’histoire comme un cheval à qui on demande de s’arrêter où l’on veut », dit Ivaguine. « Ici, ce qu’on veut c’est du ciment », poursuit-il. L’homme est inscrit dans une logique de production, et uniquement de production. Il suit le cours mécanique des évènements, et s’il le bloque, comme une pièce de rouage défectueuse, il est jeté, puis remplacé. Polia répond : « Tu n’as pas besoin de me dire où est ma place » ; par cela, elle refuse ce statut de rouage et s’efface.
La machine donc dévore l’individu, le sujet et l’objectise. Son influence est telle qu’elle avale également les ennemis d’hier qui sont laissés en vie à condition « qu’ils se mettent au service de la république des Soviets », comme c’est le cas pour les cosaques à la fin de la pièce.
Dans Hamlet machine enfin, on en arrive à une conception de l’homme dépouillé de son histoire, de sa mémoire. « J’étais Hamlet, mais je n’ai pas pu vivre mon drame. » Dans les didascalies, des machinistes déposent sur scène un frigo, des télévisions. Le sujet est remplacé par une machine pour manger, et une machine qui virtualise les liens sociaux. Nous sommes à la fin de l’Histoire. Le monde se fait sans nous, nous faisons face au rivage, et nous faisons avec le ressac, blabla.
Ciment, c’est l’étape antérieure, celle où l’homme se bat encore, veut être restitué dans sa place de sujet. C’est pour cela que j’insiste beaucoup sur la notion de personnage dans le travail que nous allons entamer. Nous ne sommes pas dans le cadre stanislavskien de la notion de personnage, nous n’allons pas tenter de lui construire un visage psychologique. Il faut que nous nous attelions à un travail de crétinisation de nos personnages. Par là, j’entends lui donner un physique, une gestuelle, une voix qui le caractérise en tant qu’individu social mais surtout particulier.
La confrontation entre ces personnages « crédibles » et un texte qui n’est pas « réaliste » est essentielle afin que le spectateur comprenne bien qu’il assiste à un événement extraordinaire.
Je ne parle pas ici de la représentation en tant que telle, mais de la tentative d’avènement de l’homme nouveau. C’est à cela que le spectateur assiste. Il voit des hommes et des femmes qui « ne peuvent pas se prendre comme ils sont », et qui bougent dans leur corps, dans leur vie, dans leur désir, comme une larve bouge dans son cocon pour devenir un papillon. Je ne sais pas si l’éclosion du papillon va se produire, et si elle se produit, dans quelle mesure il n’en naîtra pas un monstre affreux ou un être sublime. Cela importe peu. Nous saisissons le moment de la gestation, de l’accouchement, ou mieux de la mue.
Cela implique une évolution nette des personnages dans le parcours de la pièce. C’est une condition sine qua non du théâtre que Tchekhov avait déjà formulée il y a longtemps. Un personnage commence à A, passe par B pour arriver à C. S’il n’y a pas ces étapes, il n’y a pas de théâtre. Aucun.
Dans la pièce de Müller, les choses sont plus complexes, et il faudra probablement passer par tout l’alphabet dans le désordre pour arriver à la fin de notre spectacle. Mais comme le dit l’auteur lui-même : « La révolution, c’est faire deux pas en avant et un pas en arrière pour avancer ».
Nous commencerons par l’étape A qui est la première vision du personnage, celle de l’état initial. Un personnage préexiste sans doute à son arrivée en scène. Sa vie s’est déroulée avant le début de la pièce, qui n’est que la saisie, la photographie d’un instant (souvent crucial) de son existence. Mais la perception que nous avons de cet « ailleurs invisible » ne peut pas reposer sur un travail de psychologie scientifique, elle ne peut relever que de nos fantasmes. Vos fantasmes d’acteurs, aussi incohérents qu’ils vous paraissent, s’ils se fixent sur l’objet de votre personnage m’intéressent au plus haut point, parce qu’ils traduisent votre sensation de ce qu’il est. C’est ce matériau que nous allons traiter en premier par le biais d’écriture automatique d’acteur, puis de personnage, dont je vous expliquerai plus tard le déroulement.
Fantasme égale prolixité égale inégalité d’intérêt. Nous serons là pour vous guider dans vos fantasmes. Nous ne voulons pas vous laisser aller à vau‑l’eau dans les méandres de votre imagination, de votre libido, de vos traumas… Votre vie ne nous intéresse pas (d’un point de vue théâtral). Vos frustrations, complexions, forclusions, sublimations… ne nous servent à rien. Rassurez-vous, vous pouvez les garder dans votre petite boîte à secrets, bien précieusement comme des trésors. C’est votre cuisine intérieure.
Nous sommes là pour vous guider le plus précisément possible, et pour vous orienter vers ce qui intéresse le théâtre et la représentation de celui-ci face à un public. La parenthèse est close.
Le cadre
Le fait que vous endossiez chacun plusieurs personnages peut être un obstacle à la véracité de ceux-ci me direz-vous. Certes oui, si nous n’étions pas inscrits dans un cadre précis.
N’oublions jamais que Müller fait partie de ces auteurs qui ont révolutionné la fiction théâtrale. Il est de ceux qui inventent un nouveau genre de fable. Il introduit la fragmentation à outrance, la confrontation de l’Antiquité et du monde moderne, la collision entre les temporalités et le foisonnement des styles de jeu.
L’assemblage de ces techniques renforcé par une écriture viscérale, reposant sur la torture du langage, nous éloigne définitivement de tout vérisme.
Pour parler basiquement, une convention théâtrale d’« étrangeté » est instaurée dès le début dans le chef du spectateur.
Nous voulons accentuer ce sentiment d’étrangeté en mettant l’accent sur l’affrontement du réalisme et du formalisme. Réalisme des lieux, puisque nous jouons dans un lieu industriel, réalisme documentariste dans la volonté de faire porter le texte de l’Hydre et des voix de la population par les habitants du quartier, réalisme renforcé par la crédibilité des personnages que vous plantez. Formalisme dû au texte et à sa facture complexe, littéraire, formalisme de la confrontation entre l’époque décrite dans le texte et la modernité des costumes, formalisme dans le choix des musiques et univers sonores, formalisme enfin dans la multiplication des personnages endossés par chaque acteur.
Cette convention étant claire et nette dès le départ, il ne risque pas d’y avoir de confusion. Imaginez-vous plutôt que vous agissez dans le cadre poétique, didactique, comme les acteurs de Brecht, et plus précisément de La Décision. S’il y a fable, il y a morale. Il y a donc didactisme.
La jeunesse
Dans ses très (trop) brèves notes de mise en scène pour Ciment, Heiner Müller insiste sur le fait que les acteurs doivent être jeunes. Il se justifie en disant que les communistes ont plus d’avenir que de passé.
Loin de nous la volonté de répondre dogmatiquement aux désirs de l’auteur. Il n’en reste pas moins qu’une « telle instruction » peut être prise comme une piste dramaturgique. Müller veut ouvrir le champ de son texte vers notre époque, vers nous. Cela confirmerait le caractère universel que je décrivais tout à l’heure, et place la thématique générale de la pièce en dehors de l’historicité ou de l’épiphénomène politique. Müller nous indique par là cette volonté d’étendre à la communauté humaine dans son entièreté ce qui ne concernerait a priori que la communauté soviétique de 1921.
Cette volonté d’ouverture, nous ne pouvons la négliger. Elle prend d’autant plus de force que l’auteur confronte les temporalités dans le corps même de son œuvre par l’instillation d’épisodes antiques — certes modernisés.
Il faut donc, pour tenter de saisir pleinement le corps dramaturgique du texte, que la mise en scène traduise cette dia-chronologie. Nous avons dit notre attachement à la crédibilité des personnages, ce n’est donc pas là-dessus que va se fixer notre volonté de répondre au désir de Müller.
Nous irons plutôt chercher dans ce qui constitue l’emballage du spectacle, c’est-à-dire les costumes. Je ne prends pas la question du costume par-dessus la jambe. Si je parle d’emballage, c’est qu’à part dans un travail d’hyper-psychologisation ou d’archéologie théâtrale, la question des costumes est la dernière à intervenir. Le costume est un signe à l’endroit du spectateur (quand il n’est pas un soutien de jeu), a contrario du jeu qui est le corps même du spectacle.
Je me rends compte en écrivant ces quelques lignes que cette conception du costume m’est peut-être propre. Bien sûr, le costume peut avoir un impact capital sur la manière d’entendre un texte. Imaginons qu’Anna Petrovna nous dise qu’elle s’habille toujours en noir parce qu’elle porte le deuil de son existence, dans un costume de poule. Cela changerait le sens et l’orientation du spectacle. On se dirait : « tiens, le metteur en scène met une distance », ou « cette fille est complètement folle », ou encore « cette poule est bouleversante d’intelligence et de sensibilité », mais les préoccupations du public seraient toujours fixées autour de la phrase d’Anna. On ne peut réduire l’écho d’une telle phrase par un costume. Le costume est bel et bien l’emballage, la surface, la couche supérieure, tandis que le texte, le jeu, est le cœur même de la représentation.
De toutes les manières, je ne pense pas que nous arrivions à de telles extrémités (pour finir, même si l’ombre de Matthias Langhoff plane sur ce spectacle, nous ne sommes pas obligés de la laisser entrer par la grande porte dans notre théâtre).
Ce que je veux dire, c’est que je pense de plus en plus qu’il faut que les costumes soient modernes, qu’ils soient théâtraux mais modernes. Qu’ils soient le référent de l’inscription de notre démarche dans la vie de 1999. J’insiste quand je parle de costumes « théâtraux », la modernité n’a jamais signifié pour moi la quotidienneté. Il y a un monde entre cette chaussette sale qui traîne sous votre lit, et cette autre salie par trois mois de guerres incessantes qui colle au pied du cosaque comme une trace charnelle de l’usure de son corps, de la fatigue de ses membres, du froid qui l’a battu, de la saleté qui l’a rongé. Une chaussette sale n’est pas une chaussette sale.
De la même manière, vous aurez une interdiction formelle et définitive de vous amener sur le plateau avec votre quotidienneté. Vos costumes, tout modernes qu’ils soient, doivent être marqués par la vie de vos personnages, par leur fonction, par leurs aspirations, par leurs échecs. Il faut que le spectateur croie en vous. Il est possible de faire croire au spectateur que le costume de poule d’Anna Petrovna est la marque ultime de la désespérance humaine, le résidu final d’une vie délétère, épaisse, lourde et vide.
Je ne peux pas précisément vous dire quels seront vos costumes ; je ne peux vous les dessiner, encore moins vous les décrire, peut-être Françoise pourra-t-elle nous aider sur ce point.
J’entends, pour terminer sur ce point, votre objection. J’ai commencé par un discours sur la jeunesse, et j’en termine sur la modernité. La proposition n’est pas aporétique, mais nécessite tout au moins quelques précisions.
Je n’aime pas l’idée de jeunisme. Je ne crois pas que Müller désirait que les acteurs soient jeunes et représentent la fleur du soviétisme. Il est plus sournois que cela. Je le vois mal dans des esthétiques réalistes soviétiques ou junfvolkiennes nazies. Les beaux jeunes gens au corps sculpté et aux cheveux blonds, l’énergie naïve des mouvements de jeunesse mise au service du cynisme dictatorial, je ne crois pas que ce soit son rayon.
Je préfère donc comprendre sa phrase comme une volonté d’actualiser, de tirer vers l’universel (comme je l’ai déjà dit). Et si je me trompe, tant pis, c’est que je suis en désaccord sur un point de la pensée de Müller. Il ne m’en voudra pas et je ne lui en tiendrai pas grief.
Une autre hypothèse possible : ce n’est pas pour traduire l’avenir du communisme qu’il souhaite des jeunes, mais pour que les jeunes puissent s’identifier à ses personnages qui sont loin d’être des « soviétistes ». Il veut peut-être remuer en eux la fibre idéaliste (a‑politicienne) par des moyens sit-commiens américanisants. C’est là qu’intervient la sournoiserie dont je parlais tout à l’heure.
Les fables
En somme, tout cela est fort intéressant, mais la question principale demeure. Au-delà des questions dramaturgiques, que l’on pourrait qualifier de macroscopiques, quel est le cœur, la fable décrite par Müller dans Ciment. Je ne vous étonnerai pas en disant qu’il y en a à profusion, et que, selon chaque personnage, les priorités narratives divergent.
Pour Tchoumalov, on peut citer :
Le retour d’un homme qui a perdu sa jeunesse à la guerre et qui veut maintenant construire sa vie. Cette construction est semée d’embûches. Ancien ouvrier de cimenterie, il voudrait remettre sur pied son ancienne usine actuellement laissée aux pillards. Mais le pouvoir soviétique, doté d’une administration lourde et rigide, va le forcer à rentrer en conflit avec elle. À la fin du combat, il sort victorieux.
Le retour d’un mari, après des années de guerre. En partant au combat, il avait laissé derrière lui femme et enfant qu’il voudrait retrouver maintenant. Mais les temps ont changé, le temps a passé. Sa femme, devenue soviétique, ne veut plus d’un mari propriétaire. Brisée par des années de violence et de solitude, elle a dû renforcer son cœur, et n’est plus disponible à se laisser aller à l’amour qu’elle porte à son mari et à sa fille. Sa fille meurt d’ailleurs de faim. L’ouvrier guerrier a tout perdu.
Le retour d’un homme trahi et qui veut se venger. Dénoncé avec trois de ses camarades par un blanc, il a été tabassé presque à mort par les cosaques. Il a dû fuir sa vie pour la sauver. Il revient aujourd’hui en guerrier victorieux et s’apprête à retrouver le traître et le tuer. Mais une fois face à l’homme, il comprend que la vengeance est vaine et qu’il vaut mieux se servir du traître pour arriver à ses fins que de le tuer.
Un jeune idéaliste se rend compte que l’utopie s’accommode mal de réalité. Que pour changer le monde, il faut changer les hommes, et que ce changement s’accompagne de perte, de deuil, de souffrance.
La prise de conscience d’un homme que la bonne volonté et l’amour de l’humanité ne suffisent pas à faire le bonheur de son prochain. L’histoire d’un homme qui doit se battre avec un système qu’il a lui-même instauré. L’histoire d’un homme dévoré par ce système. L’histoire de l’Hydre.
Pour Dacha :
CIMENT de Heiner Müller, mise en scène Françoise Berlanger, dramaturgie Jean-Christophe Lauwers, Bunker Ciné-Théâtre, novembre 1999.