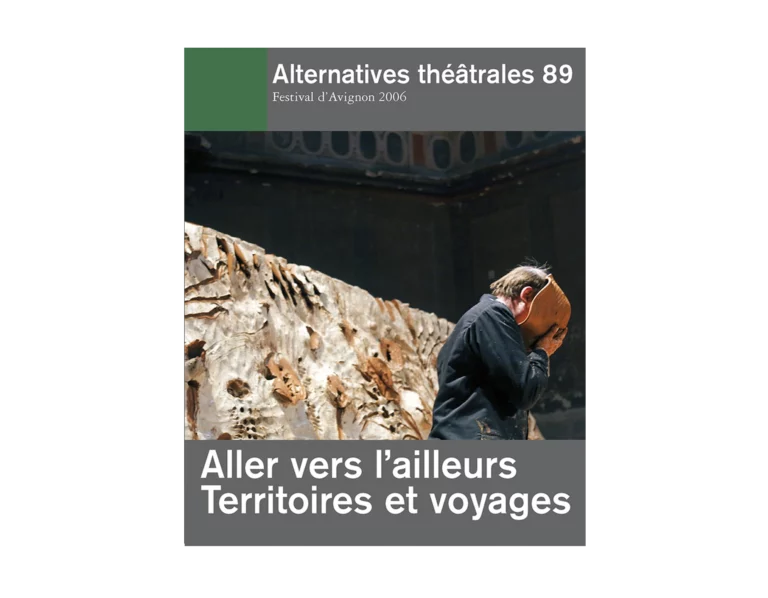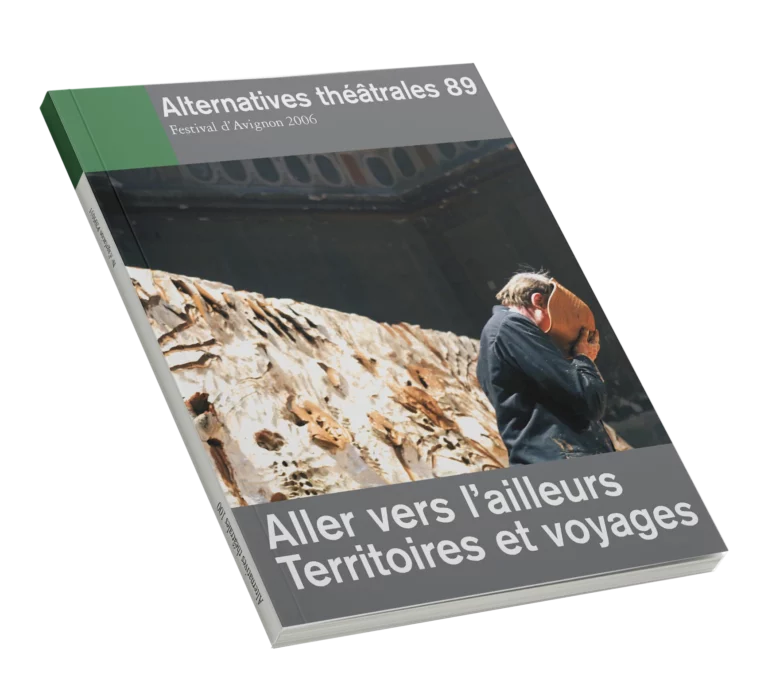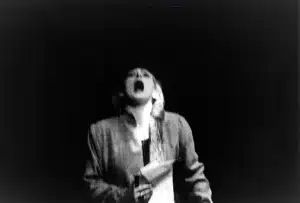BONNE NOUVELLE : l’enfant Ernesto est de retour. Jamais fini avec ce prodigue. Petit et immense, impossible à appréhender. Ernesto a poussé son coup de gueule inaugural il y a trente-cinq ans, dans un album pour enfants1. Le seul jamais écrit par Marguerite Duras. Attaque : « Ernesto va à l’école pour la première fois. Il revient. Il va tout droit trouver sa maman et lui déclare : « Je ne retournerai plus à l’école. »La maman s’arrête d’éplucher une pomme de terre. Elle le regarde : « Pourquoi ?» demande-t-elle. « Parce que !.… dit Ernesto : à l’école on m’apprend des choses que je ne sais pas. » Nous sommes dans l’immédiat après-1968, la fable est portée par ses rebondissements. Feu sur le savoir ossifié ! Feu sur l’encadrement autoritaire ! Retour à la parole, insurrectionnelle. À l’instituteur qui demande à Ernesto comment il envisage d’apprendre ce qu’il sait déjà, le gamin riposte : « En rachâchant. »
En 1982, Jean-Marie Straub et Danielle Huillet s’emparent du texte pour un court-métrage titré :
EN RACHÂCHANT. L’image noir et blanc d’Alekan ancre dans un passé d’école publique à la Doisneau, alors que le portrait du président, affiché au mur, est celui de Mitterrand. La France achangé d’ère. Ernesto s’y retrouve hors conjoncture, gosse teigneux à la Pim Pam Poum. Duras estime les Straub, mais pas assez pour leur abandonner son descendant. Colère. Un compromis ne fait pas son affaire. Elle a engendré Ernesto, elle ne laissera personne d’autre accompagner sa croissance. Elle réplique, en tournant à Vitry-sur-Seine un long- métrage : LES ENFANTS (1984), film méconnu, si atypique qu’elle tentera d’en retarder la sortie pour éviter toute collision avec L’AMANT — Goncourt la même année. Ernesto possède maintenant un corps d’adulte, celui d’Axel Bogouslavsky, dont la silhouette frémissante d’éternel étonné est une bonne indication sur la nature du prodige.
Ernesto n’a pas fini de grandir. Souvent, Duras repense à lui, à sa famille. Elle se sent vaguement coupable de les avoir abandonnés. Un jour, elle se met à écrire « à partir des lieux de tournage de Vitry ». C’est LA PLUIE D’ÉTÉ2. Ernesto a entre 12 et 22 ans, il est le fils aîné d’une famille de sept. Père (italo) et mère (polono-judéo-caucasienne) immigrés. Si la phrase est toujours là : « Je retournerai pas à l’école parce que à l’école on apprend des choses que je ne sais bas », elle n’apparaît plus comme l’évidence énigmatique d’un rabâcheur, mais un signe d’ouverture prophétique, la première manifestation qu’Ernesto est un élu (du peuple), qui découvre à l’école « l’inexistence de Dieu » tout en étant l’enfant par excellence du Livre (un volume à demi consumé qu’il distille à ses « brothers et sisters »). Sans avoir jamais appris à lire, Ernesto cite L’ÉCCLÉSIASTE : « Tout est vanité. et poursuite du vent », avant de se retrouver devant « quelque chose comme la création de l’univers », un big-bang qu’il décrit en chromos enfantines. Toute la chimie du monde et la philosophie allemande poussent Ernesto vers un final de savant errant, « un peu partout dans le monde, au hasard de l’implantation des grandes centrales scientifiques de la terre ».
En 1996, sur la suggestion de Marcel Bozonnet de travailler Duras avec les élèves de troisième année du Conservatoire supérieur d’art dramatique de Paris, Éric Vigner tombe sur la phrase. Il lit LA PLUIE D’ÉTÉ. « Je ne m’attendais pas à découvrir une histoire aussi simple, aussi populaire, une sorte de conte philosophique naviguant entre récit et scénario. Je suis tombé amoureux du livre de Duras comme l’enfant Ernesto tombe amoureux du livre brûlé. LA PLUIE D’ÉTÉ brûlait en moi. J’entrais en connexion avec quelque chose qui me fascine depuis longtemps et que je ne saurais nommer. » Première mise en scène au Conservatoire, devant Duras, présente à nouveau et encore lorsque Éric Vigner reprend LA PLUIE D’ÉTÉ dans un cinéma désaffecté de l’agglomération brestoise. La romancière ne se lasse pas de ce nouvel Ernesto. Éric Vigner ne lui a pris cet enfant que pour le lui rendre forci de théâtre, comme d’un séjour au grand vent des plateaux. En signe de gratitude, elle demande au metteur en scène « ce qu’il veut ». La réponse est prête : « HIROSHIMA MON AMOUR ».
Éric Vigner va vivre dans ce don. Mais le scénario d’HIROSHIMA MON AMOUR ne se donne pas d’avoir été simplement donné. Il ne se laisse même pas approcher. Pas encore. L’intuition d’HIROSHIMA justifait l’appel au don, son ampleur, mais ne le rendait pas disponible pour autant. HIROSHIMA indiquait une destination, nécessaire sans doute, mais qui ne serait pas atteinte sans frayer un chemin, théâtral, vers elle, dans une série de voyages au long cours à travers le territoire durassien. Lorsque Duras meurt (1996), Éric Vigner dirige une lecture d’HIROSHIMA MON AMOUR par Valérie Dréville au Conservatoire. Dès lors, son commerce visible avec l’œuvre de la romancière s’intensifie. Il monte une lecture de LA DOULEUR avec Anne Brochet et Bénédicte Vigner (1998), met en scène LA BÊTE DANS LA JUNGLE dans l’adaptation de Duras au CDDB de Lorient (2001) puis SAVANNAH BAY à la Comédie française (2002). Au cours d’un premier séjour au Japon, le metteur en scène rencontre le comédien Atsuro Watabe : il a la conviction de tenir le Japonais de son HIROSHIMA, songe à le faire dialoguer avec la Française Anne Brochet. Mais HIROSHIMA se refuse encore.